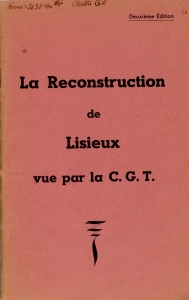Corps
| La Reconstruction deLisieux vue par la C. G. T.- Deuxième édition.- Lisieux :Imprimerie Morière, 1947.- 24 p. ; 21 cm. Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndré Malraux de Lisieux (05.VI.2016) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 2138 br bis). ~ * ~ Le lecteur retrouvera danscertains rapports, des termes, dessuggestions ou des critiques qui figurent déjà dans ceux qui lesprécèdent et il pourra s'est étonner. Nous tenons à préciser que laCommission administrative ne pouvait, agir autrement, car les' diversrapports, rédigés à des dates différentes, n'ayant pas eu la mêmedestination, elle s'est trouvée dans l'obligation de reprendre dessuggestions et des critiques qu'elle avait émises précédemment. Le Bureau de la CommissionAdministrative de l'Union Locale de la C. G.T. de Lisieux. L'Union Locale de la C. G. T. de Lisieux, envisageant l'avenir de notrecité, émet les suggestions développées ci-après, qu'elle porte à laconnaissance de la population lexovienne. Notre ville est appelée à devenir un lieu de pèlerinage de plus en plusfréquenté. Nul ne saurait s'en plaindre, si, comme nous l'espérons, lecoût de la vie s'y stabilise à un niveau normal. Il appartiendra auxcommerçants eux-mêmes qu'il en soit ainsi, dans leur propre intérêt. Dans le cas contraire, les travailleurs iraient habiter des villes oùla vie serait moins chère. Certains seront mêmes contraints à quitternotre ville, lorsque sa reconstruction sera terminée. Les travaux d'entretien des immeubles qui seront en majeure partieneufs, ne nécessiteront qu'une main-d'œuvre réduite pendant denombreuses années. Lisieux tendra à devenir, de plus en plus, une ville où le commercedeviendra saisonnier. Cette situation ne saurait profiter à tous lescommerçants, car si un certain secteur de l'activité commerciale denotre cité y trouvera des avantages, la plupart des commerçants verrontleur chiffre d'affaires diminuer progressivement. La meilleure clientèle est celle qui est installée à demeure,puisqu'elle fait vivre par ses achats divers et ses dépenses régulièresla majorité des commerçants. Aussi l'Union Locale de la C. G. T. demande-t-elle aux municipalités denotre agglomération, à nos représentants au Conseil général, et àl'Assemblée Constituante, ainsi qu'aux responsables lexoviens desdivers partis politiques organisés, d'intervenir — dans la mesure deleurs possibilités — afin que les usines lexoviennes qui serontdéplacées soient reconstruites à proximité de notre ville. Il existait avant la guerre des projets de décentralisationindustrielle. Certaines usines de la région parisienne ont ététransférées dans des villes de province. Au cas où ces projets seraienttoujours envisagés, nos représentants pourraient intervenir pour queLisieux, en qualité de ville martyre, en soit l'une des bénéficiaires. L'installation d'une ou plusieurs usines importantes aux abords denotre agglomération, permettrait de procurer un emploi aux travailleursqui ne songeraient pas à quitter notre ville, et les commerçants, parvoie de conséquence, en seraient également bénéficiaires. En émettant ces suggestions, l'Union Locale de la C. G. T. de Lisieuxenvisage l'avenir de notre ville, que nous voudrions prospère et animéeen toutes saisons. Elle retrouverait ainsi, à une échelle plus grande,son activité d'autrefois que les touristes se plaisaient à reconnaître. (Cetarticle a été inséré dans leLexovien Libre du 8 février 1946.) * * * Commentant l'article sur l'avenir de la ville de Lisieux, que l'UnionLocale de la C. G. T. a fait paraître dans la presse, certainscommerçants déclarent que notre cité pourrait vivre uniquement ducommerce qu'elle entretiendrait avec nos visiteurs. Nous estimons quece raisonnement est entaché d'erreur. Pour appuyer notre thèse, nousallons employer des chiffres qui sont, par eux-mêmes, éloquents On estimait en 1939, que l'agglomération lexovienne abritait au moins5.400 travailleurs salariés. En ne retenant que ce minimum et enestimant qu'en moyenne, un travailleur dépense sur place 4.800 fr. parmois, il S'ensuit que les dépenses faites annuellement par les salariéss'élèvent à la somme globale de trois cent onze millions de francs.Cette somme imposante, qui entre dans les caisses de nos commerçants,se renouvelle chaque année, puisqu'elle provient des revenus que laclasse ouvrière acquiert par son travail. Si l'on admet, d'autre part, qu'un pèlerin dépensera une moyenne decinq cents francs pendant son passage à Lisieux, il faudra la venue,dans notre cité, de 622.000 visiteurs pour équilibrer seulement lesdépenses effectuées par les travailleurs habitant à demeure. Laproportion serait encore plus grande si notre ville prenait undéveloppement industriel plus important, car l'intérêt général seconfond souvent avec celui de la classe ouvrière. Naturellement, sinotre cité devenait uniquement une ville touristique, un nombreimportant de travailleurs continueraient à y trouver du travail, maisbeaucoup d'entre eux devraient supporter un chômage saisonnier et leurpouvoir d'achat se trouverait diminué. La classe ouvrière fait vivre l'ensemble des commerçants. Il en estbeaucoup, parmi eux, qui ne pourraient prospérer sans elle. Par contre,les pèlerins limitent leurs dépenses à un secteur commercial nettementdéterminé. En fait, un pèlerin n'est qu'un passager qui a obéi à unsentiment religieux et qui se contente souvent de se restaurer etd'acquérir quelques objets à titre de souvenirs. Parmi nos visiteursd'avant-guerre, et le cas se reproduira dans l'avenir, certainsprofitaient de la réduction des tarifs des voyages organisés en communpour venir passer quelques heures à Lisieux et se rendaient ensuite surles plages de la côte. Loin de nous la pensée de ne pas souhaiter l'afflux des visiteurs. Bienau contraire, nous désirons que l'industrie hôtelière et touristiqueprenne de plus en plus d'extension dans notre cité. Nous espérons aussique nos commerçants sauront maintenir leurs prix à des tarifsraisonnables. Ce serait la meilleure propagande qu’ils pourraient fairepour inciter les visiteurs à revenir dans notre ville. En émettant ces suggestions, l'Union Locale de la C. G. T. de Lisieuxn'a en vue que l'intérêt de notre ville que nous voudrionsaccueillante, prospère et animée en toutes saisons. (Cetarticle a paru dans Ouest-France du 23 février 1946.) * * * L'Union Locale de la C. G. T. tient à faire connaître son opinion ausujet du plan d'extension de Lisieux. Elle estime que l'agglomération lexovienne devrait être unifiée et elledésire qu'une vaste étendue de terrain soit annexée à notre cité. Notre ville est appelée à prendre de l'extension et pour cela, il estnécessaire qu'elle puisse s'étendre librement sur son propreterritoire. Sa faible étendue a nui dans le passé à son développementnormal. Elle s'est trouvée enserrée sur un espace trop restreint et desannexions partielles n'améliorèrent pas sensiblement cette situation. Aujourd'hui, au contraire, la recherche du confort et le respect desrègles de l'hygiène conduisent les générations nouvelles à vouloir plusd'espace. Les villes s'étendent de plus en plus dans la campagne.Ce phénomène naturel et général, dont il faut tenir compte, est encoreamplifié par la mise en application des règlements concernantl'urbanisme. Les immeubles y avaient atteint une densité qui n'était pasraisonnable, et c'est ainsi que s'étaient créés progressivement lestaudis qui déshonoraient notre ville. Ne renouvelons pas l'erreur qui a été commise par nos ancêtres etn'oublions pas que les générations futures nous jugerons à leur tour. L'Union locale de la C.G.T. de Lisieux demande aux municipalités del'agglomération lexovienne de s'unir fraternellement pour discuter decet important problème et elle estime qu'en l'occurrence, plus encoreque l'union, la fusion fait la force. (Cet article a été publié dans leLexovien Libre du 8 mars 1946.) * * * Rapportsur les plans d'extension et de reconstruction de Lisieux approuvé le 18 mars 1946 par la Commission Administrative del'Union Locale. La Commission. Administrative de l'Union Locale de la C.G.T., qui vientde prendre connaissance du plan de reconstruction de notre ville dresséle 29 septembre 1945, estime qu'il est de son devoir d'informer lamunicipalité lexovienne des objections et des suggestions qu'elle croitdevoir émettre dans l'intérêt général de notre cité. Elle regrette que les organisations ouvrières, qui ne sont pasreprésentées au sein du Conseil municipal, n'aient pas été consultéespendant toute la période de discussion des plans de reconstruction etd'extension de Lisieux. Et, pourtant, la classe ouvrière, qui est laplus nombreuse, est la seule qui n'ait pas d'intérêts particuliers àdéfendre. Les travailleurs désirent habiter des maisons saines etensoleillées en exigeant un confort auquel tout être humain peutaujourd'hui prétendre. Ils souhaitent que leurs lieux de travail(magasins, ateliers, bureaux, chantiers) soient reconstruits ou agencésen tenant compte des règles de salubrité et d'hygiène. Ils désirent quenôtre ville redevienne prospère et que son activité commerciale etindustrielle s'amplifie sans cesse, éloignant d'autant le cauchemar duchômage. Enfin, ils souhaitent habiter une cité agréable où l'on aitplaisir à vivre. Ces désirs sont partagés par toute la population. L'Union Locale de la C. G. T. tient à préciser, tout d'abord, saposition au regard du plan d'extension de Lisieux. Ainsi qu'elle l'afait connaître récemment par un article paru dans la presse, ellesouhaite que l'agglomération lexovienne soit uni fiéeet qu'une vaste étendue de terrain soit annexée à notre cité. Elledésire l'annexion totale des communes rurales qui la composent. Elleespère, ce qui serait préférable, que les municipalités rurales saurontmettre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers etqu'elles seront unanimes à demander leur rattachement à Lisieux, ledéveloppement de notre cité ne pouvant qu'être profitable auxproducteurs de notre région. La ville de Lisieux ne serait plus enserrée sur un espace restreint.Elle prendrait normalement l'extension qui lui convient. Elles'étendrait progressivement, sans contrainte, sur son propreterritoire. Ainsi, les usines qui doivent abandonner le centre de laville pourraient être reconstruites à sa périphérie. Ellescontinueraient à faire partie de notre cité tout en disposant depossibilités d'agrandissements ultérieurs, qu'elles ne possédaient pasen 1939, puisque des terrains plus vastes pourraient leur êtreattribués. D'autre part, les projets de décentralisation industrielle de la régionparisienne, qui avaient reçu un commencement d'exécution avant laguerre, seront peut-être repris. De nombreuses villes de provinceétaient intervenues dans le but d'en être les bénéficiaires. Notreville, qui disposerait d'une vaste étendue de terrain, pourraitdemander qu'une ou plusieurs usines importantes soient transférées surson territoire. Elle pourrait même être prioritaire en raison de sasituation de ville martyre. L'installation d'une ou plusieurs de cesusines aurait pour résultat, tout en assurant un emploi à un certainnombre de travailleurs, d'intensifier l'activité industrielle etcommerciale de notre cité. L'espace ne faisant plus défaut, une partie de l'industrie touristiqueet hôtelière lexovienne se porterait progressivement aux alentours dela basilique, et ainsi, se créerait un quartier spécialisé qui pourraitdevenir très important et qui tirerait ses principales ressources ducommerce effectué avec les pèlerins. Notre agglomération étant unifiée, il n'existerait plus qu'un uniqueplan d'extension et d'urbanisme qui régirait le développement ultérieurde notre ville. Nous ne verrions pas se renouveler l'anarchie qui arégné après 1919 dans la plupart des agglomérations administrées parplusieurs municipalités ; lesquelles avaient souvent des idées plus oumoins heureuses et contradictoires en matière d'urbanisme. Notre ville serait composée d'un noyau qui constituerait la zone deshabitations collectives autour de laquelle rayonnerait la zone deshabitations individuelles qui pourrait s'étendre librement dans lecadre du plan d'urbanisme. Avant d'aborder l'étude du plan de reconstruction de Lisieux, noustenons à préciser que nous n'apporterons aucune objection systématique,mais on doit reconnaître que toute œuvre humaine est perfectible. Cettevérité n'est pas ignorée par les travailleurs du bâtiment qui relèventfréquemment des erreurs sur les plans dressés par les architectes.Ignorant la teneur des débats qui eurent lieu au Conseil Municipalavant l'approbation du plan de reconstruction, nous venons soulever desobjections et apporter des suggestions qui découlent de l'étude du plandont nous avons eu connaissance. Nous espérons que notre franchise etnotre bonne foi seront reconnues, même si nos suggestions ne pouvaientêtre acceptées, puisque nous œuvrons dans l'intérêt général de notrecité. Nous nous plaisons à reconnaître la valeur du plan dressé par M. CAMELOT,et accepté par la municipalité. Nous y relevons avec plaisir lacréation de boulevards extérieurs qui seront appelés à devenir lesartères principales de notre cité. Si une erreur semble avoir étécommise en ce qui concerne le point de jonction des artères donnantaccès à notre ville du côté de la route de Caen, nous ne pouvonsqu'approuver les tracés proposés par M. CAMELOT qui aassocié de façon heureuse la ligne droite à la ligne courbe. Il s'estéloigné délibérément du tracé rectiligne qui n'engendre que lamonotonie dans les villes où il a été mis intégralement en application.Notre cité conservera ainsi un cachet particulier qui charmera sesvisiteurs. Nous qui avons connu les rues étroites, sans air et sans lumière, quiavons vécu dans des logements, où, bien souvent, les rayons du soleilne pénétraient même pas, nous avions souhaité l'élargissement de toutesles rues à reconstruire en nous gardant de toute exagération. Les ruescommerçantes qui connaissaient un encombrement journalier bien connu,devraient assurer le passage de quatre voitures de front. Il faudraitprévoir de chaque côté de la chaussée l'arrêt des voitures apportant ouenlevant les marchandises, et, au milieu, la libre circulation desvéhicules qui emprunteront ces artères. Des trottoirs suffisammentlarges seraient créés. Les passants pourraient ainsi s'attarder auxétalages sans gêner la circulation des piétons qui étaient souvent dansl'obligation de descendre sur la chaussée, ce qui n'était pas sansdanger. Le rôle des rues n'est pas uniquement de faciliter lacirculation dans les villes, mais aussi d'y laisser pénétrer l'air etla lumière dont elles ont besoin. Nous avons constaté avec plaisir la création d'une voie parallèle à larue Pont-Mortain qui bénéficiera d'un ensoleillement presque parfait,son axe ne formant qu'un angle de quatorze degrés avec la lignenord-sud. Par contre, nous avons vu avec surprise le maintien de la ruedu Capitaine-Vié qui, étant donné l'étroitesse de sa chaussée, donnel'impression d'un couloir malsain. En effet, elle se trouve placée dansla plus mauvaise position d'ensoleillement qui soit, son axe ne formantqu'un angle de neuf degrés avec la ligne est-ouest. Bon nombre des ruesexistantes ont la même orientation défectueuse. Nous ne doutons pas queM. CAMELOT donnera une meilleure orientation aux voiesnouvelles, dans la mesure du possible. Il aura droit ainsi, à toute lareconnaissance de la population, car, s'il est vrai de dire que lesoleil brille pour tous, il est normal que ses rayons puissent pénétrerdans chaque logement et dans tous les locaux où chacun effectue sontravail. Nous approuvons la dérivation prévue sur la route de Paris pourrejoindre le boulevard Carnot. Nous aurions envisagé la création d'unboulevard extérieur, bordé d'une promenade plantée qui, partantégalement de ce point, de jonction, aurait traversé la rue Roger-Ainiet serait venue aboutir à l'avenue de la Basilique en suivantapproximativement les courbes de niveau. La route d'Orbec aurait étéainsi reliée directement à la route de Paris. L'examen du plan fait nettement apparaître l'utilité de cette nouvellevoie de dégagement qui serait susceptible de devenir l'artèreprincipale d'un nouveau quartier qui pourrait être créé ultérieurementsur cette colline. Le terrain étant de bonne qualité dans ce secteur,un jardin public, qui ne serait pas trop éloigné du centre la ville,pourrait être prévu en bordure de ce boulevard. De la terrasse dujardin public, qui dominerait la vallée de la Touques, un magnifiquepanorama s'offrirait à notre vue et pourrait impressionnerfavorablement nos visiteurs. La partie de la rue de Caen comprise entre la route de Falaise et larue Gustave-David aurait pu être déportée vers l'ouest de façon àatteindre le chemin d'Assemont à la hauteur du Cirieux. Une place aubord de laquelle l'église Saint-Désir légèrement déplacée seraitreconstruite, aurait été créée sur le terrain de l'Abbaye desBénédictines. La route de Dives et les artères projetées seraientvenues aboutir à cette place dont le centre aurait été agrémenté par unmonument, une fontaine ou une statue. La circulation y aurait eu lieudans le sens giratoire, facilitant et régularisant ainsi le trafic quiest intense dans cette partie de la ville. La création de cette place àsens giratoire aurait permis de supprimer le carrefour dangereux de laroute de Caen et de la route de Dives, voies très fréquentées pendantla saison estivale. Cette dernière artère aurait eu même l'avantage devenir aboutir en pente douce à cette place. L'artère conduisant àl'église Saint-Pierre aurait été déplacée vers le sud, dans sonextrémité ouest et la perspective vers cet édifice aurait encore étéaméliorée. La rue Gustave-David aurait pu être déportée vers le sud etprolongée jusqu'à la place Gambetta pour la mettre en alignement avecla perspective de l'église Saint-Jacques. En partant de la placegiratoire, une artère aurait rejoint directement le boulevardSainte-Anne à la hauteur de la rue Rose-Harel, nécessitant toutefois,le déplacement des gazomètres. La création de cette artère s'imposeradans l'avenir. Les terrains qu'elle empruntera devraient être frappésdès maintenant d'une servitude spéciale. Sa construction deviendraitfacile à partir du moment où un système économique de chauffageélectrique domestique ayant été réalisé, l'usine à gaz serait appelée àdisparaître. Ainsi, l'entrée de notre ville, en arrivant de Caen, aurait étéaccueillante, le regard des touristes après s'être porté sur l'égliseSaint-Désir aurait été attiré à gauche par la perspective de lacathédrale, au centre, par celle de l'église Saint-Jacques et à droitepar la basilique qui domine la ville. L'écartement entre les artères qui aboutiront au carrefour de la rue deCaen se trouvant augmenté, la construction d'immeubles aurait pu êtreenvisagée sur une partie des terrains prévus en jardins et situés entreles rues de Caen, Gustave-David et le boulevard Sainte-Anne. Il est àcraindre que l'étendue de ces espaces libres ne donnent l'impression deséparer complètement la ville de la partie de l'agglomération quis'étend vers Saint-Désir. Nous voyons avec surprise que les divers cours d'eau qui sillonnentnotre cité seront conservés. Ne pourrait-on pas envisager pour plustard, en réservant dès maintenant les terrains nécessaires, unélargissement et un approfondissement des lits de la Touques et del'Orbiquet et la suppression des différents bras de dérivation. Nouspourrions avoir, dans l'avenir une belle rivière qui s'écoulerait entredes quais qui seraient bordés d'immeubles au lieu d'avoir ces immondescours d'eau qui serpentent dans notre ville, se séparent et serejoignent sans ordre défini. Cette modification des lits de nosrivières permettrait d'abaisser le plan d'eau, leur assurerait un débitplus important et plus régulier diminuant ainsi la menace d'inondationqui pèse en permanence sur les habitants des bas quartiers. La voie nouvelle prévue entre le boulevard Emile-Demagny et l'avenue dela Basilique semble être de réalisation difficile mais, tôt ou tard, saconstruction s'imposera. Il y aurait peut-être intérêt à prévoir lenivellement du triangle qui vient aboutir au Rond-Point. Laconstruction d'immeubles en bordure de l'avenue de la Basilique seraitrendue possible sur un emplacement où personne n'a osé faire construireen raison de l'instabilité du terrain. La voie qui mènera de la gare au centre de la ville en passant par laplacé Fournet est appelée à devenir une artère très fréquentée audétriment de la rue Henry-Chéron. Alors qu'autrefois, l'activitécommerciale se portait de préférence sur le bord des routes à grandtrafic, le centre commercial se déplace aujourd'hui, dans presquetoutes les villes, en direction des gares. Cette attraction s'expliquepar le fait qu'une grande activité règne autour d'elles. Il seraitnormal que la rue de la Gare, la place Fournet et la rue d'Alençonsoient bordées entièrement par des immeubles dont le rez-de-chausséeserait réservé pour des magasins. Cela permettrait de décentraliser lesmaisons de commerce qui se trouvaient à l'étroit dans le centre de laville. Chaque commerçant disposerait alors d'un espace plus grand,vivrait dans une atmosphère plus saine et verrait son commerceprospérer comme autrefois. Le personnel qui travaillerait dans cesmagasins y trouverait également avantage, puisqu'il œuvrerait dans demeilleures conditions de salubrité et d'hygiène. Nous estimons que l'étendue des jardins et des espaces libres prévus ausud du boulevard Jeanne-d'Arc et du boulevard Sainte-Anne est tropvaste et trop rassemblée. Nous aurions préféré qu'ils soient répartiséquitablement sur l'ensemble de la zone des habitations collectivesdont ils auraient amélioré l'aération. Cela aurait permis la créationde squares disséminés dans toute cette zone. Ces squares auraient étéclos et auraient comportés des emplacements réservés pour les jeux desenfants. Les mamans auraient pu profiter de leurs moments de libertépour se rendre, avec leurs jeunes enfants, au square voisin. Il est àcraindre que de nombreuses mères de famille soient encore, pendant denombreuses années, dans l'obligation de travailler pour améliorer lebien-être de leur foyer. Aussi, chaque maman devrait avoir le plaisirde retrouver ses enfants en rentrant de son travail, soit à la maison,soit au square tout proche, où ils se livreraient à leurs ébats horsdes dangers de la rue. On ne devrait plus voir d'enfants traîner dansles rues, comme autrefois, parce qu'ils manquaient alors d'emplacementspour leurs jeux. La partie du boulevard Sainte-Anne comprise entre la rue Rose-Harel etla rue Gustave-David devrait être bordée d'immeubles aux lieux et placedes jardins prévus. Ces constructions auraient l'avantage de dissimuleraux regards les bâtiments industriels de l'usine à gaz qui manquentd'esthétique. Nous aborderons maintenant la délicate question des îlots fermés. Ilest à craindre que dans le centre de la ville leur nombre soit important. Il faudra prévoir un centre d'îlots bien gagé et lesservitudes qui les frappent devront être strictement respectées.Autrement, nous assisterons à la création de nouveaux taudis. C'estainsi, par exemple, qu'un commerçant qui verrait son affaire prospérerpourrait être enclin à faire un appentis dans la cour, puis un autre,et un beau jour il se déciderait à la recouvrir entièrement comme celase voyait autrefois. Il priverait ainsi d'air et de lumière lerez-de-chaussée où ses employés continueraient de travailler. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons indiqué notre désir devoir les rues élargies, car nous ne devons pas oublier que le soleil nes'élève qu'avec regret au-dessus de l'horizon pendant la mauvaisesaison, ses rayons obliques ne pénètrent pas alors dans les immeublesavec la même générosité que pendant la période estivale. Notre ville a perdu hélas beaucoup de son attrait pour les touristes.Un effort doit être tenté pour les inciter à ne pas oublier notre cité.Il suffirait de mettre en valeur les quelques monuments historiques quiont échappé au désastre. Il s'agit en premier lieu de la cathédraleSaint-Pierre qui nous apparaît émargeant des ruines, plus belle encorequ'autrefois. C'est avec plaisir que le regard s'attarde sur ellelorsque l'on descend la rue Henry-Chéron. Nous verrions très bien unsquare délimité par la Place Thiers, la rue Henry-Chéron et la rue duParadis qui donne accès au transept. Nous mettrions ainsi en valeurl'un des plus beaux chefs-d’œuvre de l'art gothique normand dont il nereste plus que quelques exemplaires. Ce square abrité des vents du Nordet de l'Est serait fréquenté dès les premiers beaux jours de chaqueannée par la population lexovienne. Les enfants pourraient s'y ébattreà l'aise, hors des dangers de la rue et les personnes âgées viendraienty chercher un peu de distraction et de repos. De semblables oasis deverdure devraient également encadrer les autres monuments historiques. Les établissements publics devraient être reconstruits en stylenormand. Il ne saurait être question de reconstituer les immeublesd'autrefois, mais de retenir les principes généraux de ce style que nosarchitectes ont si bien su adapter à la construction moderne. Si nous voulons rappeler le passé de notre cité à nos visiteurs, ilpourrait être conseillé aux architectes qui seront chargés del'édification des immeubles en bordure de certaines artères d'établirleurs plans en tenant compte du style normand. Notre cité retrouveraitainsi un certain caractère régional qui attirerait et retiendrait lestouristes. L'intérêt général exigerait même qu'une réglementationstricte soit prévue à cet effet. Les immeubles qui seront construits en bordure de la rue d'Alençonentre la rue Vasseur et la Place Fournet devraient avoir leurrez-de-chaussée réservé uniquement pour des magasins qui pourraientêtre à double façade, l'une donnant sur la rue d'Alençon l'autre sur lesquare. Une étroite chaussée serait alors aménagée entre cesconstructions et les squares. Un trottoir qui pourrait être couvert etbordé d'arcades longerait les immeubles de ce côte. Il pourrait êtreréservé au rez-de-chaussée deux passages d'environ quatre mètres delarge situés dans l'axe des rues Duhamel et Lecouturier, ce quipermettrait aux piétons d'accéder directement dans la rue du Carmel ouvice versa en passant par le square qui aurait une certaine animation.Ce quartier aurait ainsi un caractère particulier qui charmerait nosvisiteurs. Nous aurions vu avec plaisir la création d'un vaste jardin public où lestyles anglais et français auraient trouvé place librement. Il auraitété destiné à remplacer ultérieurement le jardin public actuel qui estappelé à se dénuder dans un délai assez rapproché en raison del'ancienneté des arbres qui l'ornementent. Notre jardin public seraitnéanmoins conservé puisqu'il renferme le Monument aux Morts et qu'ilsert de cadre naturel au Musée et à la Cathédrale. Nous regrettons que la création de vastes allées plantées d'arbresd'ornement en bordure de certains boulevards extérieurs n'ait pas étéprévue. Nous aurions réalisé ainsi des promenades publiques qui sont lecharme de certaines villes de province. Il existe près de nous un beausite naturel. Il s'agit de l'espace compris entre les cités de la rueRose-Harel qui sont appelées à disparaître et le Mont-Cassin. Nepourrait-on pas envisager la création entre la Touques et la collined'un parc qui serait réservé de préférence aux manifestations nautiques. Nous devons avoir toujours à l'esprit que l'œuvre de reconstruction quenous allons entreprendre nous survivra pendant de nombreux siècles.L'aménagement et l'extension de notre ville sera un travail de longuehaleine. Dès maintenant, nous devons prévoir le développement ultérieurde notre cité si nous ne voulons pas que les générations futuresregrettent notre imprévoyance lorsqu'elles seraient contraintes à selivrer à des expropriations coûteuses pour réparer les erreurs que nousaurions commises. La commission administrative de l'Union locale de la C.G.T. faitconfiance à M. CAMELOTdont le nom restera attaché à la reconstruction de Lisieux, pour éviterces écueils. Elle a tenu à faire connaître les principales critiquesqu'elle apporte au plan de reconstruction de Lisieux et ses suggestionsqu'elle estime raisonnables, les émettant dans l'intérêt général denotre cité que nous voudrions accueillante, prospère et animée entoutes saisons. (Ce rapport a. été remis en mars1946,à M. le Maire de de Lisieux. Des copies ont été adressées à M. leMinistre de la Reconstruction et de l'Urbanisme ainsi qu'à M. leSous-Préfet de Lisieux). * * * Sous-Préfecture deLisieux Le 16 Avril 1946. Messieurs, J'ai l'honneur de vous accuser réception du rapport établi par laCommission Administrative de l'Union Locale de la C. G. T. sur lesplans d'extension et de la reconstruction de Lisieux. J'ai pris un très vif intérêt à sa lecture et je puis vous assurer queje partage vos vues en général et en particulier sur votre projet dedégagement de la cathédrale Saint-Pierre ; je serais très partisan dela voir encadrée de verdure vers la rue Henry-Chéron. Par contre lechangement de style du jardin public me paraîtrait une erreur car, danssa forme actuelle, il cadre avec le style des bâtiments qui l'entourent. Soyez certains que je tiendrai compte de vos suggestions sur ce projetd'extension et de reconstruction de Lisieux et ne manquerai point dem'entretenir avec M. CAMELOT de vos judicieusespropositions en les appuyant. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. LeSous-Préfet, MAURIN. Messieurs les Membres de la Commission Administrative de l'Union Localede la C. G. T., Lisieux. * * * UNIONLOCALE Lisieux, le 29 Avril 1946. de la C. G. T. de Lisieux Monsieur le Sous-Préfet, J'ai l'honneur de vous informer que la Commission Administrative del'Union Locale a pris connaissance avec plaisir de votre lettre du 16Avril courant concernant les plans d'extension et de reconstruction deLisieux. Nous vous remercions de la bienveillance avec laquelle vous avez bienvoulu étudier le rapport que nous vous avons adressé et que nous avonsétabli en nous plaçant strictement devant l’intérêt général et l'avenirde notre malheureuse cité. Nous tenons à préciser notre pensée au sujet du Jardin Public dont nousadmirons le style qui devra être maintenu et qui sert de cadreadmirable au Musée et à la Cathédrale. En envisageant la création d'unnouveau Jardin Public plus étendu, nous n'avons pas voulu porteratteinte à celui qui existe. En émettant cette suggestion, noustravaillons pour les générations futures. Il faudrait en effet denombreuses années avant que les arbres du jardin public qui serait créépuissent offrir un ombrage suffisant, recherché par les promeneurs etque ne pourra peut-être plus alors leur procurer notre jardin publicactuel, car malheureusement les arbres qui l'ornementent sont appelés àdisparaître progressivement pour des raisons naturelles. Etant donné ladensité de la plantation, les jeunes arbres qui seront plantés enremplacement auront de la peine à végéter à l'ombre de ceux quicontinueront d'exister. Il est à craindre que notre jardin public sedénude, et cela nous ne pourrions que le regretter. Il sera toujoursrecherché puisqu'il est situé au centre de la ville. Tout devra êtremis en œuvre pour que son style soit respecté et que le Monument auxMorts qui y a été érigé demeure toujours dans un cadre digne de noscompatriotes « Morts pour la France ». Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Sous-Préfet, l'expression denos sentiments respectueux. Pour la CommissionAdministrative de l'Union Locale : Le SecrétaireGénéral, LEDEVIN. * * * RAPPORT sur le LOTISSEMENT des 4-SONNETTES Adopté le 27 Mai 1946 par la Commission Administrative L'Union Locale de la C. G. T. de Lisieux a de nombreuses critiques àapporter concernant le lotissement des Quatre-Sonnettes qu'elle se faitun devoir de porter à la connaissance des autorités compétentes. Les maisons des Quatre-Sonnettes semblent devoir être édifiées à titredéfinitif bien que le plan porte la mention : « Maisons provisoires endur ». Autrement, on ne s'expliquerait pas pourquoi il a été prévud'importantes charpentes qui ont nécessité des cloisons épaisses et quiont conduit à d'importantes surfaces de toitures. Nous espérions queles plans de ces maisons avaient été mûrement réfléchis et établis entenant compte des besoins et du confort auquel tout être humain peutaujourd'hui prétendre. Nous regrettons qu'un emplacement n'ait pas étéprévu pour une baignoire. Il nous a été possible de visiter récemment les deux seules maisons quisoient hors d'eau. Nous avons constaté dès l'abord que les PouvoirsPublics s'obstinent à considérer que la classe ouvrière n'a pas ledroit de posséder une salle à manger indépendante puisqu'il esttoujours prévu une salle commune. Et pourtant, la plupart destravailleurs seraient heureux de posséder une salle à manger où lesmeubles seraient à l'abri des buées de la cuisine et des dégâts que lesenfants en bas-âge font inconsciemment lors de leurs ébats dans lasalle commune. Si cette salle, qui est de bonne dimension, ne prête pas à critique, iln'en est pas de même pour les chambres qui sont fort petites et quiseront difficiles à meubler. Cette difficulté a encore été aggravée par le fait que les cheminéesont été prévues en plein panneau. Il eut été préférable qu'elleseussent été placées en angle. D'autre part, les murs ayant étéprimitivement prévus de 25 centimètres sont portés à 36 centimètres parla construction d'un contre-mur intérieur. Cette modification a poureffet de réduire encore la surface des pièces. La chambre des parents aurait pu être de dimension respectable, car ilest normal qu'un emplacement aurait dû être prévu pour l'installationd'un lit d'enfant dans cette chambre. Une porte de communication auraitpu être prévue dans la cloison qui sépare les deux chambres, l'uneétant réservée aux parents et pour le dernier né, le cas échéant,l'autre aux enfants plus âgés. Ces derniers se trouvent séparés deleurs parents qui devront ouvrir trois portes et traverser entièrementla salle commune pour se rendre à la chambre de leurs enfants quiseront ainsi isolés. Chaque mère de famille comprendra la grossièreerreur qui a été commise en ne faisant pas communiquer directement lesdeux chambres. On a voulu copier le style normand, mais on a oublié que la sallecommune des vieux logis donnait directement sur la façade des maisonset c'est ce qui en faisait le charme. Tel n'est pas le cas puisqu'uneentrée et une petite pièce sont prévues sur la façade principale,reléguant cette salle commune à l'arrière de l'immeuble. Ainsi, cettefaçade comprend trois fenêtres de dimensions dissemblables parlogement, l'une servira d'aération aux water-closets, l'autre donnerade la lumière à la laverie, la troisième enfin sera celle d'une chambre. Cette disposition des ouvertures, il faut le reconnaître, n'est guèreesthétique et la corniche elle-même n'est pas visible. De plus la ported'entrée prévue sans panneaux et avec un judas contribuera à donner unaspect sévère et rébarbatif à cette façade qui devrait êtreaccueillante. Nous aurions vu avec plaisir une porte avec un panneaufonte vitré qui aurait eu pour avantage de laisser pénétrer plus delumière dans l'entrée. Au contraire, on aurait dû prévoir cette salle commune sur la façadepour pouvoir faire profiter ses habitants du magnifique panorama de laVallée de la Touques. Cette pièce aurait bénéficié également demeilleures conditions d'ensoleillement qui ne sont pas à dédaigner sousle ciel nuageux de Normandie. En outre, le cellier du logement dedroite a la plus mauvaise orientation qui soit puisqu'il a façade surle sud. Tous les celliers auraient dû être construits face au nord. Encas d'impossibilité l'angle nord-est de toutes les maisons orientées enconséquence aurait dû être réservé à cet effet puisque la durée etl'intensité de l'insolation y sont minima. Les maisons semblent avoir été prévues sans qu'il ait été tenu comptede l'orientation qui leur serait donnée, de l'ensoleillement qui doitêtre réservé aux pièces principales. C'est ainsi que certaines maisonsen cours de construction ont la salle commune orientée au nord et lecellier situé en plein midi. Il est regrettable qu'on n'ait pas tenucompte des règles élémentaires de salubrité. Il était facile deconstruire, au lotissement des Quatre-Sonnettes, des maisons où lesoleil aurait pénétré à flot. Il suffisait pour cela d'en modifier lafaçade et le cloisonnement intérieur selon leur emplacement et parrapport à la rue qui sera établie. Cette conception aurait eul'avantage de rompre la monotonie qui se dégage de l'ensemble desconstructions. D'autre part, un monumental grenier a été établi au-dessus des piècesd'habitation. Il a nécessité une imposante charpente et la surface detoiture est importante. On peut s'étonner qu'au moment où lesmarchandises sont rares on édifie de semblables toitures. On a voulusans doute perpétuer le souvenir des greniers à foin des constructionscampagnardes, mais cette conception a eu pour résultat d'alourdirl'aspect des maisons qui ressemblent extérieurement à des bâtiments deferme. Il eut été préférable que la charpente soit moins importante etque la construction d'un étage eût été retenue. En admettant même quela charpente aurait été maintenue, la surélévation des murs de soixantecentimètres aurait permis, sans dépense supplémentaire importante, deconstruire ou de prévoir ultérieurement des mansardes avec lucarnes quisont aussi les attributs du style normand. L'emplacement d'un escalierintérieur aurait pu être facilement trouvé. Cette façon d'opérer aurait permis d'assurer plus de logement à chaqueménage. Des familles nombreuses auraient pu trouver ainsi un logisconfortable. De plus, on oublie que les enfants recueillent souventleurs vieux parents et que ces derniers ont droit aussi à une pièceséparée pour y retrouver la tranquillité à laquelle ils aspirent etavoir l'illusion d'être encore chez eux. Nous avons constaté que dans plusieurs maisons en construction onremblayait à l'intérieur des murs jusqu'à une hauteur d'environ 1 m.50. Ne pourrait-on pas envisager de conserver ces vides pour établirdes caves qui seraient plus fraîches que les celliers prévus, ce quiaurait par ailleurs l'avantage d'assainir les maisons et d'augmenter lasurface habitable. Lors de notre retour, nous devions constater également que des briquesentières de très bonne qualité avaient été utilisées pour boucher desornières des voies d'accès au lotissement alors que dans notremalheureuse cité les débris abondent. L'Union Locale de la C. G. T. de Lisieux, après avoir fait connaitreles principales critiques qu'elle apporte aux constructions dulotissement des Quatre-Sonnettes, demande aux autorités responsablesd'envisager si, comme elle l'estime, des modifications peuvent encoreêtre apportées aux constructions en cours d'exécution dans l'intérêtdes familles qui les habiteront. Elle espère que les maisons qui serontélevées ultérieurement dans ce lotissement seront construites d'aprèsdes plans nouveaux, tenant mieux compte des besoins des familles et desrègles de l'orientation et de l'ensoleillement qui s'imposent dans laconstruction des immeubles modernes. Elle souhaite que les nouvellesmaisons aient un aspect différent de façon à éviter la monotonie quidonnerait à ce nouveau quartier, qui est situé sur un emplacementadmirable, l'aspect d'une cité uniforme comme on en voit trop dans lenord de notre pays. (Ce rapport a été remis d M. le Maire de Lisieux, le 31 mai 1946, ainsi qu'aux services de la Reconstruction. Il a été soumis au Conseil municipal le 20 juin 1946.) * * * COMMISSION ADMINISTRATIVE de L'UNION LOCALE DE LA C. G. T. DE LISIEUX (Rapport établi le 9 Juillet 1946 concernant le projet d'aménagement des baraques Nissen du cantonnement, rue Fournet.) L'étude du plan du type A fait immédiatement apparaître l'établissementd'une cuisine et d'une salle à manger dans chaque logement, alors quedans les habitations « à bon marché » il ne pouvait être prévu qu'unesalle commune. M. GUESPIN donne satisfaction aux désirsexprimés depuis de très nombreuses années par les travailleurs quivoudraient pouvoir disposer d'une cuisine et d'une salle à mangerindépendantes. Nous le félicitons de cette marque de compréhension deslégitimes aspirations des travailleurs. Malheureusement, la disposition des baraques ne permet pas d'aménagerl'intérieur de façon pratique, c'est ainsi que la cuisine se trouveséparée de la salle à manger par un couloir long de 8 mètres, ce quiest excessif. Peut-être pourrait-on aménager en cuisine la chambreattenante à la salle à manger. Elle serait plus vaste que celle qui pstprévue et les habitants pourraient prendre, quand ils le désireraientleurs repas dans cette pièce. La cuisine actuellement prévue seraitaménagée en chambre au cas où la forme extérieure des baraques lepermettrait. La porte d'entrée prise sur le pignon pourrait êtresupprimée et reportée en façade donnant ainsi directement sur lecouloir. On n'aurait plus besoin de traverser la salle à manger pour serendre au couloir qui dessert les autres pièces. Cette nouvelledisposition serait certainement bien accueillie. Le type B est moins confortable puisqu'il n'est envisagé qu'une sallecommune et trois chambres. L'idée d'une, cuisine n'est pas retenue maisil est possible de loger une famille nombreuse. Quant au type C la création d'un logement supplémentaire ne semble pasheureuse car elle enlève une pièce à chaque logement contigu. D'autrepart, la salle commune est alors trop petite, la surface atteignant àpeine onze mètres carrés. Elle est en outre peu logeable, trois portesdonnant sur cette pièce et l'évier se trouve placé dans un coin sombre.L'unique chambre est vraiment de dimensions restreintes, le volumed'air dont disposerait le ménage qui l'habiterait ne serait que devingt-sept mètres cubes. S'il y a nécessité de trouver un nombre plus élevé de logements, ilpourrait être prévu une baraque à quatre logements ce qui permettraitde conserver trois bâtiments à deux logements qui seraient relativementconfortables. Les salles communes d'extrémité et la chambre qui leurest contigüe formerait un logement, les W.-C. et le cabinet de toiletteétant reportée à l'emplacement du couloir qui disparaîtrait. La ditechambre pourrait être agrandie au détriment de la salle commune dansles mêmes conditions que sur le plan du type A. Les deux logements ducentre disposeraient alors d'une chambre facile à meubler. Les W.-C. etle cabinet de toilette seraient reportés dans le couloir quidisparaîtrait en partie et la salle commune se trouverait agrandie. Laporte de la chambre donnerait sur la partie du couloir qui seraitconservée, le cabinet de toilette serait ainsi à proximité de lachambre. Telles sont les suggestions que l'Union Locale de la C. G. T. deLisieux croit devoir apporter au projet d'aménagement des baraques ducantonnement de la rue Fournet. Elle n'ignore pas les difficultésd'aménagement de bâtiments qui n'ont pas été conçus pour êtrecompartimentés en logements, mais elle demande qu'il soit tenu compte,dans la mesure du possible, du confort et des règles de l'hygièneauxquels tout être humain peut aujourd'hui prétendre. * * * RAPPORT sur le plan d'extension et d'aménagement de LISIEUX Septembre 1946 Rapport sur le plan d'extensionet d'aménagement de Lisieux exposé au public dans une salle du collègede Jeunes Filles en septembre 1946. La Commission administrative de l'Union Locale de la C. G. T., aprèsavoir pris connaissance du plan d'extension et d'aménagement de Lisieuxainsi que du rapport justificatif et du programme d'aménagement établispar M. CAMELOT, estime qu'il est de son devoir de faire connaître lesobjections, les critiques et les suggestions qu'elle apporte à ce plandans l'intérêt général de notre cité et de ses habitants. M. CAMELOT a établi le plan d'extension en envisageant une villesusceptible de devenir une agglomération de vingt-cinq mille habitants.Nous estimons que ce chiffre est insuffisant. Nous devons voir plusgrand, tout en nous gardant de toute prétention et de touteexagération. Ne renouvelons pas l'erreur qui a été commise par nosancêtres qui nous ont légué après plusieurs extensions successives uneville ne s'étendant que sur deux cent vingt-cinq hectares. Cetteexiguïté territoriale a nui dans le passé au développement normal denotre cité. Le plan prévoit que le territoire de Lisieux sera porté àtrois cent vingt-cinq hectares. Nous estimons que cette étendue seratrop restreinte, car, dans l'avenir, notre ville devrait pouvoirs'étendre librement sur son propre territoire. N'oublions pas que Lisieux qui est la deuxième ville du Calvados estsusceptible de prendre après sa reconstruction, une extension rapide.Cette extension devrait même être encouragée pour le plus grand profitde tous les habitants de notre agglomération. La meilleure clientèlepour le commerce est celle qui vit à demeure puisqu'elle fait vivre parses achats divers et ses dépenses régulières la majorité descommerçants. Il ne saurait, naturellement, être question de négligerl'industrie hôtelière et touristique que nous serions heureux de voirde plus en plus prospère. L'étude du plan d'aménagement de Lisieux fait apparaître desimperfections et des erreurs. Nous n'apporterons aucune critiquesystématique, mais on doit reconnaître que toute œuvre humaine estperfectible. C'est ainsi que la rue du Capitaine-Vié qui est étroite et dont lesconditions d’orientation et d'ensoleillement sont mauvaises estmaintenue dans son état actuel. La rue du Hommet qui se trouvait dansles mêmes conditions sera rétablie sur son ancien tracé. Il en sera demême pour la rue d'Ouville et pour la rue Marie-de-Besneray. Nousaurions vu avec plaisir l'axe des rues nouvelles former un angle aussigrand que possible avec la ligne est-ouest. Lors de la création devilles nouvelles ou de l'aménagement et de l'extension de celles quiexistent, les urbanistes s'efforcent toujours d'éviter cette erreur. Ilsuffit pour s'en convaincre d'étudier les plans des villes construitesen tenant compte des règles d'urbanisme, pour constater que lesurbanistes n'envisagent qu'exceptionnellement la création d'artèress'approchant sensiblement de la ligne est-ouest qui est la moinsfavorable à l'ensoleillement. Les rues du centre de la ville, qui étaient pour la plupart malorientées, ont été prévues avec une largeur moindre que celles de lapériphérie sous le prétexte que les rues commerçantes doivent avoir unelargeur modérée. Nous pourrions citer de nombreux exemples quiinfirmeraient ces dires. Toutefois il n'est pas question de tomber dansl'exagération, comme cela s’est produit dans certaines villes desrégions dévastées après l'autre guerre. Cette disposition aura poureffet de réduire l'aération et l'ensoleillement des immeubles qui lesborderont. Les travailleurs qui y œuvreront en seront les principalesvictimes. Pour fermer la ceinture des boulevards extérieurs qui ont toute notreapprobation, nous aurions souhaité la création d'une avenue bordéed'une promenade plantée qui aurait relié directement la route d'Orbec àla dérivation prévue sur la nouvelle route de Paris. Cette voienouvelle, qui aurait été l'artère principale du quartier qui seraédifié ultérieurement sur la colline, aurait abouti à l'avenue de laBasilique en suivant approximativement les courbes de niveau. Plusieursvoies sont prévues à cet endroit mais la largeur de la chaussée estnettement insuffisante, et elles ne rejoignent pas la route de Paris.En bordure de cette avenue, à laquelle seraient venues aboutir desvoies de résidence, un jardin public, où les styles régulier etpaysager auraient trouvé place librement, aurait pu être créé, leterrain étant de très bonne qualité à cet endroit. De la terrasse de cejardin, les promeneurs auraient pu jouir d'un magnifique panorama surla ville et la plantureuse vallée de la Touques. Il est certain quedans l'avenir ce jardin aurait exercé un attrait sur nos visiteurscomme cela existe dans certaines villes de province où les jardinspublics sont donnés en exemple dans les guides touristiques. Ce vastejardin public aurait eu, pour la population lexovienne, l'avantage dese trouver à proximité du centre de la ville. Nous aurions vu avec plaisir le carrefour prévu à la jonction de la ruede Caen et de la rue Gustave-David reculé vers l'ouest sur le terrainde l'abbaye, où il aurait pris la forme d'une place à sens giratoireavec plateau, à laquelle la route de Dives serait venue aboutir enpente douce. De cette place giratoire, une artère aurait rejointdirectement le boulevard Sainte-Anne à la hauteur de la rue Rose-Harel. La partie du boulevard Sainte-Anne, comprise entre la rue Rose-Haret etla rue Gustave-David, sera bordée de jardins plantés d'arbres dans lebut de cacher l'usine à gaz. Il semble que des immeubles, construits aulieu et place de ces jardins, auraient permis de mieux dissimuler auregard les bâtiments indus triels appartenant à la Société Gaz et Eaux. Le maintien des dérivations de la Touques et de l'Orbiquet qui ne sejustifie pas, puisqu'il n'y aura plus d'usines dans le centre de laville, semble être une erreur. L'élargissement et l'approfondissementde ces deux rivières auraient permis d'abaisser le plan d'eau etd'éviter la menace des inondations qui pèse en permanence sur les basquartiers, tout en permettant la suppression des divers cours d'eauinsalubres qui sillonnent notre ville. Nous souhaitons que l'étenduetrop vaste, à notre avis, des jardins prévus aurait été mieux répartiedans les divers quartiers de la ville et nous aurions vu favorablementla création d'un square à proximité du nouveau théâtre. Un espace libre est prévu à l'emplacement de la gare des marchandisesqui sera déplacée. Etant donné l'importante surface qui sera renduedisponible, une voie de résidence aurait pu être tracée à proximité etparallèlement à l'Orbiquet. Dans l'espace relativement étroit, ainsidélimité, des villas isolées de style normand auraient pu êtreédifiées. Elles auraient caché l'arrière des maisons de la rue d'Orbecqui manquent d'esthétique. Un jardin planté d'arbres aurait punéanmoins être créé entre la nouvelle rue et la voie ferrée de la lignede Trouville. L'ensemble aurait composé un premier plan attrayant enavant de la basilique. Nous regrettons que des maisons soient prévues dans le quadrilatèreformé par la cathédrale Saint-Pierre, la place Thiers, la rueHenry-Chéron et la rue Olivier. Nous aurions préféré qu'un square soitcréé à cet emplacement. Il aurait mis pleinement en valeur ceremarquable édifice, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui et dont nousavions méconnu, en partie, la beauté avant la tourmente parce que nousne pouvions l'admirer dans son ensemble. Le square, abrité des vents dunord et- de l'est, aurait été fréquenté par les habitants du centre dela ville dès les premiers beaux jours printaniers. Les enfants auraientpu s'y ébattre hors des dangers de la rue. Les maisons construites surcet emplacement ne pouvant dépasser la hauteur de deux étages y comprisle rez-de-chaussée, il s'ensuit que les commerçants qui habiteront cesimmeubles ne pourront disposer que d'un logement restreint. Les maisonsqui leur feront face de l'autre côté de la rue Henry-Chéron, n'étantpas frappées des mêmes servitudes, seront plus élevées. Il en résulteraun manque d'esthétique regrettable. D'autre part, la vue d'ensemble dela cathédrale, apparaissant aux touristes qui emprunteront la rueHenry-Chéron, pour traverser notre cité, aurait pour effet de lesinciter à s'arrêter pour visiter ce chef-d’œuvre d'art gothique et lecommerce local y trouverait son profit. Nous nous élevons également contre la diminution envisagée de la place Thiers, côté ouest. C'est avec surprise que nous avons vu que la place Victor-Hugo n'étaitpas prolongée directement et dans toute sa largeur jusqu'au rond-pointde l'avenue de la Basilique et que le rétrécissement, qui existaitavant les événements de juin 1944 à son point de jonction avec la rueHenry-Chéron, était maintenu, cachant ainsi le transept de lacathédrale qui formerait un fond superbe à cette place lorsqu'onviendrait du Carmel. L'emplacement prévu pour la piscine dans le jardin de l'anciennesous-préfecture est bien choisi, mais la théorie qui veut que lesétablissements de bains en plein air soient situés en amont des villesoù l'eau est plus pure ne se trouve pas respectée. Dans ce cas, ilexiste un magnifique emplacement au pied du mont Cassin, formant unsite naturel à deux cents mètres en amont de l'établissement de bainsde l'Ondine. L’école Jean-Macé, l'école maternelle et la crèche ne seront pasreconstruites en bordure de la voie publique, mais à l'intérieur decertains îlots. Nous espérons que ces îlots seront largement ouverts,de façon à laisser l'air y pénétrer en abondance. La gare routière sera reconstruite à proximité de la gare de laS.N.C.F. Il nous semble qu'il eût été préférable de la construire auxenvirons de la place de la République ou du boulevard Sainte-Anne, àproximité des boulevards circulaires. Cet emplacement aurait eul'avantage d'amener les voyageurs au cœur de notre cité. Il se seraitcréé autour d'elle une activité commerciale. La gare de la S.N.C.F.étant un autre pôle d'attraction, il se serait établi, entre ces deuxgares, un important mouvement de voyageurs dont auraient profité lesmaisons de commerce qui, tôt ou tard, s'établiront dans les rues quimèneront de la gare au centre de la ville. Par ailleurs, les carsauraient continué à desservir la gare des chemins de fer pour assurerles correspondances. Nous approuvons le maintien des places Victor-Hugo, Gambetta et de laRépublique, mais nous estimons qu'une de- ces trois places devraitavoir une importante surface par rapport aux deux autres. Ainsi, ilserait possible aux établissements de spectacles de passage des'installer convenablement. Des foires ou des expositions pourraients'y tenir. La rue du Docteur-Lesigne n'aura que neuf mètres de large, alors que larue d'Honfleur, qui la prolonge, en aura dix-huit. Il s'agit là d'uneanomalie qui semble difficile à justifier. Le séchage du linge est interdit dans les cours et les jardins visiblesdes voies publiques et privées, ainsi que des propriétés voisines.Cette dernière restriction ne va pas faire sourire les ménagères qui sedemanderont avec inquiétude où il leur sera permis d'étendre le linge. Une autre restriction, qui ne sera pas bien accueillie, a trait àl'interdiction des faux pans de bois sur les façades. Ce genre dedécoration est très employé dans notre région pour les constructions destyle normand et a de nombreux admirateurs. Que les dessinsfantaisistes soient interdits, cela ne saurait soulever aucuneobjection, mais, lorsque les faux pans de bois respectent l'ordonnancedes pans de bois véritables, nous estimons que c'est une erreur de lesinterdire. La Commission Administrative de l'Union Locale de la C. G. T., aprèsavoir fait connaître les principales critiques qu'elle apporte au pland'extension et d'aménagement de Lisieux, se plaît à reconnaître que leplan qui est présenté au public comprend de nombreuses dispositions quirecevront l'approbation générale. Elle espère que les objectionsjudicieuses qui ne manqueront pas d'être formulées en envisageantl'intérêt général, par des personnes qualifiées ou par lesreprésentants d'organisations locales, seront retenues. Le pland'extension et de reconstruction de Lisieux deviendrait ainsi une œuvrecollective, matérialisant le désir que nous avons de voir notre citémeurtrie se relever de ses ruines et redevenir prospère et animée entoutes saisons. (Ce rapport, adopté le 9 septembre 1946 par la Commission Administrative de l'Union Locale de la C.G.T. de Lisieux, a été remis le 11 septembre 1946 à M. Maxime Chéron, commissaire-enquêteur au Plan. A ce rapport était joint celui qui a été adopté le 18 mars 1946 par la Commission administrative et qui est reproduit pages 4 et suivantes.) * * * Lisieux, le 21 décembre 1946. Monsieur le Maire, Comme suite à la réunion de la Commission d'information du 20 décembrecourant, nous avons l'honneur de vous informer que l'examen sommairedes plans des immeubles du boulevard Sainte-Anne, qui nous ont étéprésentés par M. CAMELOT, nous a amenés à formuler demultiples remarques concernant l'architecture de ces immeubles. Lesdispositions intérieures semblent avoir été conçues en tenant compte demeilleures conditions de salubrité, d'hygiène et d'aménagement que l'onpuisse concevoir. Toutefois, nous donnons cette appréciation sousréserve, car il n'est pas possible de donner une approbation définitiveconcernant des plans sur lesquels nous n'avons pu nous pencher quequelques minutes. Nous regrettons qu'une réglementation impose trop strictement auxarchitectes des limites à leurs conceptions personnelles. C'est ainsique nous sommes d'accord avec M. CAMELOT pourreconnaître que les pièces, hormis- les salles communes, ne sont pasassez grandes. Le ministère de la Reconstruction aurait imposé cesrestrictions de surface par mesure d'économie. Nous estimons qu'il acommis une erreur, l'augmentation de la surfaces des dites pièces deplusieurs mètres carrés seulement aurait augmenté grandementl'habitabilité sans entraîner une augmentation sensible du coût de cesimmeubles. On ne doit pas oublier que de nombreuses générations sesuccéderont dans ces logements et que la population provinciale, qui nevit pas de la même façon qu'à Paris, aura beaucoup de mal à s'adapter àl'exiguïté des logements prévus. Par ailleurs, nous regrettons qu'on persiste à concevoir, dans notrepays, l'aménagement des immeubles selon les principes adoptés enAmérique. Depuis environ vingt-cinq ans, on n'envisage plus qu'unevaste salle commune qui a toujours été imposée pour les constructionseffectuées par les offices des habitations à bon marché. Cetteconception n'a jamais été approuvée en province. Pour s'en convaincre,il suffit de se rendre dans ces immeubles et de constater que cettepièce a été souvent coupée ultérieurement en deux par l'élévation d'unecloison, lorsque les dispositions de cette pièce l'ont permis. Desarchitectes et des entrepreneurs bien avisés avaient même prévu cettetransformation ultérieure, d'accord avec les propriétaires, en donnantdes dimensions et une disposition spéciale à la salle commune. Nousnous faisons l'interprète de la population ouvrière lexovienne qui nemanquera pas de s'élever contre cette conception imposée par lesrèglements. Nous espérons même avoir l'assentiment des autres classessociales. En effet, chacun de nous souhaite pouvoir prendre ses repasen famille dans une cuisine qui serait plus vaste que celle qui estprévue et réserver une pièce qui pourrait être plus petite que la sallecommune et que la ménagère aurait à cœur de conserver constammentpropre et coquette. Dans le cas prévu, le mobilier de la salle à mangerne trouvera sa place que dans la salle commune où il subira les effetsdes buées de la cuisine et sera voué aux coups de pieds et aux mainsgrasses des petits enfants. Si l'on veut que la mère de famille seplaise à son foyer, on doit lui donner la possibilité de recevoir dansune pièce avenante et bien à elle, alors que ce n'est pas le caslorsqu'il s'agit d'une salle commune où elle doit se livrer à diverstravaux qui amènent le désordre à certaines heures de la journée. En nous adressant à vous, Monsieur le Maire, nous parlons en même tempsà un Conseiller de la République. Etant donné que vous serez sans douteappelé à légiférer sur des questions de cet ordre, nous estimons qu'ilest de notre devoir d'attirer votre attention sur l'importance de ceproblème d'ordre social autant que financier. Je me permets de vous informer de mon intervention à la réunion de laCommission d'information, qui s'est tenue hier, en ce qui concerne laprotection et la mise en valeur des monuments historiques et desvestiges du passé, hélas peu nombreux, qui ont échappé au désastre.Ainsi que nous vous en avons informé à plusieurs reprises, nousdésirons que ces monuments soient mis en valeur dans un cadre deverdure. Nous serions heureux que le Conseil municipal étudie de prèsce problème et intervienne auprès des services compétents dans lamesure de ses moyens. Nous avons posé une question à ce sujet à M. CAMELOT,qui a dissipé nos craintes en ce qui concerne le bâtiment industrielqui est édifié en ce moment auprès de la tour Lambert. Ainsi, nouspourrions suppléer par la qualité et la présentation de ces monuments àl'importance et à la variété des édifices que nous pouvions présenterautrefois à nos visiteurs. Il appartiendrait ensuite au Syndicatd'Initiative d'intervenir, avec preuves à l'appui, pour obtenir lemaintien de la place importante que notre cité occupait dans les guidestouristiques pour le plus grand profit de notre commerce loyal, et nouspourrions ajouter, maintenant, de nos finances municipales. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments respectueux. Pour la Commission Administrative: REBOURSIÈRE. * * * Extrait du rapport présenté au Congrès de l'Union Locale, le 9 février 1947, par le camarade Reboursière. … La presse nous a permis, en outre, de porter à la connaissance del'opinion publique l’action que la Commission Administrative a menéependant toute l'année 1946 en faveur de la reconstruction et del'avenir de notre cité. Les journaux locaux ont publié notamment unrapport que nous avons établi en mars 1946 et que nous avons transmisaux autorités locales ainsi qu'aux services de la reconstruction. Etantdonné son importance, ce rapport n'a pu être inséré dans un mêmenuméro. C'est regrettable, car il perdait une partie de son attrait enprenant le caractère d'un roman-feuilleton. Néanmoins, il est appelé àrester dans les archives des journaux, que ne manqueront pas deconsulter, ultérieurement, les historiens locaux qui y trouveront ainsiune preuve de notre activité. Lors de l'enquête publique concernant le plan de reconstruction deLisieux, nous avons tenu à faire entendre la voix de la C.G.T. Enconséquence, nous avons établi un nouveau rapport qui a été déposé le11 septembre 1946 et auquel nous avons joint une copie de celui qui aété publié dans la presse locale, Ce document prouvera aux générationsqui nous succéderont que nous avions pensé à elles lorsque nous noussommes penchés sur le plan de reconstruction de notre malheureuse cité.Nous avons conscience d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoirpour faire connaître les aspirations de la classe ouvrière lexovienneet pour défendre ses intérêts. Tant que l'œuvre de reconstruction ne sera pas achevée, nous aurons ledevoir d'intervenir avec force pour que les intérêts des travailleursne soient pas sacrifiés au bénéfice d'autres catégories de citoyens. Lareconstruction de Lisieux doit être l'œuvre de tous et la voix de laclasse ouvrière doit être entendue. Les travailleurs devront disposerde logements sains, ensoleillés et confortables. Dans un régime deprogrès social, le confort ne doit pas rester l'apanage des classespossédantes. Et, pourtant, on n'admet pas encore qu'un travailleurpuisse disposer d'une salle à manger séparée, que la mère de familleaurait à cœur de tenir propre et coquette. Les Pouvoirs publicsmaintiennent le principe de la salle commune et les chambres prévuessur les plans déjà établis sont de dimensions restreintes. Nos dirigeants ne devraient pas oublier qu’on ne vit pas en provincecomme à Paris. En effet, le Parisien vit beaucoup en dehors de chezlui, alors qu'ici on préfère, le plus souvent, passer la majeure partiedes heures de repos au foyer familial. On nous parle toujours du retourde la femme au foyer et, pour cela, il faudrait donner au chef defamille la possibilité de subvenir seul aux besoins des siens. Eh bien! si l'on veut sincèrement que la mère de famille ait plaisir à vivre àson foyer, il faut lui procurer un logement agréable ; il faut admettrequ'une pièce séparée devrait être prévue- dans chaque logement où ellepourrait installer les meubles qui lui sont chers et qui échapperaientainsi aux buées de la cuisine et aux dégâts causés par les petitsenfants. De plus, les chambres devraient être suffisamment grandes pourque la ménagère puisse les aménager à son goût. On allègue que ce sontdes questions de crédit qui obligent à prévoir les appartements plusrestreints. Lorsque l'on envisage de reconstruire des immeubles où denombreuses générations se succéderont, nous estimons que le droit aubien-être des habitants doit primer toute considération passagèred'ordre financier. Les gouvernements, qui savent toujours trouver del'argent pour faire la guerre, devraient mettre autant d'empressementpour assurer le financement des œuvres de paix. Il appartient à la C.G.T. d'intervenir avec force contre les projets decertains architectes d'avant-garde qui, prenant prétexte du coût élevéde la construction, n'envisagent qu'une pièce unique de grandedimension par logement. D'autres prévoient une vaste salle commune àlaquelle seraient adjointes des chambres qui ne seraient guère plusgrandes que des alcôves et dans lesquelles seraient installés des litssuperposés pour les enfants. Nous ne devons pas revoir des taudismodernes dans des immeubles s'apparentant aux casernes. On oublie, tropsouvent, pour ne pas l'avoir consulté, que le travailleur normandpréfère une petite maison accompagnée d'un jardin où ses enfantspeuvent s'ébattre à leur aise, hors des dangers de la rue. Toutefois,il est normal que des immeubles de plusieurs étages soient construitsdans le centre de la ville. Il sera ainsi possible de donnersatisfaction aux personnes qui préfèrent habiter en étage. Notre action ne s'arrêtera pas aux immeubles à reconstruire : nousaurons à envisager à nouveau les questions d'urbanisme sous leursdifférents aspects ; nous aurons également à veiller sur laconservation et la mise en valeur des monuments qui ont échappé audésastre. Il est regrettable que nous ayons dû intervenir, le 20 décembredernier, à la Commission d'information du Conseil municipal, pourprotester contre la réédification, actuellement en cours d'exécution,d'un bâtiment industriel contigu à la tour Lambert. Nous devronsprotéger les vieilles maisons de bois qui rappelleront aux touristes leLisieux d'autrefois. Il appartiendra à chacun de vous d'intervenir auprès de vos camaradespour les engager à apporter à votre Commission administrative toutessuggestions, toutes critiques ou toutes informations qu'ils jugeraientutiles et qui intéresseraient la reconstruction de notre cité, que nousvoudrions accueillante, prospère et animée en toutes saisons. _____________________________ Conformément à la décision prise par le congrès de l'Union Locale le 9 février 1947, nous avons informé l'opinion publique du travail accompli par la Commission. Administrative au cours de l'année 1946, qui fera date dans l'histoire de notre cité. Il appartient maintenant au lecteur de juger notre action en toute conscience et d'en tirer les conclusions qu'il lui plaira. Nous terminons par un appel qui, nous l'espérons, sera entendu : « LEXOVIENNES, LEXOVIENS, « Lorsque nous noustrouvons placés, à des titres différents, devant les problèmes poséspar la reconstruction de notre malheureuse cité, le devoir nouscommande de faire taire, en chacun de nous, l'intérêt personnel pourenvisager uniquement l'intérêt général de notre agglomération. Pour laparfaite réalisation de cette œuvre commune, soyons fraternellementunis comme nous le fûmes pendant la période tragique du 6 juin au 23 août 1944.Ainsi, nous honorerons la mémoire de nos concitoyens disparus au coursde la bataille de Normandie et de tous ceux qui sont morts pour quevive la France. » Le Bureau de la Commission Administrative de l'Union Locale de la C.G.T. de Lisieux. Lisieux, le 17 février 1947. |