Corps
| GIRAUDOUX, Jean (1882-1944): Berlin.- Paris : Emile-Paul, 1932.- 68 p.-1 f. de pl.en front. ; 21 cm.- (Ceinture du monde; 13). Saisie du texte : S. Pestel pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (15.I.2015) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la médiathèque (Bm Lx: nc) BERLIN PAR Jean GIRAUDOUX ~ * ~ 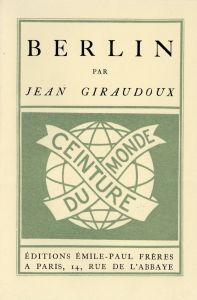 BERLIN n’estplus la capitale de la Prusse. Elle a passé ce rôle àPostdam. Berlin est la capitale de l’Allemagne. L’Allemagne est un empire qui comptait voilà douze ans encore unecinquantaine d’États et une cinquantaine de capitales. Chaque capitale,dans ses mœurs, ses monuments, ses projets même, était le dépôt vivantd’un passé, l’aboutissement, plus ou moins heureux, d’une civilisationspéciale. Les cinquante passés de l’Allemagne concouraient tous, chacundans son uniforme, à cette réussite tardive qu’était l’Allemagneimpériale. Enfin, vers 1910, le moyen âge réalisait, au centre del’Europe, sa seule construction réussie. Dans une Allemagne qui, pourla première fois depuis les origines, pouvait vivre cinquante ans sansêtre un champ de pillage et de bataille pour Allemands ou invités, laHanse domina enfin les mers, les corporations régirent le commerce etl’industrie universels, et l’empereur, le monde. Aux moindres jours defête, on voyait à peine l’Allemagne de 1900 sous les oriflammes et cesmêmes drapeaux qui ne flottaient jadis que sur les couronnementsd’Othon ou de Frédéric. Si ce magnifique édifice s’effondra, c’est queceux qui étaient chargés de le défendre en étaient justement lesarchitectes les moins modernes, et qu’au lieu de faire la guerre à unecoalition démocratique, l’état-major allemand la fit à Louis XIV, àÉlisabeth, ou à la marine hollandaise. Turenne fut peut-être vaincu àCharleroi, Ruyters au Skagerak, mais la stratégie impériale s’égaradans ces luttes avec de grands généraux et de grands amiraux déjà tuésdepuis des siècles. Une odeur insupportable d’anachronisme empesta unjour l’Allemagne ; la victoire qu’on lui présentait, elle-même, avaitun visage tellement périmé et conventionnel de victoire que sesattraits en étaient émoussés. Quand un champion du monde a soudain lesentiment, au milieu même du match décisif, qu’il retarde, quel’agriculture, le cinéma, la lecture ont plus d’intérêt que la boxe,que les coups que l’on reçoit font mal, que ceux que l’on donne partentde l’épaule et non de l’âme, la fin du combat est proche. Ce jour vintbientôt, et l’on sait comment, après de tristes expériences, le peupleallemand se confia enfin, à défaut de grand homme, à quelques grandesvilles. Il essaya la plupart de ses anciennes capitales, toujours déçu,car ni Weimar, ni Francfort, ni Munich ne purent tirer de leur passéépuisé le moindre renseignement ou le moindre excitant. Pas une seulequi se révélât être autre chose qu’un monument déjà tout fait auxmorts, à l’empire mort, à l’Allemand mort. Une seule ville subsistaitque n’occupaient ni les ennemis, ni les spectres, habitants plusdétestés encore, car ils sont encore moins profitables au commerce. Parbonheur, c’était la plus grande, la plus riche, la mieux située :Berlin. * * * Rarement les grandes villes ont travaillé de connivence avec les grandshommes. Il y a toujours eu entre la capitale déjà existante et lesouverain de génie une concurrence qu’ils n’ont pu tous deux supporterque péniblement. Ils se sont tirés généralement de ce problème enfaisant lit à part ; Philippe, Louis et Frédéric ne voulurent coucherqu’à l’Escurial, à Versailles ou à Potsdam. Quelquefois aussi, dans undésir de libération plus complète, le roi ou la reine construisirenteux-mêmes leur ville, Pierre le Grand ou Sémiramis. C’est sans douteque leurs missions sont différentes, et souvent incompatibles, celle dela ville étant une mission sociale, celle du souverain une missiond’État. Si la situation n’était pas fausse entre Berlin et GuillaumeII, c’est que Guillaume II était médiocre, et surtout que Berlin étaitjeune. La réputation de Berlin, parmi ses sœurs allemandes, étaitbeaucoup moins celle de la ville impériale décrite par les touristes,que celle d’une métropole à peine adulte et fortement inconsciente. Lesautres villes ne jugeaient pas qu’elle méritât sa suprême dignité.D’une population mêlée, – on dit encore que tous les Berlinois viennentde Breslau, – modifiée chaque année dans sa physionomie et ses contoursde protozoaire par l’immigration, abandonnant aux israélites ladirection de ses plaisirs et la confection de sa morale, il semblaitque ce fût pour l’hygiène générale du Reich qu’elle était ainsi isoléeau milieu du Brandebourg et des forêts de pins. Toutes ses qualitésétaient contradictoires ; elle était occupée militairement à la foispar les socialistes et les Hohenzollern ; elle était la ville la pluspeuplée et celle où il y avait le moins de naissances ; elle était lerefuge de la bourgeoisie intransigeante, et la première place luirevenait aussi dans le monde pour les crimes, stupres et suicides. Lafin de la guerre arriva. Certains peuples vaincus aiment se donner àcette ivresse de la défaite, qui dépasse en acuité tout autre genre depassion et de liberté. L’Allemand se refusa ces joies pures. Il préférase suicider provisoirement, couper provisoirement sa tête, renoncerprovisoirement à la plupart des facultés dont il était depuis trenteans si fier. Dès lors avec entêtement il déclina son droit de dire unmot dans les occupations politiques, financières, ou morales, jusqu’aujour où il croirait son âme d’Allemand à nouveau valable et sa têterepoussée. Il confia à des spécialistes, à des syndics de faillite, quin’engageaient pas sa responsabilité, le soin des traités de paix ou desaccords de Bourse. Il se creva les yeux, ces yeux qui avaient vu lavictoire et la domination. Il rendit insensibles ces papilles qu’avaitdélectées la plus grande saveur, celle du triomphe d’une race. Tous cessens de gloire qu’il avait uniquement nourris pendant dix lustres, illes aveugla ou les mura. Mais il lui restait à trouver les nouveauxsens de sa nouvelle existence. Il préféra s’en remettre, pour celaaussi, aux spécialistes, à la spécialiste de l’inconscience, del’irresponsabilité, à Berlin. Peut-être Berlin saurait-elle trouver,mieux que la nation défaillante, les raisons et les lois d’un nouvelétat de choses provisoire, et c’est ainsi que toute l’Allemagne futsuspendue pour un temps, non plus à la volonté d’un chancelier ou d’unprince, mais à la vie instinctive d’une cité. * * * Pas de passé : Berlin est plat. On a vainement essayé d’accumulerl’histoire sur cette plaine. Les colonnes de la Victoire, les monumentsaux généraux n’ont l’air que de presse-papiers sur une feuilled’ailleurs depuis longtemps envolée. Pas de différence d’altitude entreles lits et les cabinets de travail d’aucun Berlinois. La même fuite degaz décimerait la ville. Si j’excepte le Kreuzberg, qui forme à l’estune montagne d’une dizaine de mètres, Berlin ne compte ni descente nimontée, et, au lieu de l’apercevoir dans son ensemble d’un sommetsacré, comme Paris ou Rome, le voyageur ne peut la contempler que desjardins-terrasses des hôtels ou du restaurant de la tour métallique,que d’un établissement de plaisir, et en musique. Toutes ces nappes demystique ou d’émotion qui s’accumulent, à défaut de pétrole, dans lescités à replis et à pentes, Berlin en est terriblement privé. Il n’apas de lieu saint. Il faut aller chercher jusqu’aux premières collinesdu petit Wannsee, à quinze kilomètres, le premier coin de terresanctifié, le bois de sapins où Kleist se tua avec un fusil de chasse.Les traces de la reine Louise, si nettes dès que l’on arrive à laPfaueninsel, n’ont marqué ni dans les rues ni dans les palais. Cellesd’Hoffmann ne se retrouvent qu’au-dessous de ce parfait niveau, dansles caves d’un restaurant, et rien n’y trahit non plus que c’est laville où Jules Laforgue vécut le plus long paragraphe de sa courte vie.L’aventure, dans l’air sec de Berlin, se dilue aussitôt, au lieu de secondenser et de s’éterniser en épisode. Rien ne semble y rester del’aventure même de Guillaume II. Aucun nom de rue n’a changé, aucunestatue impériale n’a perdu une lettre ou un doigt, l’allée desKurfürsten victorieux subsiste dans le même marbre éternellement blancqui nous fut fourni aussi pour l’escalier de notre Palais de justice,mais alors que dans Versailles ou dans Neuschwannstein il n’est pas unsalon, un coin de jardin, un seul arbre qui ne paraisse attendre LouisXIV ou Louis II, et que le retour de ces fantômes reste la loi et lesens des palais, pas un seul signe qui soit fait, par les monumentsqu’il éleva lui-même, à l’empereur vivant. On a l’impression que lavraie raison de ce séjour forcené qu’il fit quarante ans à Berlin étaitsa future absence. Elle est complète. De cette ville militaire quedécrit justement Laforgue, rien ne demeure, ni l’aspect, ni le silence,ni le bruit. Le schutzmann grand, maigre, souriant, agitant constammentses bras de gestes dégingandés, semble l’épouvantail chargé de mettreen fuite tous les uniformes. Sur ces trottoirs où l’on n’entendaitjadis, en fermant les yeux, que le bruit du sabre contre le macadam, etaussi celui de son propre cœur, légèrement pris d’angoisse, tous lespassants appuient maintenant d’un poids qu’ils n’essayent pasd’accentuer, d’une démarche que ne raidit pas, tous les cinq mètres, larencontre des hommes les plus droits et les plus raides qu’avaitproduits l’humanité. L’horaire de la ville entière n’est plusdicté par les allées et venues de celui qui sortait plusrégulièrement et plus impitoyablement de son palais que les personnagesde bois des horloges, dans les capitales du Sud. La faim, la soif, lesrepas, ne sont plus des soifs impériales, des repas impériaux. Lapromenade Unter den Linden, tendue en chemin de table entre les objetsde surtout que sont les palais du Kaiser Franz Joseph platz et leBrandeburger Tor, a trouvé enfin son sens, qui n’était pas d’offrirdeux fois par jour son sable jaune aux sabots du cheval impérial, maisde favoriser la vente des journaux du soir, des lacets, et des boîtesd’allumettes, sans parler d’une concurrence plus directe à laTauentzienstrasse. Si rares sont les uniformes que le passage d’uneescouade de la Reichswehr, élégante, sobre, et convaincue, nous laissele même sentiment que celui d’une espèce particulière de pompiers etque la guerre vous apparaît soudain pour la première fois comme un malcivil, un mal républicain. Les marins, qui prirent la garde à laprésidence le jour anniversaire de la destruction de la flotte par seschefs, ont aussi, comme tous les matelots, un costume presqueinternational, et les partisans de la bannière d’Empire qui circulentles jours de fête dans leurs autocars pavoisés ont l’air de grandsboy-scouts, momentanément privés de leur petite pupille, la jeuneRépublique. Ce serait mentir que prétendre qu’il ne se forme pas entreles passants, aux portes des passages, à l’orée du Tiergarten, devantles glaces des magasins, des vides incolores : les places réservées endes temps meilleurs aux officiers géants de la garde ; mais cesimaginations sont dissoutes aussitôt, et l’on doit bien constater quela couleur est aujourd’hui donnée aux squares et aux ponts sacrés desrues non plus par des uniformes d’officiers, mais, débordantes deskiosques, par les fleurs. Du passé plus ancien, les meilleures volontés n’ont pu faire une villeancienne. La signification même du mot Berlin reste mystérieuse, et ilfaut qu’elle le soit, car tous les séminaires allemands de philologie,selon leur spécialité, ont tenté vainement d’y chercher un noyau latinou wende. Il est désespérant de penser que l’unique problème que laphilologie allemande n’ait pas encore résolu soit celui-là. L’ours quela ville porte dans ses armes, la paire de châteaux d’été, Bellevue etMonbijou perdus dans le parc ou le quartier de la Bourse, l’Auberge dela Noix, et les quelques rues sans grand caractère de l’officiel VieuxBerlin (Vieux Berlin est d’ailleurs la plus récente appellation de cequartier) ne peuvent offrir le moindre contrepoids à la ville neuve,pas plus que les mœurs et les habitudes des vieux Berlinois nepouvaient influer sur les élans de la masse sans passé à laquellel’Allemagne confiait avec quelque mépris le soin, puisque sa vieraisonnable et nationale était pour quelque temps éteinte, d’assurer savie instinctive. Ajoutons que cette masse sans passé, au début de 1926, comprenait déjàquatre millions six cent mille Berlinois, et que ce chiffre a augmentéd’un million à peu près. C’est la plus grande cohorte d’hommes qui sesoit un beau jour et en une minute, trouvée libérée de la politique, dela guerre, et des habitudes, devant le seul problème de la vie. * * * Elle n’eut pas recours, comme on l’a dit, aux plaisirs. Il ne faut pas connaître la nuit de Madrid ou de Lisbonne, pour parlerdes plaisirs nocturnes berlinois. Alors qu’en Espagne la vie dans lanuit est la vie dans un autre corps, dans une autre logique, selond’autres règles du bonheur ou de la gravitation, et que la nuit même,ombre ou reflet, est la dose la plus nécessaire du mélange, la noceberlinoise est aussi diurne par essence que la maison de passe ou lebeuglant. Pendant l’été, d’ailleurs, la nuit touche à peine Berlin,ville du Nord. La nuit espagnole vous concentre et vous élève dansvotre propre sexe. La nuit berlinoise vous dilue, vous noie, vousabaisse : c’est simplement la noce. Tous les bars, aujourd’hui un peudélaissés, de Charlottenbourg et de Wilmersdorf, sont comme les bars àla mode des autres capitales, les derniers salons, et le snobisme yrègne plus encore que le vice. Ils sont pleins, comme à Paris ou àNew-York, d’hôtes et de visiteurs qui tiennent surtout à être appeléspar leur nom par des habitués de club. Le soin même avec lequel chaqueétablissement spécialise sa vertu, masculine ou féminine, laissequelque doute sur sa franchise. « Silhouette », « Casanova », et autresboîtes, contiennent peut-être des exemplaires intéressants de la fauneberlinoise, mais c’est un jardin zoologique au milieu de la junglemême. Que sont les quelques adolescents vêtus en femmes duKurfürstendamm à côté des cinquante mille hommes qui tiennent de lapolice berlinoise, par cartes, le droit d’exercer leur métier deprostituées, et que l’on coudoie sous leurs robes et leurs petitschapeaux à la mode, sans soupçonner leur sexe, dans tous les grandsmagasins où les attirent maroquinerie et lingerie ? Bal des couples nonrichtig, bal des femmes sœurs, c’est le genre de spectacle, accentué àl’allemande, que toute capitale offre aux membres des commissionsinternationales de désarmement et aux voyageurs de marque. Il n’a mêmepas l’intérêt de cette mode, déjà périmée, des danseuses nues, quiamenait voilà six ans, sur chaque estrade des thés-tangos, à cinqheures de l’après-midi, l’élite, sans costume, des dactylographes etdes demoiselles de magasin. Les Allemands n’ont jamais rapproché, etmoins que tout autre peuple, la notion de joie et la notion deprostitution. La joie berlinoise c’est celle de la foule, quand ellemange son gepökeltes Fleisch et ses Eisbeine non fumés dans le HausVaterland, dont chaque salon donne sur le panorama d’une provincegermanique, sur le Tyrol où de vrais Tyroliens visent un chamoisréduit, sur la plaine du Rhin où éclate un vrai orage, avec le vinspécial à chacune des variétés de ces tendresses nationales. La noceallemande, c’est celle des employés de commerce et des petits banquierschez Rési, donc chaque table possède un téléphone et un tubepneumatique qui lui permet d’appeler par lettre ou à la voix les femmesdes autres tables, généralement avec des considérations sévères pourl’homme qui les accompagne, ou d’entretenir, sans se dévoiler, mais detoute son âme, un débat passionné avec une âme sœur du fond de lasalle, jeune fille à chaperon rouge cerclé de mica dont la famillerespecte pudiquement le don soudain et total à un inconnu. Il est douxaussi de téléphoner à vos voisines, directes, sans même les regarder,en recevant leur voix même de l’oreille gauche, et leur voix detéléphone de l’oreille droite. Elles résistent mal à cet homme quiparle, non à elles, mais à leur symbole et à leur statue, et à ce duoqui vient de la même bouche. C’est dans ces salles, et dans les balspopulaires, et dans les concerts champêtres du soir, et dans lesconcerts de cinq heures et demie du matin qui amènent à Luna Park et auZoo une humanité sensible à l’aurore, que se retrouve vraiment la tramedes sentiments de cette ville, que l’abandon berlinois, lademi-tristesse et la double gaieté berlinoises, la demi-hardiesse et lademi-timidité, colorent chaque femme comme une projection qui parfoisl’entoure d’une marge, ou parfois, au contraire, lui laisse une bordurede peau fraîche, et que les grandes individualités citadines,schutzmann, homme au cigare, souteneur à sourcils noirs joints par unraccord de sourcils blonds, se précisent dans leur omnipotence, surtoutlorsque chacun, comme l’autre jour, doit porter successivement auvestiaire, d’un air réprobateur, la même femme étourdie de vin et devolupté entre ses bras. Quant à ce composé de misère, de drogue,d’esclavage et de suprême liberté qui est l’élixir d’une métropole,c’est tout à l’opposé de Wilmersdorf, c’est au delà de l’Alexanderplatzqu’il se vend, dans la suite des bars que commande le Mexico. De mêmeque notre préfet de police laisse ouverts toute la nuit un certainnombre de cafés sur les routes qui mènent aux Halles, dans ce quartierde Berlin où rien ne se rassemble et rien ne se vend, lesétablissements tolérés jalonnent un itinéraire de Halles humaines dignede toute misère. Pas d’ersatz dans cette catégorie. Pas d’apparat, jeparle de l’apparat d’ignominie ou de malpropreté donts’enorgueillissent les quartiers analogues des autres villes.L’Allemand déchu ne semble pas avoir besoin de décor pour sa déchéance: il est soigneusement tenu, son maintien est correct, sa chemise etses vêtements propres. Il n’a pas l’air, comme chez nous, d’êtreterriblement occupé par un vice, mais d’être terriblement libre dessoucis et des liens où s’empêtrent les autres hommes. Le Latin, dans lepire vice, a un passé et un avenir de vice ; il y a une gradation danssa révolte ou sa découverte. Il fait un pécule de vice, il a un bas delaine de vanités et d’orgueils invertis. Il y prend des grades.L’Allemand est, au contraire, dès qu’il l’a quittée, soustrait de façonabsolue à cette gravitation sentimentale qui manœuvre encore, chez nousou en Angleterre, les maréchaux de la liberté. Quand un de cesAllemands corrects qui pullulent entre la Frieden et la Kaiserstrasserépond à celui qui lui demande ce qu’il fait : qu’il est libre, cela neveut pas dire qu’il est libre pour une promenade d’une heure, ou pourla nuit, ou pour boire sa bière, ou pour faire sa piqûre, mais qu’ilest libre pour demain, et pour la vie entière, et pour être riche etpour être pauvre, pour être assassin ou bourgeois, mâle ou femelle.chaque visiteur arrive en créateur dans ces limbes où, dans uneétonnante tranquillité de bureau de placement, patientent les larvesles plus détachées de l’humanité qu’on puisse obtenir sans le secoursde l’opium et de l’imagination. L’homosexualité n’a rien à voir dans cenéant et dans cet hermaphroditisme, car l’homosexualité, mais jeprouverai cela une autre fois, n’est d’habitude en Allemagne qu’unproduit de la Gemüthlichkeit elle-même, et le contraire d’uneperversion… Qu’y a-t-il donc de neuf et d’instructif dans Berlin, puisque lesplaisirs nous échappent ? NOTA. – Jules Laforgue décrivait ainsi lesplaisirs de Berlin, dansl’hiver 1882 : « Berlin, qui est encore une petite ville avec un centreunique et unesociété fonctionnant régulièrement, a quatre bals fixes par hiver : leSubscriptionsball, – bal de l’Opéra – où se montre la cour ; leCavalierball, dans les salles du Kaiserhof, – disons l’hôtelContinental, – où se trouvent deux fois par an « les cercles les plusexclusifs de la capitale, les messieurs et les dames de la plus hautenoblesse » ; le bal de la Presse dans le jardin vitré du Central-hôtelet le bal des Artistes Dramatiques. » * * * Il y a d’abord ce qui suffisait complètement au premier couple, commebonheur suprême : les jardins. Berlin n’est pas une ville de jardins, c’est un jardin. Tous lesdescendants du couple primitif ne sont pas édéniques : Berlin compte272.900 infirmes de paix, 63.000 infirmes de guerre, 115.000 enfantsmal nés, 600.000 chômeurs au moins, mais c’est un jardin. En France, la présence d’un Français habituel, – je ne parle même pasd’un Français architecte ou entrepreneur – déshonore un paysage qui estnaturellement beau et prêt à accepter, comme il l’a prouvé, toutes lesbeautés artificielles. En Allemagne, la présence de l’homme, sa maison,embellit un affreux paysage. Il n’est pas d’invention moderne dont lenom en France, – gare, tramway, garage, usine électrique – n’éveillel’idée de quartiers souillés, prostitués à jamais ; les mots gaz,vapeur, électricité, s’allient au contraire en Allemagne avec les motsqu’on n’emploie chez nous que pour les parcs et les jardins. Il n’estpas une station, une façade de dépôts de marchandises, une imprimeriede journaux, qu’on n’ait la possibilité de photographier avec, aupremier plan, des arbres et des fleurs. Pas une ville ne possède plusde tramways que Berlin, mais ils roulent entre des arbres et sur dugazon. Tout départ de Paris, toute arrivée à Paris, serre le cœur.Impossible d’atteindre ou de quitter la cité dite du luxe sanstraverser une épouvantable zone de misère, la cité des arts sans quetout ce qu’une municipalité irresponsable peut amasser en mauvais goût,en petitesse de conception et en bassesse d’exécution n’accable vosyeux pendant des lieues, la cité de la liberté sans avoir à contempler,du dernier champ de blé de la Brie au Louvre, sans aucunerafraîchissante interruption, les preuves du déterminisme le plushideux et le plus humiliant pour l’homme qu’une interprétation erronéede la vie moderne ait pu créer. Le mot banlieue, qui est le mot le plusprometteur et le plus allégrement riche de la langue allemande, estdans la nôtre le terme le plus terrible des vocabulaires de laideur etde deuils. Berlin était vaincu, ruiné, sans passé d’urbanisme, aumilieu d’une lande et de marais. Paris était riche, victorieux ; pas undes dessins réalisés en lui par nos rois, ou nos empereurs, qui ne putse continuer et s’enrichir à travers une province bordée de châteaux etde parcs. Dans le premier, une rivière noire, un chenal. Dans le secondun beau fleuve semé d’îles, de méandres, des pentes. Cette marche versl’eau pure qui est la loi de toute civilisation, pour l’individu commepour l’État, elle était déjà presque accomplie pour le Parisien dutemps de Flaubert ou de Maupassant. Que reste-t-il aujourd’hui de cesmerveilleux avantages ? Un no man’s land, mais surpeuplé, où tous lesbeaux monuments de l’avenir, écoles, bibliothèques, hôpitaux, sont desbaraques, un fleuve aux rives chauves, sans reflets, sans cils, dontl’eau n’est que boue, dont les îles n’éveillent plus que l’idée decrassiers, le droit conféré aux édiles, parce qu’ils accumulent soinset tendresse sur le bégonia des Tuileries, ou le fuchsia du Luxembourg,de faire à dix lieues à la ronde une chasse organisée à tout ce qui estarbre, végétal, et de combler de ciment armé chacun des cubes d’airencore pur qui devraient être classés avant tout monument historique.Paris n’est plus qu’une sorte de piège, de nasse, dont ne peut sortirqu’avec des ruses celui qui a cédé à ses appats, ou la plus belledémonstration de congestion humaine. Pas un de ses organes futurs quine soit voué déjà à l’atrophie. Personne n’a voulu y comprendre que laville future, ce n’était ni le Carrousel, ni l’Arc de Triomphe, maisIssy-les-Moulineaux, Asnières ou Pantin, et que le sort de Parisdépendait du sort, de l’aisance, ou du bonheur, des habitudes ou de lavie instinctive de chaque habitant de ces faubourgs. Le surplus de seshabitants, Paris le rejette autour de lui comme le surplus de sesdéchets, dans des champs d’épandage, où s’accentue sous toutes sesformes la condition d’esclavage de l’ouvrier et de l’employé. Les seulsespaces libres prévus y sont les cimetières, dont la superficie dépassepresque dans Paris même la superficie des jardins. Honneur à la villequi prévoit plus d’oxygène pour ses morts que pour ses enfants ! Sur une plaine plus plate qu’un miroir et à laquelle le reflet directdes saisons peut seul prêter du charme, Berlin, au contraire, mordd’une mâchoire de platine. Le dernier champ de seigle ou de pomme deterre brandebourgeois touche sans intervalle à la cité modèle la plushardie et la plus élégante, aux rhododendrons et aux géraniums. Lesmurs de Berlin sont ces citadelles aux murs colorés, où le moindrelogement ouvrier comporte ses baignoires, son téléphone, et quedoubleront l’année suivante les nouvelles courtines de cités ou devillas n’emprisonnant que les peupliers, les pins, et les oiseaux prisau passage. Tout ce modelage de la Patrie qu’une génération vaincue nepeut plus se permettre, elle l’a remplacé, en attendant mieux, par lemodelage de sa maison. Toutes les débauches d’architecture et de décorurbain qu’un roi victorieux osait seul autrefois, ce pays vaincu se lesoffre, par la victoire qu’il a remportée sur soi-même en se dévouant àsa vie démocratique et urbaine, son seul avenir aujourd’hui. Unecohorte d’architectes de talent, Peter Behrens, Erick Mendelshon, HansPoelzig, Max Taut ont trouvé au cœur de Berlin ce que nos architectesn’ont trouvé qu’au Maroc, dans le sable et la brousse : l’espace, latenue, la liberté. Des rues immenses, où jamais un encombrement ne vousarrête, et que double, pour aller au Wannsee, une autostrade, vouslivrent une ville ouverte, aérée, et dont les immenses monumentspublics, même imparfaits, semblent en tout cas inspirés parl’architecture modèle du futur et non du passé. L’armée, c’est unequestion de casernes, disait un général allemand qui avait fait de sonquartier un quartier modèle, avec bibliothèque et piscines, et de soncorps un corps d’élite. La nation, dit maintenant l’homme d’Étatallemand, c’est une question d’urbanisme. Sur ce point, Berlin a méritéla délégation que lui avait donnée l’Allemagne. Un peuple composéd’individus qui ont l’aisance de leurs gestes, aura aussi, tôt ou tard,l’aisance de sa civilisation. Tout le Berlin nouveau, de Lichterfeld àGrünewald, est une ville de bains, sans sources particulières, un portde plaisance sans la mer, mais cette notion de vacances qui est écraséepour le bourgeois français entre les chaleurs de juillet et les pluiesde septembre, s’y épand dans chaque journée, dans chaque heure, et lerepos y a trois fois par jour l’agrément de la richesse, du loisir, et– nous sommes en 1930 – d’on ne sait quelle victoire. * * * C’est donc bien par conscience, après avoir goûté cet air nouveau, quej’ai revu les parcs de l’ancienne ville. Au jardin Zoologique aussi, ce qui s’appelle la cage au Jardin desPlantes s’appelle la maison. Il y a la maison des petits carnassiers,que son étiquette indique avoir été construite en 1866, après Sadowa,celle des grands carnassiers qui l’a été en 1871, après Sedan, et ilserait facile de trouver à la base du Palais des singes ou des oiseaux,quelque concordance politique ou musicale aussi symbolique. Mais lesanimaux, malgré cette flatterie, meurent presque aussi vite à Berlinqu’à Paris. Alors que dans l’Aquarium voisin j’ai retrouvé dessalamandres, des carpes et jusqu’à des soles géantes que j’avais vuesavant guerre, je n’ai reconnu au Jardin Zoologique que les petitesfilles et les statues, les premières bien moins nombreuses, car lanatalité de Berlin est la plus basse d’Europe, mais portant toujours,dans son expression la plus tendre, cette gaieté et ce blond de Prussequi sont le charme des rues berlinoises. Les statues ont doublé. Larevanche sur les Belges a été obtenue par un Mannekenpiss triplé, carl’eau s’échappe aussi des deux tortues que l’enfant nu porte souschaque bras. Devant les tigresses, la statue de celui qui connaît lemieux les insectes africains, dans le couloir des oiseaux, celle, bieninattendue et en bois sculpté, de Caliban. Mais tout ce qui m’yattirait y demeure encore. Il y a encore sur les boîtes à bascule dessinges, où le public offre des noix ou des oranges, les inscriptionspar lesquelles les singes vous indiquent la meilleure méthode pouractiver la rotation de la boîte et vous remercient respectueusement. Lejeune rhinocéros a toujours son ballon. Les bois plantés au milieu dela cour des cerfs pour qu’ils se grattent ou broutillent, ont toujoursla forme de vrais bois de cerfs. Tous ces animaux qu’on n’a jamais vusqu’uniques ou solitaires, panthère noire, okapis, y sont là par couples; et j’entends à nouveau, je ne l’ai jamais entendu que dans cetteenceinte, le cri du gnou. Des pensionnats de petites filles assiègentles cages, avec leur album et leur crayon, où elles dessinent en cubesla tigresse et en lignes souples l’éléphant ; et j’ai même la joie,dans la grande volière, de découvrir Simon Bussy, qui, plus heureux quel’oiseau de paradis et la pie mordorée, ses modèles, répand autour delui, grâce à ses pastels, une poussière colorée, de leur couleur. Mais la perfection même des animaux qu’ils rassemblent donne à tous lesjardins zoologiques une ressemblance qui les prive d’originalité, et jedois dire que ce qui me manque aujourd’hui, et pour la première foisdans Berlin, pour relever la vertu classique des fauves, des singes, oudes oiseaux, ce sont les uniformes, jadis si fréquents. Ce lieu étaitle seul où les lions pouvaient croire que les hommes habituels étaientplus beaux que les dompteurs. Les êtres humains n’y ont plus pour eux,désormais, que l’attrait de la chair. Dans les parcs du vieux Berlin ouvrier, Humboldt Hain, Friedrich Hain,se retrouvent au contraire les plus vieilles couleurs berlinoises, lerose et le blond. Les promeneuses, loin des quartiers d’immigration,ont repris la vraie race de la ville, leurs jambes longues, leur nezcourt, et la courte chaussette. Les promeneurs sont à nouveau les vieuxbourgeois en digestion, ornés de toutes les inventions modernes quifacilitent la promenade, boutons pour suspendre le chapeau, pochette àjournal tenant par pression au parapluie, et de tout ce qu’a puproduire en ce genre l’Erfinderschule. Les restes de l’Allemagneidyllique subsistent sous forme de Puits à légendes, de landes et dehautes fougères bordées par les rhododendrons, et d’innombrables bacs àoiseaux supportés par des crapauds ou des lézards de pierre pour queles oiseaux ne se croient pas tenus de rien devoir aux hommes. Sur lesbancs, les joueurs de cartes continuent à jouer à cheval, le nombre desfemmes en petite voiture continue aussi à y dépasser – la guerre n’apas réussi à changer la proportion –, le nombre de petites voiturespour hommes, et le même petit garçon accroupi, vêtu de sa chemise et deson pantalon, y cueille encore dans les endroits défendus lespâquerettes et les boutons d’or. Les nourrices forment rituellementleur triangle fatidique face au ventre vierge de la Diane chasseresseou à la tête géante de Frédéric le Grand, dont le fait d’être grandsemble seul avoir motivé, par antithèse, sa présence parmi tant depetits, tandis qu’un père énorme, endormi par fraude dans le parc ausable des enfants, est escaladé par eux de toutes parts, comme leTibre. Aux portes, les mêmes marchandes vendent les fleurs et leslégumes, que tous les Berlinois savent appartenir, contrairement auxParisiens, au même monde végétal ; et il est rare qu’un cimetière nesoit pas tout près du jardin public amenant enfin au terme extrême deleur rêverie ou de leur logique les promeneurs adultes. Des cimetièresdiscrets, clos de brique, semés pour les morts des inscriptionsinverses à celles que la police affiche dans la rue pour les vivants :Reposez doucement… N’ayez pas peur, nous ne laisserons pas dérober vosfleurs…, tout ce qui peut, en somme, régulariser le trafic des morts etles rassurer contre les entreprises des nécrophiles assez nombreux cethiver. La haine des voleurs de fleurs surtout s’exprime violemment, parles pancartes accrochées, les tessons cassés qui défendent le haut desmurs, et, sous les regards sévères des gardiens, je sentais soudainentre mes vêtements et ma chair se presser toutes les roses et tous lesseringats des morts. Peu de monuments. Pas d’effigie humaine. La grandestèle de marbre noir reflète par contre le visiteur vivant tout entier,portant sur la face qui domine le défunt la longue inscriptionofficielle de ses titres et vertus, et sur la face muette une brèveinscription officieuse, parfois un simple mot, pour signaler aupassant, comme un secret caché au mort, qu’il était irremplaçable,inégalable, ou mari sublime. L’emplacement de chaque tombe est diviséle plus souvent en deux parts : l’une sur laquelle est le Grabhügel,petite colline oblongue assez haute, façonnée de glaise, de gazon et defleurs, et l’autre où est fiché, face à la petite colline, le banc oula chaise de fer de famille, avec un nom dont je n’ai jamais pudistinguer s’il était celui du mort ou du parent le plus assidu. Avecles innombrables rossignols dans les peupliers et les tilleuls,avec les innombrables vers de Schiller – car pas un vers de ce poètequi ne puisse orner davantage encore un cadavre qu’un corps vivant –gravés sur chaque pierre, avec les épitaphes de petits bourgeoisfonctionnaires ou officiers dont tous les noms sont prussiens oufrançais (car d’immenses cimetières juifs avec coupoles et mausolées,au nord et à l’est, font la rafle de tous les noms de professeurs ou debanquiers), ces enclos vous offrent à peu près tout ce qui reste del’ancienne et paisible vie de Berlin. * * * Il y a ensuite pour tout Berlinois, ce que l’Amérique elle-même ne peutprocurer qu’à quelques Américains privilégiés : la vie physique. Ce qui surprend le plus à Berlin, c’est la joie avec laquelle sontaccueillies les saisons et leurs phénomènes. En France, on redoutel’hiver à cause du froid, l’été à cause de la chaleur, et tout ce qu’ilpeut y avoir d’extrême dans le climat est considéré comme une calamité.La population de Berlin, au contraire, se rue sur le gel et la caniculecomme sur le plus rare des plaisirs, car l’hiver amène la neige, le gelet leurs sports, l’été le bain en plein air, et toute saison le soleil.Il n’est pas d’itinéraire qui ne mène une fois par jour le Berlinois àun bain ouvert ou couvert, à la nudité, au contact avec l’eau, à laconfrontation avec la lumière. Paris est la patrie du pêcheur à laligne ; la plupart des riverains de la Seine n’ont touché leur rivièreque par ses poissons ; leur amour pour elle consiste surtout, aux moislicites, à l’asperger de vers de vase et d’asticots ; ils en préfèrentles courbes où dégorgent les égouts, préférées par le gardon, et ilsn’offrent guère au soleil du dimanche, sous leur faux panama rabattu,qu’un nez qu’ils ramènent rubescent et douloureux. Jamais il n’est venuà l’idée de la municipalité parisienne de classer les rives de sesfleuves, et de voir en elles les bords d’un bain municipal magnifiqueet gratuit. A part le contingent des Parisiens et Parisiennesadultères, le Français, pour se déshabiller, réclame l’isolement etl’obscurité d’un confessionnal, et la vue de fesses nues ne lui inspirequ’une pensée, aller vers elles sur la pointe des pieds et leur donnerplaisamment une paire de gifles. Le but du petit bourgeois et du petitemployé parisien semble être seulement, en laissant son ventres’arrondir, ses bajoues grossir, de diminuer la proportion de sonsquelette, sa vraie raison, pourtant, par rapport à sa chair. Sa vraiepeau est le tissu Rasurel, dans lequel il étreint sa femme, dans lequelnaissent ses enfants, et rien ne ressemble plus à l’écorchage d’unlapin, à la recherche d’un insecte, ou à la danse d’un satirerhumatisant, que la façon dont il enlève ses culottes, dans lecontre-jour des falaises d’Étretat, quand un snobisme de quartier lepousse enfin accroupi vers les flots. Pour le Berlinois, au contraire,l’eau et le soleil sont devenus des aliments nécessaires, et lesbrasseries, les restaurations jadis combles de graisse humaine sevident peu à peu au profit de leur concurrence : le sable de la Havelet l’air des pins. Ce soin du corps que certains Français pratiquent en secret comme sic’était une besogne superstitieuse et égoïste, les dirigeants allemandsont tout fait pour lui donner au contraire un aspect de salut public etnational. Tous les environs de Berlin ont été organisés pour cettereligion. Pas un bois qui ne contienne sa colonie de bains de lumière.Pas un des nombreux lacs que forme la Havel entre Berlin et Potsdamdont la plage ne soit aménagée plus largement et commodément que laplage de Deauville. Tous les après-midi de printemps et d’été, Berlinse rue vers Wannsee. Depuis cette année, le vieil établissement a étéremplacé par quatre édifices modèles de brique jaune, collés au ras dela colline, coiffés tous quatre par une terrasse de cinq cents mètresde long, que coupent les escaliers géants et que débordent lesparterres. Trente mille baigneurs, les jours de fête, s’installent pourla journée sur la plage, toute découpée à la lisière même des flots parles broderies que creusent dans le sable les innombrables enfants nus,dentelle à la fois d’eau, de rivage, et d’enfance. Ce n’est passeulement le bain qui les attire, l’heure du bain, comme à la Baule ouà Long Island, c’est la vie étendue. Toutes les innombrables façonsdont l’être humain cache sa figure dans la terre, ouvre ses jambes,livre ses aisselles, lance du ras du sol ses regards vers l’intrus quil’enjambe, tous les croisements chastes opérés entre membres humains,tous les contacts les plus forcés des couleurs humaines rehaussées desplus hardies couleurs de l’aniline, s’offrent là, chaque métier gardantdans son costume de bain ou son slip son geste rituel, le ménage dubistro accoudé, la femme légère remuant l’orteil, une série de refletsindiquant çà et là les monocles et les gens du monde, parfois une tribude corps exposés à têtes invisibles dont regardent et respirent lesseuls nombrils, chaque épouse, monstrueuse ou maigre, s’ouvrant sanspudeur de son véritable écart, une abondance de chemises blanches àjours et à festons ajourant et festonnant des gorges et des cuissesgéantes, les égoïstes se protégeant dans leur sommeil par un bourreletde sable, les altruistes vous effleurant d’un mollet velu, autour duphonographe les jeunes filles et les jeunes gens en caleçon formant uneétoile de mer immobile, mais qui scande la musique des talons relevés,ceux qui mangent les saucisses au contraire les pieds réunis vers lepanier du centre, cependant que les adolescents parcourent ces hectaresde chair en sautant comme des parasites, et que s’élève à chaqueminute, production parfaite de cet amas, vouée par sa naissance même àla disparition dans le lac, un modèle de corps humain qui gravit laplanche et qui plonge. Chaque race reforme naturellement un des tableaux idylliques del’humanité. Au Maroc, la campagne est semée de fuites en Égypte. Dansle village français, c’est Joseph, le menuisier et son enfant. EnAllemagne, et surtout dans cette vie des lacs et des forêts, c’est Adamet Ève. Ils sont là tous deux sous toutes leurs formes, sous toutesleurs vraies formes ; pas un des replis de chair, des poils défaits,frisés ou ondulés, des genoux couleur pêche ou couleur brugnon, descoudes coiffés de cal ou de rose, prêtés par Cranach, Dürer ou Boecklinau couple primitif, qu’il ne soit donné de retrouver cent fois parheure sur ces plages. Je sais maintenant ce que faisaient Adam et Ève ;ils mangeaient, ils s’étendaient, ils s’accroupissaient, ils dormaient.Ils ne lisaient pas, car il est rare qu’un livre apparaisse entre tantde mains nues et oisives, et la jeune femme qui lit accoudée, son romanprotégé du soleil par le peignoir, a l’air de trahir et de boire à unesource d’ombre. On n’a même plus recours aux journaux pour protéger lestêtes, comme dans les bains publics où voilà cinq ou six ans encore lescorps tannés retirés de l’eau et du temps vous offraient comme visageun carré de papier pâle criblé de toutes les nouvelles du jour. Lesvisages aussi, avec les nez, joues, langues et oreilles sont donnésmaintenant au soleil qui tire de chacun sa grimace suprême. Parfois uneondée ; personne ne bouge, et il éclôt seulement çà et là, un parasolde papier chinois ou, unique revanche de l’antique Allemagne, uneombrelle de soie rouge bordée de losanges mauves eux-mêmes dentelésalternativement de jaune et de topaze. * * * L’esprit théorique allemand n’eût pas mérité sa gloire s’il n’étaitpassé de cette passion de nudité au nu complet. Wannsee n’est quel’antichambre des colonies où tout maillot est proscrit. Elles sontnombreuses. Elles recrutent avec le zèle des sociétés militairesd’autrefois et vous donnent une carte d’adhérent dont la teneur semblecopiée sur les cartes des gymnastes d’avant guerre, vous « enrôlantdans les cohortes de la lumière ». Leurs journaux illustrés tapissenttous les kiosques de la ville, exposant en première page, pour que lesentiment familial berlinois en soit gagné, les photographies nues dela mère et de sa grande fille, du frère et de ses cinq sœurs.Lichterfeld, dans Berlin même, compte déjà plusieurs enclos,particulièrement réservés aux familles, avec guignol et brasserie – ladame du guignol, sous ses rideaux, est nue, – mais les vraies coloniessont distribuées dans les environs à ces distances types où le citadinse sent libéré de la ville, à la hauteur des premières cathédrales deprovince, vers Zossen ou vers Fürstenberg. Là, plus de démonstration,plus de propagande. On ne vous y montre pas, comme à Lichterfeld, lesplus belles scènes de l’antiquité, telles qu’elles furent, le rapt desSabines, le combat des Horaces, ou ce qu’auraient été, dans la nudité,les plus belles scènes de l’histoire du monde, Napoléon à Weimar,sainte Thérèse dans son couvent. On n’y mime pas, comme à KleinWannsee, les plus beaux vers de Gœthe, « Elle le tira à demi à lui ; iltomba à demi vers elle ; c’en était fait de lui », ou, dans *Hermann etDorothée* « Il éleva l’aimée, elle tomba doucement sur ses épaules » defaçon à bien prouver aux adeptes que la nudité est la pensée dernièredu poète et que ses idées-forces sont bien des êtres nus, – toutesscènes troublées parfois par l’irruption d’oiseaux ou de chiens loups,terriblement habillés. Dans les grands domaines semés de landes et delacs, ce n’est plus, au contraire, qu’une paraphrase des tableaux deHans von Marées, de nageurs et de nageuses, de femmes nues sur chevalsans brides, de jeux de foot-ball et de longs repos en commun, lescorps brunis se déplaçant tous, par habitude, insensiblement, suivantle mouvement du soleil, leur seul maître. La vie oisive va mieux à lanudité que tous les attirails de civilisation, paniers à tapisserie,fers électriques à repasser, et travaux à aiguille, dont s’encombrentles dames de Lichterfeld ; et la pression des jarretelles, desbretelles, des lacets laisse moins de trace aussi dans ces régions.Rarement la beauté, mais il arrive quelquefois que toutes les malfaçonsparticulières, boutons, eczéma, grains et callosités deviennentinvisibles au bénéfice d’une beauté générale de la secte, et qu’onimagine une race blanche atteignant enfin à la perfection naturelle dela race noire ; privés du coton, de la laine et de la soie, tous cescorps sont bien obligés de se vêtir de calme, de tranquillité, demutisme ; lorsque tous les couples déposés par l’autocar qui ont gravi,habillés et agités, le chemin de la forêt où sont leurs tentes,redescendent nus vers le lac, ils semblent seulement avoir renoncé àleurs brouilles et à leurs tics, et l’atmosphère aussi est purifiée,car elle ne résonne plus, pour la première fois dans les âges modernes,de toux, de crachats et d’éternuements. * * * Telle est la mission du Berlin nouveau, que masque encore la paradesavamment offerte, mais d’ailleurs bien vieillie, de sa vieintellectuelle et artistique : la culture d’un bacille humain toutspécialement résistant et provisoirement amoral. S’il doit servir devaccin, s’il doit être au contraire un jour poussé à la virulence,c’est une question réservée, mais j’ai scrupule à vous décrire lareprésentation du Christophe Colombde Claudel ou de l’IphigénieenTauride, lorsque je ne peux m’empêcher de voir, à travers ces somptueuxtransparents du théâtre allemand sur lesquels des hommesparticulièrement vêtus sont poussés, par la moindre parole et lamoindre pensée, à des gesticulations et des résolutions frénétiques,les corps nus des Berlinois étendus par centaines de milliers dans lesjardins ou sur les plages, immobiles, volontairement sourds à tout cequi n’est pas le soleil, et qui semblent, profitant de cet oubli parlequel ils furent saisis voilà douze ans, faire un stage de force et desanté dans un autre univers.  retour tabledes auteurs et des anonymes |

