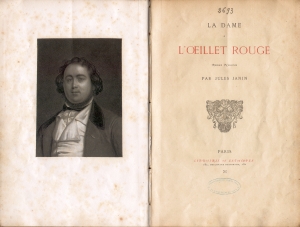JULES JANIN écrivait ce petit roman,
LA DAME A L'ŒILLET ROUGE, en sesdernières heures de travail, où plutôt en ses dernières heures dedistraction. C'est un petit chef-d’œuvre que nous donnons ici avec toutle luxe qu'il aimait à voir dans les livres. Après le roman, nous avons réimprimé les pages émues de M. ArsèneHoussaye sur celui qu'il appelle « le miracle du lundi et lerayonnement de tous les jours. » A la première page, nous avons voulu représenter le Janin de lajeunesse, par ce portrait déjà ancien, qui est le plus vrai de tous lesJanin.
LA DAME
A
L'ŒILLET ROUGE
I
I
L y avait déjà six mois que M. de Frémiet, second avocat général,était assis sur le banc des enquêtes, parmi messieurs les gens du roi,attendant quelque belle occasion de montrer qu'il était éloquent, justeet courageux, lorsqu'un matin on vint lui dire qu'une jeune fille, uneinconnue, sollicitait son audience.
Le secrétaire du jeune magistrat lui dit que la dame était fort belleet qu'elle voulait expliquer elle-même sa cause à l'avocat général.
— Vous dites qu'elle est belle ?
— Belle comme le jour ! Un miracle de grâce et de distinction...
— Je ne veux pas la voir.
— Des yeux bleus couleur du temps...
— Fermez la porte !
— Et un sourire divin.
— Dites-lui qu'une audience est impossible ! Il n'est pas bon que lejuge et la plaideuse, surtout lorsqu'elle est jeune, soient en présence; il me suffira d'avoir sous les yeux les pièces du procès, quej'étudierai avec la plus grande sollicitude.
Vous voyez que le jeune homme était à l'école austère de Daguesseau.Dieu soit loué ! mais ces belles ardeurs ne durent guère ; le magistrats'humanise, et, si la plaideuse est belle, en effet, les portes lesplus difficiles s'ouvrent à son commandement.
Eh bien, non, la dame revint peu de jours après, avec sa suivante quiportait péniblement, dans un sac de procureur, les pièces d'un grosprocès qui durait depuis plus de trente années, ayant été commencéquelques dix ans avant sa naissance. Elle avait écrit, d’une main trèsnette et dans une langue irréprochable, l'excellence de sa cause, etcomment, de la perte ou du gain de son procès, dépendait toute safortune.
Elle était orpheline, et n'avait pour dot que ce domaine en litige, aubeau milieu de la Normandie, où les terres sont si belles et les procèssi longs.
A cette seconde démarche, la jeune déshéritée ne fut pas plus heureusequ'à la première. Le secrétaire eut beau la représenter plus belleencore, l'avocat général fut stoïque dans son devoir. Pressentait-ilqu'il perdrait, en la voyant, toute la force et toute la vertu de saconscience ?
La dame se résigna. Elle prit dans son sein un billet où elle exprimaitson regret de ne pouvoir être entendue : car elle avait prévu que laporte ne s'ouvrirait pas. Elle donna le billet avec les pièces duprocès, après quoi elle s'en alla pour ne plus revenir.
C'était un vendredi, un treize, un jour d'hiver. M. de Frémietdécacheta la lettre.
Une suave odeur de jeunesse et de résignation s'en échappait, ce quidonna fort à réfléchir à M. de Frémiet.
Comme il ne voulait pas commencer cette grande entreprise un vendrediet le treizième jour du mois, il attendit un moment favorable.
Le lendemain, il ouvrit le sac où toutes les pièces étaient contenues.C'était un vrai monceau de documents, qui aurait fait reculer lepraticien le plus intrépide.
« Ah ! mon Dieu, se disait le jeune magistrat, comment faire et mereconnaître en ces
Abîmes ? »
Cependant il ne perdit pas courage, et, quand il eut mis tout en belordre : assignations, citations, jugements, sentences, témoignages,oppositions, appels, confrontations des parties et tout le détail decette procédure à l'infini, un certain jour apparut dans cesparchemins, dont l'encre avait déjà perdu sa couleur primitive : ô lesmalheureux plaideurs, sitôt qu'ils sont tombés dans ces embûchessignalées par tous les grands magistrats de la France !
Ainsi songeait M. de Frémiet ; mais c'était un esprit tenace, unevolonté singulière ; ajoutez qu'il était tout rempli de la passion deslois romaines, et qu'il savait par cœur la Coutume de Normandie, étant lui-même un peu Normand par madame sa mère, qui étaitla petite-fille d'un président au parlement de Rouen, où le jeuneCorneille avait fait ses premières armes, quand il était amoureux de labelle Mélite. En ces grandes et sévères difficultés de la justice, lepremier point est de s'y plaire, et le premier bonheur est decomprendre. Il ne fallut pas plus de six mois au jeune magistrat pourdeviner le point de droit, et, plus il se sentait avancer dansl'inconnu, plus il s'attachait à la tâche acceptée.
Il est vrai qu'il trouvait assez souvent sur sa table de travail le nomde la jeune plaideuse, Adèle de Villetardieu. Elle était impatiente, évidemment, d'arriver aumaître jour où toute justice lui serait rendue, et c'est pourquoi elleajoutait à son nom, tantôt la recommandation de quelque famillehonorable, il est vrai, mais sans crédit, et tantôt une humble prièreoù se montraient l'espérance et l'estime méritées par un si jeunemagistrat.
A la fin, notre avocat général fut le maître absolu de cette procéduresi compliquée. Il la possédait tout entière ; il voyait les embûches,les obstacles, les mensonges, les tours et les détours de ce déni légalde toute espèce de justice. Et, quand M. le premier président duparlement de Paris déclara que tel jour il entendrait les deux parties,le jeune rapporteur se trouva prêt.
Nous avons dit qu'il s'agissait d'un grand procès. Autant mademoisellede Villetardieu était abandonnée à ses propres forces, autant ses plusproches parents, qui la voulaient dépouiller de toute sa fortune,étaient nombreux et protégés par des influences considérables. C'étaitl'usage alors que les parties vinssent attendre au palais de Justiceles magistrats dont leurs destinées dépendaient, et leur fissent ungrand salut lorsque ces messieurs montaient sur leurs sièges. Du côtéde mademoiselle de Villetardieu, il n'y avait personne. Il y avait unevingtaine d'hommes et de femmes du côté de la partie adverse : un ducet pair, un abbé commanditaire, une abbesse de l'ordre de Cîteaux, etplusieurs cordons-bleus qui faisaient cortège à cette injuste cause etmêlaient leurs respects aux sollicitations dont elle était entourée.Alors commencèrent les plaidoiries de part et d'autre.
Mademoiselle de Villetardieu avait eu grand'peine à rencontrer dans lesdétours du Palais un avocat très connu, mais très honnête homme, quidevait répondre à l'attaque intrépide, à la parole toute-puissante duplus illustre avocat de son temps, maître Nicolas Gerbier.
Les plaidoiries n'employèrent pas moins de huit jours, et ce fut desdeux côtés un effort incroyable à qui soulèverait une plus grandepoussière, chacun de ces deux maîtres de la parole amoncelant nuagessur nuages.
Plus les plaidoiries agrandissaient la cause hors de toute proportion,plus la Cour semblait hésitante ; tout le Palais était divisé, mais leshabiles et les retors les plus habitués aux grandes plaidoiriessemblaient à chaque instant déserter la cause de mademoiselle deVilletardieu. Et les mieux disposés la plaignaient déjà de n'avoir pasaccepté les arrangements que messieurs ses oncles et ses cousins luiavaient proposés.
— C'est fâcheux, disaient les uns, une si jeune personne abandonnée àses propres forces !
— Rassurez-vous, disaient les autres ; on lui laissera toujours une dotsuffisante à entrer dans le couvent des Dames de Saint-Augustin !
A la fin, les deux causes étant épuisées, le président donna la paroleà M. le rapporteur ; la voix du vieux magistrat était plus solennelleque de coutume, et ceux qui le connaissaient pour l'autorité de sajustice et la sûreté de son coup d'œil comprenaient qu'il auraitgrand'peine à prononcer cette inévitable condamnation.
Ce fut alors que le jeune rapporteur, s'emparant de la cause entière,et ne s'inquiétant guère des plaidoiries pour et contre, éclaira cechaos d'une lumière inespérée. Il expliqua les ténèbres ; il dévoilales perfidies ; il invoqua les morts dans leur tombeau ; il démontrales vrais motifs de cette injuste spoliation : « Que mademoiselle deVilletardieu ait rencontré dans sa propre maison si peu de sympathie,et que l'on voie au rang de ses adversaires les parents mêmes de samère et les sœurs de son père, un chevalier de Saint-Louis tué àDenain, sous les yeux du maréchal de Villars, voilà tout d'abord,Messieurs, ce qui nous étonne. Mais la Justice marche avec la Vérité. »Il arriva, en moins d'une heure, par une suite de filiation, à faire lalumière sur ce bien seigneurial. Le malheur était assez grand d'avoirperdu le seigneur sans déposséder l'héritière. Enfin il battait enbrèche toutes les fictions du droit féodal, qu'il appelait sans peur «le dernier de tous les droits. » Pensez donc à l'étonnement, j'aipresque dit à l'épouvante, de cet auditoire émerveillé ! Rarement lesvrais principes avaient apparu dans un éclat plus logique. Il semblaitque l'auditoire acceptât toutes les éloquences de l'avocat général.
Que vous dirai-je ? Séance tenante, nos seigneurs du Parlementdéboutaient et déboutèrent de leurs prétentions ces parents avides etsans pitié ; si bien que, la Cour de Paris brisant les motifs despremiers juges, mademoiselle de Villetardieu fut maintenue enpossession de ses domaines paternels.
Gerbier ne sut que répondre et s'inclina devant cet arrêt en robe rouge.
Pendant tout un mois, la ville et la Cour, le Parlement des provinceset quiconque, ou de près, ou de loin, tenait à l'administration de laJustice, s'entretinrent de cet arrêt mémorable. On disait dans cetemps-là :
Rigueur de Toulouse, humanité de Rouen, justice de Paris.
II
C
EPENDANT la belle plaideuse n'était pas venue pour remercier M. deFrémiet. Il l'attendait bien un peu ; mais il comprit que sa porten'était pas engageante : « Frappez et on ne vous ouvrira pas. »
Cette fois il eût ouvert.
— Elle ne me doit rien, se disait-il ; pourquoi se hasarderait-elle àme remercier ?
Il n'y pensait plus, quand il reçut une lettre qui ne contenait que cesdeux lignes détachées de La Bruyère :
« On bâtit l'amitié sur la reconnaissance, jamais l'amour. »
— Voilà qui est profond ! dit - il. En effet, l'amour n'aime pas la raison. Qui donc m'envoie cette énigme ?
Il pensa à mademoiselle de Villetardieu. Mais il apprit alors qu'elleétait dans sa belle terre perdue et retrouvée.
Comme, en fin décompte, M. de Frémiet avait trente ans à peine, il pritla sage résolution de se donner un peu de bon temps.
Pendant toute une saison, il n'avait songé qu'au procès de mademoisellede Villetardieu ; il y songeait la nuit, il y travaillait le jour. Apeine si parfois il acceptait à dîner chez ses meilleurs amis, mêmechez son oncle Hardy, l'un des échevins de la ville de Paris. Quedisons-nous ? Les plus belles dames l'avaient provoqué de leurssourires, il n'acceptait aucune de ces belles avances : son procès,toujours son procès.
Pourtant il avait rencontré plus d'une fois, son adversaire, maîtreGerbier, très oublieux des choses du barreau, qui donnait le bras à unecomédienne, sa maîtresse, aussi belle et plus complaisante que dameJustice. Pour lui rien n'avait pu le distraire ; il avait résisté mêmeau mauvais exemple et à ses dangereuses conclusions. Mais, à présentqu'il était libre, et sa cause étant gagnée, il s'en fut avec deux outrois conseillers lays et deux ou trois conseillers d'épée, de sesamis, dîner à la
Cornemuse, un cabaret célèbre, où le bonhommeDancourt allait souper toutes les fois que sa pièce nouvelle étaitsifflée. Or, l'usage à la
Cornemuse, c'était d'y passer incognito ;pas de nom propre et pas de profession distincte. Ici, le magistrat, lecapitaine, le poëte et le comédien, chacun pour son argent était lemaître, et nul n'avait le droit de s'enquérir du
pourquoi ? et du
comment ? Messieurs les gens du roi célébrèrent, le verre en main, le succès deleur confrère, et les plus timides portèrent la santé de mademoisellede Villetardieu avec un glorieux vin de Bourgogne, qui avait appartenuau père de Bossuet, le Bourguignon.
Le repas se prolongea jusqu'à minuit. Donc il était temps de rentrer,et messieurs les conseillers s'en furent, chacun de son côté, oùl'appelait qui la passion, qui le devoir.
Cependant M. de Frémiet, resté dans la rue, et voyant des hommes et desfemmes qui s'en allaient du même côté, se souvint fort à propos que lebal de l'Opéra était ouvert :
— J'y veux aller, dit-il ; et le matin venu, j'aurai retrouvé monsang-froid.
A ces causes, le voilà dans cette éclatante cohue où s'agitaient tantd'aventures incroyables. On eût dit que la jeunesse et le vice et tousles bonheurs de l'intrigue s'étaient donné rendez-vous dans ce lieu deperdition.
Il ne faut pas oublier que, pour la première fois depuis tant desiècles, dans ce bal de l'Opéra nouvellement créé par un gentilhommeruiné qui s'y faisait dix mille livres de rentes, la plus parfaiteégalité régnait parmi les invités. Le premier venu tutoyait la duchesseou l'altesse royale ; un bourgeois était l'égal d'un fils de France, etM. le régent lui-même, pour être mieux déguisé, recevait des coups depied authentiques et officiels de M. le cardinal Dubois.
Notre avocat général avait longtemps résisté à l'entraînement universel; mais le soir dont nous parlons, il ne savait rien d'impossible ;seulement il oublia qu'il avait le droit du masque, et, comme il étaitperdu dans cette foule, à visage découvert, pas un ne remarquant saprésence, il fut abordé par une grande et frêle personne, en dominonoir et masquée.
Elle tenait à la main un bel œillet rouge qu'elle offrit au jeunehomme. Celui-ci lui prenant le bras, ils se promenèrent longtemps dansle foyer de l'Opéra. C'était un lieu tout flamboyant, plein de lumièreset de déclarations d'amour. Là, quiconque était jeune et bienséanteétait sûre de rencontrer un galant à sa fantaisie. Un jeu muet ditsouvent tant de choses ! Il y a tant d'éloquence à se parler à voixbasse ! A vingt et à trente ans, jeunesse et passion se comprennent sifacilement.
M. de Frémiet fut ébloui du charme et de l'esprit de son inconnue ; illa supplia vainement de lui montrer son beau visage. Il fallut secontenter de ces yeux pleins de feu, de ces dents blanches, de cesbelles mains parfois dégantées. Grande était la tentation ; mais lerespect l'emportait sur tout le reste. Et quand il fallut se quitter,le jeune homme, à regret, sans doute, remit la belle inconnue aux mainsde la douairière qui l'attendait.
Il revint, très amoureux, en toute hâte en son logis, et Dieu saitqu'il eut grand'peine à s'endormir ! Tant de bruit, tant de clartés, desi beaux silences dans ce bruit d'enfer, et ce tumulte heureux de ladanse et de la chanson !
Désormais, il appartint à la maîtresse absolue de sa pensée ; sanscesse il avait sous les yeux cet œillet rouge, sitôt fané, que luiavait offert cette belle main digne de Versailles.
Quatre longues semaines suffirent à peine à ces contentements. Elle etlui se retrouvaient dans ce bal de l'Opéra, à la même heure ; ils sereconnaissaient au même signal ; toujours le même œillet rouge,toujours les mêmes tendresses, avec des serments d'un amour éternel.
— Mais, disait-il, quand vous verrai-je ?
— Espérez, répondait-elle ; vous saurez bientôt mes volontés.
Et d'un œil plus vif et plus curieux :
— Avez-vous jamais aimé, mon beau damoiseau du Palais ?
— Jamais ! A peine, à douze ans, ma petite cousine, pour manger à deuxla même tartine de confitures. Mais je dois vous avouer qu'il n'y a paslongtemps j'ai perdu une belle occasion.
— Contez-moi cela.
— J'ai sauvé la fortune d'une jeune fille « belle comme le jour, » m'adit mon secrétaire, et, le croiriez-vous ? je n'ai pas voulu la voir !
— Je vous ferai canoniser. Vous avez eu tort, vous l'auriez aimée.
— Oui, mais elle ne m'aurait pas aimé. La chambre des requêtes n'estpas le chemin de l'amour. Et puis, La Bruyère l'a dit : « Où il y a dela reconnaissance, il n'y a que de l'amitié. »
— C'est vrai. Et puis le moyen d'aimer une plaideuse, fût-elle « bellecomme le jour ! » Je sais un peu toute cette histoire : votredemoiselle de la Villetardieu n'est qu'une provinciale.
— Oh ! Madame, la beauté n'a pas de pays, ou plutôt elle est toujoursParisienne. Est-ce que vous êtes née à Paris ?
— Oui, à deux pas du Palais : je vous vois passer souvent.
— Et vous ne plaidez jamais ?
— Si ; j'ai une cause à plaider bien plus belle que celle de votredemoiselle de Villetardieu. Me la ferez-vous gagner ?
— Oui, ou j'y perdrai mon latin de Palais.
Et on se donna rendez-vous pour le dernier bal masqué.
Mais, à ce dernier bal, la dame à l'œillet rouge ne revint pas.
M. de Frémiet la chercha, désespéré, dans cette foule abandonnée àtoutes les ivresses.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! la voilà perdue ! Un autre l'aura trouvée, machère inconnue.
Il la pleurait, sans cacher ses larmes. On lui eût apporté la plusbelle cause à soutenir, il n'eût rien écouté ; l'âme était partie, etle corps ne vivait plus. Vainement, il la chercha aux alentours duPalais. Il la chercha partout et ne la trouva nulle part.
Son oncle Hardy et sa tante, attendant paisiblement que le roi leurdonnât la noblesse, avaient grand' pitié des malheurs de leur beauneveu.
— Mon enfant, disait la tante, une bonne femme s'il en fut, où diableas-tu rencontré ces sottes amours ? Comment donc, tu te meurs pour unefemme que tu n'as jamais vue et qui se dérobe au moment où tu vas luioffrir une main déjà très recherchée? On ne fuit pas de ces choses-là.A qui donc en as-tu, je te prie ? Après tout, s'il te faut absolumentquelque belle personne amoureuse de toi, nous avons vu par hasardmademoiselle de Villetardieu ; elle nous a raconté sa reconnaissance etles rigueurs de son avocat général, mais elle.est prête à te pardonner.Fais ta demande, et tu seras récompensé même au delà de tes mérites.
— Non, disait-il, je ne l'ai pas vue et je ne veux pas la voir ; toutemon ambition appartient à l'esprit qui m'a tant charmé. J'en mourrai,c'est vrai, mais je mourrai fidèle à tant de grâce.
III
I
L disait ces choses-là sérieusement. Il est vrai, que Paris, en cetemps-là, lisait et relisait comme parole d'Évangiles les poésies despoëtes de l'amour. On adorait Gentil-Bernard ; on savait par cœur lesélégies du cardinal de Bernis. Lui-même, le président de Montesquieu,ce génie et ce grand homme, avait fait
le Temple de Gnide ; selon lemot du temps, « on sacrifiait à l'Amour et aux Grâces. » Aujourd'huinous rions de leurs larmes, mais c'étaient des larmes.
C'est pourquoi, sans doute, il advint que la fièvre qui consumait M. deFrémiet eut bientôt toutes les apparences d'un mal incurable. Il nevoulait rien entendre ; il était éperdu dans sa passion.
Son oncle Hardy, très inquiet de son beau neveu, employa une longuenégociation pour lui faire accepter, dans son petit château du Fronlay,en appartement au rez-de-chaussée, en plein nord, presque une cellule.
Le soleil était absent ; la verdure était épaisse. A peine on entendaitdans le lointain, au murmure des peupliers d'Italie, le bruit matinalde la basse-cour. Point de livres, point de tableaux, pas même unthéorbe, comme on voit dans la conversation espagnole du
Mariage deFigaro.
La rivière était proche, et son flot silencieux mordait amoureusementces belles prairies. Le paysage, tout mélancolique, était en harmonie àses rêves : il finit par y trouver un vrai charme.
Il errait sur ce rivage en rêvant à ses aventures passées. S'ilentendait par hasard une voix sonore, une agreste chanson, iltressaillait comme un enfant qu'on réveille en sursaut.
Un jour de juin, un jour de soleil, comme il suivait la longue avenueoù les saules, les pieds plongés dans ces eaux froides et la têteobéissante à tous les vents, lui prêtaient leur ombrage mobile, ilaperçut au loin, assise sur un tertre, sous un orme centenaire, unejeune fille et sa suivante qui lisaient des pages amoureuses. Lasuivante, penchée vers la dame, avait élevé la voix, un beau timbred'or. Et la dame écoutait, les yeux pleins de larmes, les beaux versque voici :
Petites fleurs qui croissez sur la rive,
Le vent jaloux passe pour vous cueillir ;
J'appelle en vain, mon amoureux n'arrive...
Loin de l'amour me faudra-t-il vieillir ?
Lys qui penchez sur les roses vermeilles,
Roseaux chanteurs, oiseaux et papillons.
Bois agités, diligentes abeilles,
Ramiers plaintifs tapis dans les sillons;
Doux arc-en-ciel égaré dans l'espace.
Nuage bleu par le vent emporté,
Priez le ciel que mon amoureux passe :
A lui mon cœur, mon âme et ma beauté.
Je ne suis pas coquette ni farouche;
Vit-on jamais mon sourire moqueur ?
Et n'ai-je pas, tout brûlant sur ma bouche,
Un doux baiser qu'emprisonne mon cœur ?
Notez bien que la jeune fille aux cheveux blonds avait paré son corsaged'un bel œillet rouge fraîchement arrosé des larmes du matin.
M. de Frémiet, à l'aspect de la jeune fille, tressaillit et devint toutpâle. Il ne la voyait pas, mais il lui sembla qu'il l'avait déjà vue etqu'il avait baisé plus d'une fois cette main charmante qu'elle agitait.
Qui donc avait placé cette belle fleur à ce beau corsage ? Toutl'aspect était d'une reine, si la parure était d'une rustique.
En vain il eût voulu se contenir ; l'amour fut plus fort que le respect.
De son côté, l'inconnue, à l'aspect de ce jeune homme, étonnée etsurprise, prit la fuite avec sa compagne, avec de petits cris pleins deterreur.
— Madame ! ah ! Madame , où fuyez-vous ? s'écriait M. de Frémiet.
Il tendait ses deux mains à cette ombre ; mais il criait, il pleuraitdans le désert. Les deux femmes avaient disparu sous les saules, ladame jetant son bouquet, la suivante repliant ses vers, et notreamoureux se contenta de la fleur que portait la belle promeneuse à soncorsage.
— Que je suis malheureux ! disait-il ; je ne l'ai pas vue. En voilàtrois qui disparaissent, légères comme l'oiseau. C'en est fait, j'yrenonce ; et maintenant, vienne la mort, elle sera la bienvenue,puisque toute femme me fuit.
— O malheureux enfant ! disait sa tante, quelle fièvre as-tu prise ?
Et la bonne tante ajouta :
— Oh ! ces amoureux en simarre! ils ne savent pas le premier mot del'amour.
L'oncle Hardy levait les mains au ciel, disant qu'il n'aurait jamaiscru que le fils de sa sœur s'abandonnât à pareil désespoir.
M. de Frémiet interrogeait son oncle et sa tante.
— Quelles sont vos voisines de campagne ?
— Nous ne les connaissons pas.
— Celle que j'ai entrevue aujourd'hui est bien jolie.
— Veux-tu que j'aille lui demander sa main?
— Non ; tu sais bien que je suis tout affolé de mon inconnue du bal del'Opéra.
— Tu deviendras fou.
— D'autant plus fou que je crois, Dieu me pardonne, que j'aime aussimademoiselle de Villetardieu.
La tante riait :
— Et puis l'inconnue qui erre par ces campagnes ? En vérité, monsieurmon neveu, vous êtes amoureux des onze mille vierges. Ces hommes duPalais, quand ils ont la clef des champs, ils battent joliment lacampagne.
— Que voulez-vous ! je ne suis plus maître de ma raison depuis que jene suis plus maître de mon cœur.
— Enfin, ton cœur ne te dit donc rien ?
— Il me parle hébreu.
L'oncle prit une prise de tabac d'Espagne et secoua sa jabotière :
— Il faudra pourtant découvrir la dame à l'œillet rouge.
— Ou l'oublier, dit la tante.
V
L
E lendemain, nouveau spectacle.
C'était le plus rustique et le plus charmant tableau. Deux jeunes etbelles châtelaines étaient assises, sous un parasol, dans la prairie,devant un panier de cerises comme des paysannes. Et quelles cerises !
Et encore un rustre leur offrait à chacune une branche de cerisier touten fruit. La plus jeune était la plus belle. La voir, c'était l'aimer.
M. de Frémiet reconnut la jeune fille de la veille qui écoutait si bienla chanson amoureuse.
Quand il l'aperçut, elle portait une cerise à ses lèvres qui étaientaussi des cerises. Il eût voulu les dévorer.
— Ah ! s'écria-t-il, si mademoiselle de Villetardieu ou plutôt si ladame à l'œillet rouge était belle comme cela !
Quelques jours après, M. de Frémiet ne fut pas peu surpris de voirvenir au château la belle dame qui avait cueilli des marguerites etmangé des cerises dans les prairies voisines,
Elle venait, sans façon, dîner avec le châtelain de Fronlay, elle, lachâtelaine d'Igneville.
On dîna gaiement. M. de Frémiet avoua que les provinciales avaient toutl'esprit et toute la grâce des Parisiennes.
— Quel malheur! murmurait-il, que je n'aie pas rencontré cette bellecréature avant de me passionner pour la dame à l'œillet rouge et avantde m'inquiéter de mademoiselle de la Villetardieu !
Le lendemain matin, le messager, qui apportait les lettres de Parisdeux fois par semaine, remit deux plis cachetés à M. de Frémiet. Ce nefut pas sans surprise et sans émotion qu'il ouvrit le premier. C'étaitune petite écriture, de vraies pattes de chat ; il lut ces lignesgriffonnées :
«
Monsieur mon amoureux, « Vous savez que je m’ennuie fort de ne pas vous voir. — J'attends avecimpatience le prochain bal de l’Opéra; mais ce n’est pas demain.Pourquoi êtes-vous charmant quand vous avez dépouillé la robe dumagistrat ? Je vous croyais voué au sévère, mais vous avez d'adorablesquarts d'heure. On me dit que vous êtes loin de Paris, dans un paradishanté par de belles provinciales ; nallez pas m’oublier, même si ellesont des œillets rouges.
« LA DAME A L'OEILLET ROUGE. »
Voici la seconde lettre :
« Que je suis désolée, Monsieur, d'avoir gagné mon procès grâce à vous! Car, enfin, si je l'avais perdu, vous ne m’eussiez pas fermé votreporte sans me voir comme vous avez fait. Il aurait bien fallu meconsoler ; et je vous jure sur mon âme et sur Dieu qu'il m'eût été bienplus doux d'être consolée par vous que de tenir de vous ma fortune. Quevoulez-vous que je fasse de ma fortune sans vous ? « Adieu, puisque je ne puis dire à revoir ; soyez heureux même dans monmalheur. « ADÈLE DE LA VILLETARDIEU. »
A chacune des deux lettres, M. de Frémiet sentit des larmes dans sesyeux. « Suis-je assez malheureux ! s'écria-t-il, il semble que je nesuis né que pour être maudit par l'amour. »
Il répondit aux deux billets, mais à quoi bon, puisqu'il ne savait oùles envoyer !
Le soir venu, comme M. de Frémiet était dans le jardin, prêtant uneoreille indifférente aux mille bruits de la campagne sans avoir reconnul'arrivée d'un carrosse, il sentit deux petites mains qui se posaientsur ses yeux pleins de larmes.
Une belle voix lui dit :
— Devine ?
— A moins que tu ne sois mademoiselle de Villetardieu, ou la bellemangeuse de cerises de ce matin, ou la dame à l'œillet rouge du balmasqué, je serai le plus malheureux de tous les hommes.
— Aveugle comme l'amour ou comme un maître des requêtes, dit la bellechâtelaine d’Igneville, en lui tendant la main.
Et avec le plus charmant sourire :
Nous avons été trois ; je ne suis plus qu'une seule, mais je vous aimepour trois !
M. de Frémiet baisa amoureusement la main de la charmeuse.
— Et moi, je vous aime comme quatre !
V
A
LA fin de l'automne, mademoiselle de Villetardieu épousait M. deFrémiet.
— Enfin, disait la dame à l'œillet rouge, c est le dénouement de macomédie et Dieu me le pardonnera.
Il y eut de grands étonnements mêlés à de grandes réjouissances àpropos de ce mariage. M. le premier président fut le témoin du jeunehomme. L'oncle Hardy, qui jouait trop volontiers sur son nom propre,conduisit
hardiment mademoiselle de Villetardieu à l'autel.
C'est ce jour-là qu'elle était belle comme le jour, car elle rayonnaitdans l'amour et dans la joie.
— Est-il heureux, disaient messieurs des enquêtes, d'avoir une si bellefemme !
— Et que Dieu nous en accorde une pareille ! disaient messieurs desrequêtes.
Ainsi soit-il !
JULES JANIN
JULES JANIN
I
J
USQU'AU jour où on a vu dans les journaux du lundi éclater d'une purelumière les noms de Jules Janin, de Sainte-Beuve et de ThéophileGautier, on sentait le rayonnement sympathique de 1830.
Même à travers les orages politiques, l'arc-en-ciel illumnait lesnuées. Ces trois rares esprits ont disparu presque du même coup. Lanuit ne s'est pas faite dans les lettres, mais pourtant tous ceux quine se méprennent pas sur l'écrivain qui a le don, ont senti je ne saisquoi de nocturne autour d'eux.
Qui donc donnera désormais l'idée de ce rayon matinal, de cet esprit àl'aventure, de cette jeunesse épanouie qui s'appelait Jules Janin ? Ona parlé de ses années de collège et de ses années de misère. N'encroyez pas un mot ; il a traversé le jardin des roses de Saadi ; il aétudié l'Anthologie avec Horace pour maître d'école ; il a picoré surtous les chefs-d’œuvre de l'antiquité, ivre et bourdonnant, abeilled'or tour à tour gourmande et savoureuse. Je ne sais pas s'il a jamaismis le pied sur la terre ferme, tant il a vécu de la vie idéale, desprismes du rêve, dans le cénacle des anciens, avec sa fenêtre ouverte,comme par échappées, sur le monde de son temps. Et pourtant, quoiqu'ilconfondît tous les siècles, comme si le siècle de l'esprit n'en faisaitqu'un, il peignait, avec autant de justesse que d'éclat, le tableau dela vie moderne ; il était plus vrai dans sa fantaisie que tous lesréalistes patentés qui s'imaginent être vrais, parce qu'ils n'ont pasle rayon. Étudiez de près l’
Ane mort et le
Chemin de traverse,étudiez ses cent et un contes, ses mille et un feuilletons, vousreconnaîtrez que toute l'histoire intime du dix-neuvième siècle est là,vivante par fragments, comme vous trouvez dans l'atelier d'un peintrede génie la créature humaine, de face, de profil, de trois quarts. Onentre dans l'œuvre de Jules Janin comme dans un atelier : ici unfusain, là une gouache, plus loin une ébauche, çà et là de vivantespeintures qui ont l'âme, qui ont le regard, qui ont la parole. Et quede trouvailles inattendues ! C'est un pastel effacé, mai souriantencore ; c'est une eau-forte académie qui crie la vérité. On a déjàtrop oublié l'œuvre de Jules Janin ; quand on va remuer cette montagnede sable, on s'étonnera d'y trouver tant d'or pur !
La sottise de la plupart des critiques, ceux-là qui ne laisseront pasde placers après eux, c'est de n'être jamais contents de rien, hormisd'eux-mêmes. Ont-ils assez « tombé » Janin, sous prétexte que chez luile mot cachait l'idée, ou plutôt que la pensée se noyait dans laphrase. On pourrait le comparer à ces beautés à la mode qui traînent àleur queue un kilomètre de satin, de rubans et de dentelles, sous deschapeaux qui sont des jardins de Babylone, sans parler du chignon et ducorsage, qui sont plus ou moins des parures d'emprunt. La critiquedisait à Janin comme au peintre antique : « Ne pouvant la faire belle,tu l'as faite riche. »
Janin l'avait faite riche parce qu'elle était jolie.
II
Quel charmant entraîneur pour tous ceux qui s'aventuraient dans leslettres. Comme il leur donnait cordialement le coup de l’étrier ! Ilsemblait qu'il voulût les consoler par avance de tous les déboiresfuturs. Nous étions encore avec Théophile et Gérard dans la bohème duDoyenné, la mère-patrie de tous les bohèmes littéraires, quand je reçusun matin, à ma grande surprise, un hiéroglyphe de Jules Janin que nouslûmes en nous mettant à trois pour cette œuvre laborieuse. Il n'y avaitque deux lignes, mais qui en valaient bien quatre.
Les voici, car je les ai gardées comme un parchemin de ma vingtièmeannée. C'était à propos d'un roman oublié, à ce point que je l'aioublié tout le premier, l
a Pécheresse :
«.
Vous avez fait un livre charmant dont je raffole ; venez me voir sivous passez par là. J. J. »
Je n'attendis pas au lendemain. C'était en son temps le plus radieux ;il habitait le rez-de-chaussée et le jardin d'un grand hôtel de la ruede Tournon. Et il habitait cela en grand seigneur, avec tous lesraffinements de l'artiste. Déjà il avait commencé sa rarissimebibliothèque. C'était le bon temps : il n'y avait guère alors que Janinet Nodier pour se disputer les beaux livres. Lui qui descendait de samansarde, qui donc l'avait initié au luxe des fermiers généraux, du ducde La Vallière, de la reine Marie-Antoinette ? Car ses livresreposaient dans les plus belles bibliothèques en bois de rose du tempsde Louis XIV. Tout le mobilier, d'ailleurs, était du même style. Pourachever l'illusion, il avait appendu dans le salon et dans le boudoir,sous d'anciennes tentures bleu de ciel, des portraits du dix-huitièmesiècle. J'avais vu jusque-là quelques intérieurs de gens de lettresillustrés par l'acajou à la mode. Je me crus dans une féerie, quoiquedans notre bohème, avec Théophile et Gérard, nous eussions un salonLouis XIV à nul autre pareil ; mais chez nous tout était un peu à ladiable, tandis que chez Jules Janin c'était l'exquise perfection. Etquelle hospitalité ! Après m'a voir fait voyager dans sa bibliothèque,il me promena dans son jardin et me prouva que j'étais invité à dîneravec lui et ses amis.
Je ne rappelle ceci que pour montrer sa vie vers 1835. C'était unemaison de Sybaris, mais avec une plume d'oie et une plume de fer, caril avait tous les luxes, hormis le luxe du temps perdu. Il faut biendire que, si on l'eût condamné à ne rien faire, il n'eût pas été cethomme heureux dont il a si souvent parlé. Déjà prince des critiques, ille fut près d'un demi-siècle, toujours imprévu, toujours charmant,toujours inouï.
III
Dans cet hôtel de la rue de Tournon, il s'effraya de son luxe ; il eutpeur de manger son fonds avant son revenu. Il sacrifiahéroïquement ses plus belles choses, moins ses livres, pour aller seréfugier au septième ciel dans un appartement de la rue de Vaugirard,en face de la grille du Luxembourg, disant : « Ce sera là mon jardin. » La mansarde fut bienvite dorée. C'était tout petit, mais c'était charmant : l'oiseau bleune pouvait pas chanter dans une vilaine cage. Diaz, encore à moitiédécorateur, quoique déjà le Diaz étincelant, vint peindre des roses etdes arabesques sur les portes et sur les glaces. On n'en mangea pasmoins dans la porcelaine de Saxe et dans la porcelaine de Chine. JulesJanin n'en perdit pas un sourire. Il était bien inspiré, car ce futalors que cette jeune fille, dont quelques peintres ont éternisé labeauté dans ses radieux vingt ans, vint lui donner cette main loyalequi lui a toujours été si sûre et si douce. Son mariage fut unévénement ; le contrat est étoile de toutes les illustrations de cetemps-là, Thiers et Hugo en tête.
Une jeune fille comme toutes les autres eût dit à Jules Janin : « Jesuis très fière de vous épouser, mais je ne veux pas monter dans cettemansarde. » Madame Jules Janin y monta et s'écria :
Le bonheur estici.
Pendant près de vingt ans, elle n'en voulut pas descendre, quoique sonpère lui eût offert ce joli petit château Louis XVI qui frappait l'œilde tous les artistes dans la grande rue de Passy, au milieu d'un océande verdure. Ce ne fut que vers 1858 que Janin se décida à vivre dans uncoin des jardins de la Muette. Il bâtit lui-même sa maison, commel'oiseau fait son nid, ne s'inquiétant que de la chambre de sa femme etde la chambre de ses livres.
A l'extérieur, c'est un chalet couronné de beaux arbres, de vertespelouses, de parterres hollandais, de bosquets ombreux où, l'été, Janindonnait des audiences. L'intérieur tient plus du
palazzo vénitien quedu chalet suisse. Au rez-de-chaussée, une jolie salle à manger d'été,décorée d'appliques de faïence aux couleurs vives et gaies, avec unecheminée Renaissance. Une porte souvent entr'ouverte laisse voir unecuisine à la flamande d'où les carreaux rouges et les casserolesrenvoient des reflets de pourpre et d'or. On monte au premier étage parun escalier dont les parois sont couvertes de gravures rares. On entredans une grande pièce, à la fois salon, cabinet de travail etbibliothèque, éclairée par quatre grandes fenêtres à vitraux jaunes etrouges. Ce salon, qui est contigu à la salle à manger, n'en est séparéque par une grande glace sans tain. Aux quatre coins du salon, quatreimmenses bibliothèques de chêne sculpté où se pressent en rangéesmulticolores les plus beaux livres du monde : Incunables, Aides,Estiennes, Elzévirs, livres à figures, éditions originales desclassiques du dix-septième et du dix-huitième siècles, livres modernesen papiers extraordinaires, avec dédicaces curieuses. Au-dessus delàcheminée en marbre blanc, supportant une belle pendule Louis XVI,sourit l'admirable pastel de madame Janin. Devant une fenêtre, sur unsocle en forme de colonne, le buste en marbre de Janin. Devant la glaceune table énorme surchargée de livres. Tout à côté, le bureau princierdu maître avec les papiers et l'encrier encore plein d'encre bleue !Adroite et à gauche de la cheminée deux rangées de fauteuilshospitaliers : Ah ! s'ils pouvaient parler comme le sofa de Crébillon !
C'est là que Jules Janin a passé les quinze dernières années de sa vie; c'est là qu'il a écrit sa traduction d'
Horace, son
Neveu deRameau, son
Livre, ses feuilletons des
Débats, ses derniers romans; c'est là qu'il a reçu tout ce que la France compte d'illustrationsdans les lettres, dans les sciences, dans les arts. C'est là,pourrait-on dire, qu'il a été nommé à l'Académie française, car Janin areçu plus de visites académiques qu'il n'en a fait.
Et c'est là, entouré de tout ce bonheur et de toute cette gloire, quenous l'entendions dire, il n'y a pas longtemps : « Je suis un grandécrivain ; je suis célèbre ; je suis de l'Académie : eh bien ! jedonnerais tout cela pour pouvoir faire seul le tour de ma chambre. »
IV
Le feuilleton du lundi, ce n'était qu'un jeu pour lui. Comme Boufflersécrivant la
Reine de Golconde, il disait : « Ce n'est pas moi quiconduis ma plume, c'est ma plume qui conduit ma main. » C'était unetelle habitude que demain lundi, le jour de ses funérailles, quandj'ouvrirai le
Journal des Débats, je serai surpris de ne pas ytrouver les deux magiques lettres J. J.
On se demandait le dimanche quel serait le feu d'artifice du lundi.
C'était bien mieux qu'un feu d'artifice, car la lumière était plus viveaprès le bouquet. On s'en revenait de son feuilleton réconforté par laraison armée d'esprit,
Il était l'initiateur par excellence ; il ne s'est pas trompé une seulefois sur l'or pur et sur la fausse monnaie des renommées contemporaines.
Qui donc a mieux peint Lamartine, Thiers, Hugo, Ingres, Delacroix,Balzac, Dumas Ier et Dumas II, Sacy, Pradier, Quinet, Vigny, Decamps ?Qui donc a salué le premier Dorval, Frederick et Rachel ? Qui donc,Musset, Sandeau, Ponsard, Augier, Feuillet et tous ceux que ma plumeoublie ? M. Camille Doucet, qui lui a si doctement et sispirituellement répondu à l'Académie, a été bien inspiré en lui disant: « Tout le monde a fait avec vous ce beau voyage dans le passé d'hieret assisté du fond de votre loge à la représentation, à la reprise deces vingt années de la vie parisienne, de ses spectacles, de sesplaisirs, de ses triomphes et de ses joies ; de ses défaites aussi etde ses larmes. Si les feuilletons de Sainte-Beuve sont des archives,les vôtres sont des mémoires, les mémoires de votre vie et de votretemps. » (1)
Sa belle gaieté, qui réjouissait le cœur, ne l'empêchait pas de jeterun mot profond. Il avait beau s'aventurer dans toutes les bonnesfortunes du style, il ne risquait pas les droits de la vérité. S'ilprenait le chemin de traverse, ce n'était pas seulement par horreur dela grande route, c'était pour arriver plus vite à travers toutes lesbelles aventures de l'imprévu.
Le feuilleton de Janin n'est que la moitié de son œuvre. Il avaitdébuté comme romancier par un livre qui survivra :
l’Ane mort et laFemme guillotinée, chef-d’œuvre étrange, qui est à la fois l'âme et laraillerie de la littérature romantique. Quand Nisard, son ami, fit unerévolution en s'indignant avec tant d'atticisme contre la littératurefacile, Janin, qui la défendit si bien, ne lui avait-il pas déjà donnéle coup mortel ?
Je dirai un jour toute la vie laborieuse et féconde de ce charmantesprit, de ce cœur d'or, de cet homme qui fut un homme. Il est sivivant encore que je ne puis m'imaginer que ce beau sourire se soitévanoui hier pour l'éternité. C'est un premier adieu que je lui disavec le déchirement d'une amitié qui s'en va. Mais le dernier adieu, jene veux jamais le lui dire :
Pour ceux qui les aimaient, les morts vivent toujours.
Selon une épigraphe de l'Anthologie, Platon disait en mourant : « Monâme sera libre de courir dans la rosée avec les cigales babillardes. »Ne pourrait-on pas écrire ainsi dans l'Anthologie française l’épitaphede Jules Janin : « Ci-gît un rayon dans la rosée où jouent les cigalesbabillardes ?»
Janin dit dans un de ses livres : « Je taillais les hautes futaies dema fenêtre en lisant quelque chef-d’œuvre des anciens jours. » ToutJanin est là, il cueillait l'heure présente tout en s'égarant dansl'heure passée.
Les hautes futaies et les livres sont aujourd'hui dans cette maisond'Horace où il avait donné l'hospitalité à Ponsard. Madame Jules Janinsera leur sauvegarde ; elle vivra dans cette religion des souvenirséplorés et consolants. Mais qui nous rendra cette âme et cet esprit !
Le lundi sera longtemps un jour de deuil pour ceux qui ont aimé leprince des critiques, les
Causeries de Sainte-Beuve et lefeuilleton-tableau de Théophile Gautier. Mais ils diront que le vraimiracle du lundi, c'était Jules Janin.
ARSÈNE HOUSSAYE.
Ce profil de Jules Janin a paru dans
le Gaulois le lendemain de lamort de ce prince de l'esprit que M. Cuvillier-Fleury, parlant siéloquemment au nom de l'Académie, a appelé le roi des critiques
(1) Ailleurs, M. Camille Doucet parle du musée des lundis. C'est un mottrouvé. En effet, combien de tableaux et de portraits dans ce muséecharmant !