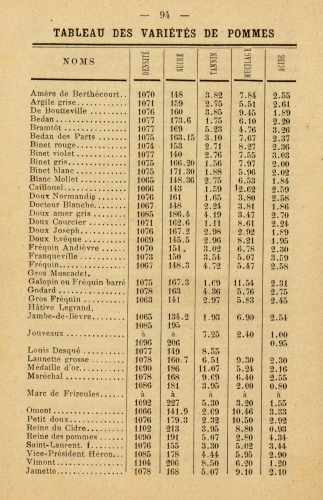Corps
| LA BORDE,Roger de (18..-19..) : Almanach du pommier & du cidre: 1898.- Paris ; Lille : A. Taffin-Lefort, 1898.- 143 p ; 15 cm Saisie dutexte : O. Bogros pour lacollectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (10.X.2015) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de laMédiathèque(Bm Lx : norm 1654). ALMANACH DU POMMIER & DU CIDRE POUR 1898 PAR ROGER DE LA BORDE Président de la Section de Maine-et-Loire du Syndicat Pomologique Président de l'Union des Syndicats de Segré 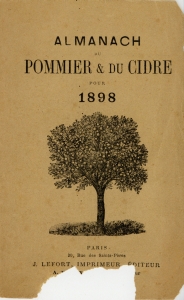 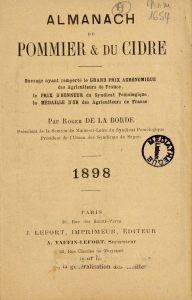 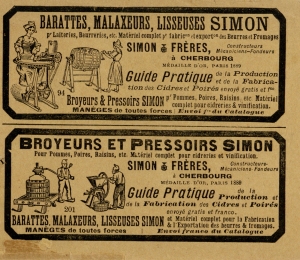 ~ * ~ PRÉFACE Il est de tradition de faire connaître, au commencement d'unlivre, par quelques pages qui ne sont presque jamais lues, quel est lebut de l'auteur en livrant au papier ses idées sur telle, question etcomment il compte présenter son sujet au lecteur. Depuisquelques années les progrès de la culture du pommier et de lafabrication du cidre ont été nombreux en France, grâce aux travaux desdifférentes Sociétés de pomologie et notamment du Syndicat pomologiquede France qui rayonne, par ses adhérents et par ses expositionsannuelles, sur soixante-cinq départements. Ce succès est l'œuvre deséminents pomologues qui ont fondé ce Syndicat, notamment M. le vicomteCharles de Lotgeril, président ; le R. Frère Abel, l'apôtre de lapomologie, vice-président; M. de la Chapelle, l'infatigable secrétairegénéral. L'art. 2 des statuts déclare que cette association apour objet l'étude de tout ce qui concerne la culture et l'élevage despommiers et poiriers, la propagation des meilleures espèces etvariétés, les mesures à prendre pour la protection des arbres, vergers,etc., la généralisation des meilleurs procédés et méthodes pour lafabrication des cidres, poirés, eau-de-vie, etc. Lagénéralisation des meilleurs procédés est répandue en France par lesconcours si instructifs et les savantes conférences du Syndicat, maissi le public agricole écoute avec la plus grande atten-tion lesconférenciers, s'il se rend compte des procédés nouveaux et desinstruments les plus perfectionnés, il faut bien admettre qu'une grandepartie de chaque conférence est oubliée presque aussitôt. Enplus, quelques milliers d'agriculteurs au plus peuvent assister à cesconcours et les absents ne peuvent en retirer un grand profit. En1895, à Saint-Brieuc, le B. Frère Abel eut l'excellente idée de faireimprimer un traité de culture du pommier et de fabrication du cidre, enstyle télégraphique de quelques centaines de mots, et de le fairedistribuer au public afin de lui en rappeler plus tard les pointsprincipaux. Je revendique donc, pour le R. Frère Abel l'idée dedistribuer gratuitement un petit traité de pomologie à tous lessyndiqués et à tous les assistants du concours. La prioritéétant établie, il faut reconnaître que le style télégraphique, tout endonnant les meilleurs conseils, n'entrait nécessairement passuffisamment dans le détail pour forcer le public à abandonnerl'ornière de la routine. J’ai essayé, dans les quelques pages decet opuscule, d'indiquer avec clarté et néanmoins avec concision lesquelques connaissances que l'expérience a pu me procurer. La première partie sera consacrée exclusivement à la culture du pommier dont voici les chapitres : l° NÉCESSITÉ DE CULTIVER LE POMMIER Rapport du pommier. Sélection du pommier. Densité des fruits. 2° LES PLANTS DU POMMIER Pépinière à la ferme. Achat chez le pépiniériste. Greffage en pépinières. Mode de greffage. Concordance de végétation. 3° PLANTATION Comment disposer la plantation. Choix du terrain. Distance. Nécessité de planter ensemble les variétés mûrissant à la même époque. Trous. Époque de plantation. Plantation. 4° SOINS A DONNER AUX ARBRES Entourages. Paillages. Cobéchages. Taille. Incision. Engrais des arbres fruitiers. Maladie des arbres. Nettoyage du pommier, le gui. 5° LA CIDRERIE 6° UTILITÉ DES ABEILLES POUR LA FRUCTIFICATION DES FRUITS Laseconde partie renferme une courte préfacé de M. Jacquemin, l'éminentdirecteur de l'institut La Claire, et le mémoire sur le fabrication etla conservation du cidre, qu'a la Société des Agriculteurs de France abien voulu récompenser en 489G du prix agronomique. (Voir à la fin de la Première Partie (page 82), la Prime de CENT FRANCS accordé à tout acheteur de cet almanach.) Roger DE LA BORDE. Château de LA LOGE, par Segré (Maine-et-Loire). * * * [Pages 7 à 20 : Calendrier non reproduit] 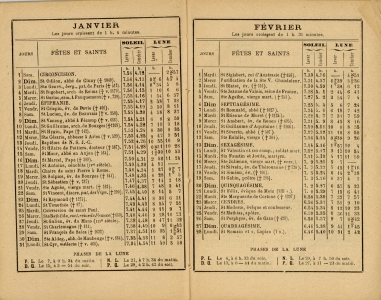 PREMIÈRE PARTIE LE POMMIER Depuis quelques années, la culture du pommier à cidre et à couteau apris une extension considérable, et il est facile de se rendre compteque le pommier envahit au Nord les pays de la bière et au Sud lescontrées vinicoles. La vigne, autrefois, existait dans tout le Nord et l'Ouest de laFrance, ainsi que le constate le cadastre où se trouvent lesappellations de ce genre : Champ de la Vigne, etc. Actuellement, denombreux vergers sont plantés sur l'emplacement des anciens vignobles.Au Nord, le pommier existe dans presque tous les départements, et lapatrie de la bière, l'Allemagne, a plusieurs de ses provinces couvertesde pommiers ; elle a même donné l'exemple, en plantant depuis peu surses routes, des pommiers de variétés à branches élevées qui peuvent,par leurs revenus, diminuer considérablement l'impôt demandé jusque-làaux contribuables pour payer l'entretien des routes. Le duché deLuxembourg et la Suisse ont suivi cet exemple depuis plusieurs années. L'Angleterre multiplie le nombre et l'étendue de ses vergers et lecidre entre dans la consommation courante. Les pays chauds eux-mêmessont entrés dans cette voie, et l'Espagne possède aujourd'hui denombreuses cidreries qui, un jour prochain, rivaliseront avec nosmeilleurs fabricants. M. Blanco Hermanos, propriétaire d'une de cescidreries, nous a envoyé au concours pomologique de Segré un lot de cescidres excellents. En France, la production a augmenté d'une manière considérable, ainsique le prouvent les statistiques. La moyenne de la production annuelle des pommes était, d'après lesrenseignements officiels, de : 9,744,900 hectolitres de 4871 à 1880. 12,769,800 hectolitres de 1881 à 1890. 13,782,829 hectolitres de 1885 à 1894. En 1895, la récolte était évaluée à 25,586,514 hectolitres. La ville de Paris qui consommait en 1866 soixante-dix-sept mille huitcent cinquante-cinq (77,855) hectolitres de cidre et poiré, a reçu en1891 : 110,658 hectolitres de cidre, et en 1894, 230,000 hectolitres. Enfin, pour ne nous occuper que de notre département, la ville d'Angersrecevait en 1668 100 barriques environ de cidre, tandis que la moyennedes dix dernières années est de 11,530 hectolitres, soit plus de cinqmille barriques par an. Nécessité de cultiver le pommier. La culture du blé est malheureusement de moins en moins lucrative, etactuellement, à peine si elle rembourse l'agriculture de ses débours etlui procure un salaire légitime. Les facilités de transport en un laps de temps très réduit, lapossibilité aux blés étrangers d'échapper aux droits d'entrée,l'existence des sociétés de spéculateurs, l'agiotage de l'argent, toutfait craindre que le cours du blé français ne puisse jamais remonter àun prix rémunérateur. Les pays qui devaient à la viticulture leursressources, ayant vu leurs vignes détruites par le phylloxéra, ontcherché dans la plantation des vignes américaines un moyen de salut ;mais, hélas! ce n'est peut être qu'une illusion, car, presque chaqueannée, on voit apparaître une nouvelle maladie de la vigne, menaceperpétuelle pour chaque récolte. Aussi voyons-nous les pays vignoblescommencer à planter, au milieu de leurs vignes, des rangées de pommiersà cidre ou à couteau. Actuellement, la récolte du cidre existe enFrance dans 68 départements. Il est même étonnant que les différentesrégions de la France n'aient pas adopté plus tôt cette culture, vu lepeu de frais nécessité par les vergers de pommiers. Rapport du pommier. Un des plus savants horticulteurs pomologiques, le Révérend FrèreHenry, de l'Institut Saint-Vincent, à Rennes, me disait, le 4 août1896, qu'un verger de trente et un ares, établi par lui dans un soltrès ordinaire, lui donnait à la septième année de greffe 18,000 livresde pommes. En estimant à 20 fr., au, bas mot, les mille livres, ceterrain, qui était loué autrefois 16 fr., rapportait 360 fr., autrementdit la location de 51 fr. l'hectare, était remplacée par un revenu de1,150 fr. à l'hectare. Une objection me sera certainement faite : unverger ne donne pas régulièrement tous les ans. Il est évident qu'ilfaut tenir compte des années mauvaises, mais en même temps on doitremarquer que les pommes, en ces années de disette, valent 80 à 100 fr.les mille kilos et qu'il est excessivement rare qu'un verger n'aitaucun fruit. En plus, il est à remarquer qu'une culture de pommiersdemande une quinzaine d'années pour bien rapporter, et que le verger enquestion n'a que sept ans de greffe. Sans craindre aucunement l'exagération, on peut dire qu'un hectare deverger bien entretenu rapporte en moyenne, tous frais déduits, au moinscinq à six cents francs. Quelle est donc la culture qui, presque sanstravail, donne un pareil produit ? Voici ce que dit M. Ouvray, auteurd'un ouvrage remarquable sur l'arboriculture fruitière, à ce sujet : « Il faut dix à quinze ans pour qu'un arbre à haute tige soit en pleinrapport ; l'homme, naturellement égoïste, trouve que c'est bien long,et il ne plante pas ; il oublie qu'il y a derrière lui des enfants etdes petits-enfants. » Il serait à souhaiter qu'on vît partout, à la campagne, des arbresfruitiers autour des maisons d'habitation ; qu'il n'y eût pas de fermesans son verger : pruniers, cerisiers, poiriers, pommiers de toutesvariétés et de toutes époques, et abricotiers dans les cours et partoutoù il y a un abri contre les vents du Nord. On oublie trop que l'arbrefruitier est un capital. Un arbre à haute tige de douze à quinze ans rapporte en moyenne sapièce de cent sous : cent arbres peuvent rapporter 500 fr. etreprésentent un capital de 12 à 15,000 fr. Combien de pères de famille, faute d'autre patrimoine, pourraientlaisser ce capital à leurs enfants ! La vigne rapporte, certainement,mais elle demande beaucoup de soins et de frais, tandis que l'arbrefruitier, une fois planté, n'en demande que peu ou point. » La vigne, il est vrai, donne un rapport supérieur au pommier et elle al'avantage de rapporter à cinq ans, tandis qu'il faut une quinzained'années pour obtenir le produit moyen du pommier ; mais elle coûteinfiniment plus cher de plantation, d'entretien et de défense contreles maladies qui l'attaquent chaque jour. Chaque hectare de vigneaméricaine plantée, revient au bas mot à 2,500 fr. l'hectare, tandisque l'hectare de verger ne dépassera pas 300 fr. Le travail nécessité pour l'entretien d'un verger est infiniment moinsconsidérable que le travail exigé par la vigne; et, par ailleurs,tandis que la vigne occupe exclusivement le terrain, le verger est uneexcellente pâture pour les jeunes animaux. Sélection du pommier. Dans un siècle de culture intensive comme celui-ci, ou chaque année lesimpôts, les charges augmentent, on devrait chercher, aussi bien pour lepommier que pour les autres cultures, à obtenir le maximum de recettesavec le minimum de dépenses ; la sélection, c'est-à-dire le choix desvariétés, s'imposait à tous. Il ne suffit pas, en effet, qu'un pommier pousse très vigoureusementpour qu'il soit profitable à son propriétaire, il est nécessaire qu'ilproduise, le plus souvent possible, la plus grande quantité de fruitsexcellents, donnant un cidre parfait et se conservant bien. Nous devonsdonc chercher dans un arbre les qualités suivantes : vigueur,rusticité et fertilité. Dans la pomme, nous devons réclamer larichesse en sucre et en tannin, le parfum, une quantité de matièrespectiques et d'acidité suffisante mais non trop élevée. Le cultivateur n'a pas intérêt à connaître les milliers de variétés depommes existantes. Le Syndicat pomologique de France a étudié avec lesplus grands soins chacune de ces variétés, et nous ne pouvons quesuivre les conseils qu'il nous donne en indiquant quelques variétésd'élite dont je donnerai les noms plus loin. (Voir 2e partie, page 94.) Densité. La sélection des pommiers a eu pour les agriculteurs un autre avantage,celui de connaître les variétés les plus riches en alcool, et depouvoir par conséquent en tirer tout le parti possible, par l'emploi dudensimètre dont la description est donnée dans la seconde partie, (page95.) Avec l'aide de ce petit instrument, vous pouvez instantanément savoirla quantité d'alcool que votre cidre aura après fermentation, et parconséquent si vous pouvez y ajouter de l'eau ; vous connaitrez laquantité exacte à mettre pour obtenir un cidre à tel degré. Les nouvelles variétés, qui sont essayées déjà depuis de longues annéesdans les différents départements, contiennent beaucoup plus de sucre,et par conséquent, d'alcool que les anciennes espèces ; vous voyez déjàtout le parti qu'il est possible d'en tirer, et quels sont lesavantages de ces nouvelles variétés, en dehors de leur fertilité quiest prouvée. Une variété, comme nous en avons malheureusement beaucoup dans lesvieux pommiers, dosant 1040 au densimètre, doit donner après toutefermentation un cidre de 5 degrés 1/2, tandis qu'un arbre dont ladensité est de 1080 aura 11 degrés d'alcool environ. Vous pourrez doncavec ces dernières pommes ajouter moitié eau et vous obtiendrez uneboisson ayant la même richesse alcoolique que le cidre fait avec lespommes de 1040 de densité, ruais dont le goût et le parfum seront moinsélevés. Autrement dit, avec la même quantité de pommes, vous pourrez fairemoitié plus de cidre de même force alcoolique. La richesse des pommes en sucre est très importante, parce que cesfruits à haute densité ne payent pas plus de transport et d'entrée queles pommes ordinaires, et que, forcément, l'acheteur les prendra avecune plus-value certainement très élevée. La haute densité, à mon avis du moins, est une très grande qualité chezune variété de pommes, mais, comme nous le verrons plus loin, la teneuren tannin et le parfum ont également une part très importante dansl'ensemble des variétés. Malheureusement, toutes les variétés, même les meilleures, suivent laloi fatale et semblent atteintes de décrépitude après un grand nombred'années. Ainsi la Calville rouge, si répandue dans notre Anjou et siproductive autrefois, ne pousse plus qu'à regret et semble avoir besoind'être régénérée par un semis nouveau. C'est pour connaître lesvariétés les plus recommandables et pour retrouver les anciennesvariétés rajeunies par un semis nouveau, plus fertiles et plus richesque jamais, que le Syndicat pomologique organise chaque année cesadmirables concours qui réunissent l'élite des pomologues de France etde l'étranger, LE PLANT DE POMMIERS Pépinières à la ferme. Une des premières questions, que se pose le propriétaire qui al'intention de planter un ou plusieurs vergers, est de savoir où etcomment il se procurera les pommiers qu'il mettra en terre, s'il lesprendra dans ses pépinières ou s'il les achètera à des pépiniéristes deprofession. La pépinière de ferme serait certainement la plus avantageuse si ellepouvait être bien faite et bien entretenue. Mais il existe beaucoup defermes qui n'ont pas dans leurs terres la nature du sol qui convient àl'élevage du pommier, et surtout, peu de cultivateurs s'astreindront,par suite de leurs occupations ordinaires, au travail continuel queréclame une pépinière, à une surveillance incessante, surtout l'été, aumoment des durs travaux. En admettant même qu'ils le fassent, il seraità demander encore qu'ils aient les connaissances requises pour procéderavec méthode. Examinons ce que fera le fermier s'il plante des pommiers provenant desa pépinière. Il commencera la première année par choisir les plusbeaux sujets parmi ses élèves, il les déplantera au milieu des lignesen coupant les racines des arbres voisins. L'année suivante, ledeuxième choix sera enlevé, toujours au détriment de ce qui restera enpépinière, et, enfin, les dernières années, il plantera tous les sujetsmal poussants qui ne seront jamais que des arbres improductifs et sansvaleur. Sur une pépinière de mille plants, à moins d'avoir un terrainexceptionnel et des soins trop rares dans ce pays, le cultivateurretirera en sept, huit ou même dix ans, une cinquantaine de pommiers depremier choix et peut-être une centaine de qualité inférieure, le restene méritera pas la peine d'être planté. Mais, tous ces sujets vicieux, que deviendront-ils ? Le cultivateur nepourra se résigner à les sacrifier et se rendant néanmoins compte queces arbres n'ont aucun avenir, il les plantera sans aucun soin. Vousvoyez le résultat : quinze ou vingt ans après la plantation, ces arbreschétifs ne rapportant rien, seront abattus et il sera nécessaire derecommencer le travail. Achat chez les pépiniéristes. Le propriétaire ou le fermier ne doit jamais planter que des arbres detout premier choix qui auront le grand avantage de pousser plusvigoureusement, de rapporter plus vite, et, en résumé, de coûterbeaucoup moins cher que les nouveaux plants. Il paraît bien plus économique d'acheter ses pommiers chez lespépiniéristes de profession ou chez les jardiniers du pays qui les fontvenir eux-mêmes des grandes pépinières. En Anjou notamment, depuisAngers à Doué-la-Fontaine, d'immenses pépinières d'arbres à fruits,connues du monde entier, peuvent nous livrer des plants de tout premierchoix à des prix réellement très modérés. Plusieurs de ces grandspépiniéristes demandent chaque année, au Syndicat pomologique, desmilliers de greffons des variétés recommandées, et, depuis quelquesannées, on peut avoir pleine confiance dans les noms des variétés. Toutpépiniériste sérieux refusera de livrer un plant qui n'aura de lavariété demandée que le nom porté sur l'étiquette, et nous devonsreconnaître que bien rares sont les maisons qui ne craignent pas decompromettre leur réputation en livrant des plants mal nommés. Un seul conseil pour acheter de bons et beaux arbres. Retenez longtempsà l'avance, en tout cas avant le 15 octobre, les arbres qui vous serontnécessaires. Demandez-les en tout premier choix et ne craignez pas uneplus-value de quelques centimes pour obtenir les meilleurs arbres. Enindiquant la date de l'expédition, vous recevrez des arbres nonfatigués qui reprendront très facilement et qui, en fin de compte, vousreviendront à beaucoup moins cher que les arbres de rebut que vousserez obligés de remplacer plusieurs fois. Plantation d'une pépinière de ferme. — La pépinière ne s'impose à laferme que dans le cas où l'on désire multiplier ou essayer des variétésnouvelles, ou bien, si le terrain exceptionnellement bon permet d'avoirl'espérance d'une excellente pépinière. Je donnerai donc en quelques mots les meilleurs moyens de faire unepépinière de ferme. Je n'entrerai pas dans le détail des opérations qui concernent le semiset la culture du jeune plant avant le repiquage. Le plus simple et leplus pratique pour un fermier est d'acheter un mille de plant d'un ande premier choix qui coûtera environ 25 à 30 francs. Le plant d'un an est de beaucoup préférable à celui plus âgé ; ilreprend mieux et, en général, donne de meilleurs résultats. Défoncement. — Le défoncement ne dépassera pas 40 centimètres, car ilne faut pas oublier que le pommier est un arbre à racines traçantesqui, par conséquent, ne cherchent pas à s'enfoncer en terre. Époque de plantation des pépinières. — Les pépinières devront êtredéfoncées pendant l'été ou l'automne et la plantation devra être faiteimmédiatement après la chute des feuilles. Disposition des pépinières. Les jeunes pommiers devront toujours êtreplantés en ligne allant du Nord au Midi et non de l'Est à l'Ouest,comme cela se fait trop souvent. Distance de plantation. — Une distance de 1 mètre à 1m25 entre lesrangs suffira parfaitement pour permettre le nettoyage nécessaire àtoute pépinière. Sur le rang, les pommiers devront être à 0m60 centimètres l'un del'autre. Cet espace est très suffisant pour permettre à la lumière depasser. Paillage. — Les conditions requises pour qu'une pépinière puissepousser très rapidement sont : la propreté la plus absolue et lepaillage pendant l'été, afin de conserver l'humidité du sol le pluslongtemps possible, et empêcher les mauvaises plantes de s'emparer dessucs nourriciers de la terre au détriment des pommiers. Les meilleurs paillages sont certainement les feuilles qui doivent êtredéposées à une épaisseur de 30 centimètres. Si les pommiers que vous avez plantés ont été obtenus de semis, il estcertain qu'il s'en trouvera une notable quantité qui n'auront qu'unevigueur très modérée, soit par leur espèce même, soit par toute autrecirconstance. Les pépiniéristes préfèrent écussonner sur le jeune plant des variétéstrès vigoureuses et poussant très vivement à bois, comme la noire deVitry, Fréquin de Chartres, etc., afin d'obtenir en quatre ou cinq ansdes arbres très forts pouvant être expédiés. Il est du reste très rare que ces arbres greffés en pied portent desvariétés très bonnes à fruits, à l'exception de la Grise Dieppoise ;aussi nous conseillons très vivement de greffer en tête tous les sujetsécussonnés au pied. Cette perte de deux ans sera pour vous la sécuritéla plus parfaite d'avoir pour plus tard des arbres fructifères. Il est nécessaire de laisser au jeune plant, tout le long de sa tige,une certaine quantité de brindilles qui appellent la sève et luipermettent de se tonner facilement en queue de billard, suivantl'expression consacrée, c'est-à-dire, bien plus gros à sa base qu'à lapartie supérieure. Ne pas oublier de pincer les brindilles à 15centimètres, et de les couper au fur et à mesure un ou deux ans avantla plantation. L'étiquetage des plants écussonnés ou greffés doit se faire par lignesentières afin d'éviter toute chance d'erreur, et le numéro de la ligne,ainsi que l'espèce, doivent être reportés sur un registre indispensableà toute pépinière bien tenue. Greffage en pépinière. Dès que le plant a atteint la grosseur nécessaire pour être greffé, ilest préférable de faire cette opération en pépinière parce que lessoins sont plus faciles à donner et, ce qui est surtout à considérer,dans ces conditions, le plant prend une avance de deux ans. En effet, que se passe-t-il lorsque vous greffez sur place ? Votrearbre a été transplanté lorsqu'il avait dix centimètres decirconférence environ, et ses racines viennent d'être mutilées par ladéplantation trop souvent mal faite. Au printemps suivant, les racinespeuvent bien partir, mais, au moment où la tête de l'arbre commence àattirer vivement la sève, vous coupez cette tige pour le greffage. Ilest évident que les racines, par réaction, se ressentent fortement decette opération et tombent souvent dans l'impossibilité d'émettre lasève qui soude la greffe, d'où la perte d'un certain nombre de sujetset de plusieurs années. Lorsqu'au contraire vous greffez en pépinière, vous devez le fairelorsque l'arbre mesure environ 7 centimètres de circonférence. A cemoment, le jeune pommier depuis trois ans en bonne terre a des racinestrès vigoureuses, qui pourront envoyer dans la tête de l'arbre unegrande quantité de sève et faciliter la reprise de la greffe. En deuxans, la tête de votre arbre sera formée, la cicatrisation de la plaiedu greffage sera recouverte par l'écorce et vous n'aurez pas à craindrela pourriture du cœur du pommier. Enfin, l'arbre sera dans lesmeilleures dispositions pour reprendre facilement, car les branches dela tête appelleront de suite la sève et la feront monter. Parconséquent, double avantage dans le greffage en pépinières : économiede temps et plus grande facilité pour la reprise en terre. Malheureusement, quelquefois les grands vents de l'hiver, en balançantles pommiers dans la pépinière, brisent quelques tiges. Le greffage enpépinière, malgré cet inconvénient, me parait certainement préférable. L'époque favorable varie suivant les années mais généralement se trouvevers fin mars pour la greffe en fente et souvent tout avril pour lagreffe en couronne ou anglaise. Modes de greffage. Je ne parlerai pas de la greffe intermédiaire ou écussonnage du pommierqui n'a pour but que de favoriser la végétation de l'arbre et d'obtenirqu'il n'occupe le terrain que le moins de temps possible. La greffe en tête, soit sur égrain , c'est-à-dire sur pommier nongreffé, soit sur pommier ayant une greffe intermédiaire, est la seulepratique, et recommandable. 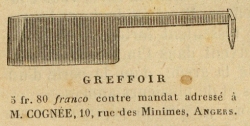 Il y a quelques années certains pomologues ont conseillé très vivementla greffe en couronne pour des sujets déjà très forts. Cette manière defaire avait le défaut de laisser une grande surface qui se recouvraittrès difficilement et amenait très souvent la pourriture de l'arbre. Enplus, la greffe en couronne n'a pas la solidité de la greffe anglaiseau galop. Lorsque l'on greffe en fente en pépinière, on peut prendre les sujetsde 7 à 8 centimètres de circonférence ; il est préférable de mettre unseul greffon, et de rabattre obliquement le dessus de la coupe del'arbre. Cette surface chez les jeunes sujets est parfois recouvertel'année même. Souvent le cultivateur place deux greffes en fente pour augmenter leschances de reprise. Cette méthode n'est bonne qu'à la conditionexpresse d'enlever la moins vigoureuse des deux, l'année suivantl'opération, car, si les deux greffes restaient et grossissaientensemble, elles se gêneraient mutuellement sans aucun profit, et, unjour ou l'autre, la tête viendrait à se fendre. Cette recommandationest utile pour toutes les greffes doubles ou triples de pommiers. Une greffe très solide, et qui donne des résultats parfaits pour lesjeunes pommiers, est la greffe anglaise ordinaire avec languette, tellequ'on s'en sert pour la vigne. La greffe anglaise au galop est aussi très bonne et peut être faitetrès vivement par le premier ouvrier venu. Un compte rendu de visitedans les pépinières d'Angleterre constate qu'un bon greffeur, suivi dedeux aides pour attacher les greffes, peut exécuter mille greffes parjour. Une excellente précaution est de mettre un tuteur assez léger auprès dela greffe et plus haut qu'elle, afin que oiseaux puissent se percher depréférence sur le tuteur et non sur le greffon. On peut employer avantageusement un osier auquel on donne la forme d'undemi-cercle dont les deux extrémités sont attachées le long du pommier. Quel que soit le système de greffage choisi, il est nécessaire deserrer fortement le greffon et de l'engluer soit avec de la terreglaise, soit (ce que nous conseillons) avec un mastic à greffer. Dans les pépinières, on emploie un mastic chaud économique pour degrandes quantités, dont voici les formules : 1re formule 1,250 gr., résine. 750 gr., poix blanche. 700 gr., suif. Ocre pour teinter ou cendre tamisée. 2me formule 300 gr., gemme. 100 gr., ocre. 400 gr., résine. 200 gr., graisse. 3me formule 10 kil., de gemme. 1/2 kil., cire jaune. 1 kil., ocre. Nous conseillons pour l'usage ordinaire du propriétaire ou ducultivateur un des mastics froids dont les noms suivent et qui ont étéessayés en 1896 par le Syndicat pomologique. Ces mastics sontnécessaires dans toute exploitation pour le greffage de quelques arbresseulement ou en cas d'accidents aux pommiers. Les principaux fabricants de mastics froids à greffer sont : MM. BIGOUDOT, à Paris. GOUSSARD, à Montreuil. Concordance de végétation entre les sujets. — Il faut, autant quepossible, pour donner à la greffe toute chance de reprise, que l'époquede la mise en végétation du sujet et du greffon soit la même ou en touscas qu'il y ait très peu de différence. Il est assez difficile de se rendre compte, dans une pépinière, ducommencement de végétation de tous les pommiers ; aussi, c'est une desraisons qui entraînent le pépiniériste à faire le greffageintermédiaire. PLANTATION La plantation est excessivement importante, peut-être même plus que lechoix de l'arbre, parce que tout arbre mal planté, après quelquesannées est voué à une mort certaine, avant même souvent d'avoir pudonner une récolte sérieuse. Dans les campagnes, malheureusement, il arrive trop souvent que lecultivateur cherche plutôt à planter un grand nombre de pommiers, demauvais sujets presque toujours, qui sont mis en terre dans desconditions telles qu'il est permis de se demander comment nous pouvonsespérer des récoltes avec de tels arbres. Ce n'est pas l'intérêt dupropriétaire et du fermier, car, une centaine de pommiers, bien plantéset bien soignés, donneront une récolte beaucoup plus fructueuse que 400ou 500 pommiers disséminés à droite et à gauche dans les haies, le longdes charroyères, exposés à toutes les blessures des voitures et desharnais, trouvant à peine la nourriture et l'air nécessaires qui leursont disputés par les grands arbres. On se plaint souvent de la disparition des pommiers. Franchement,comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Les causes de la mortalité des arbres fruitiers sont excessivementnombreuses et on peut en faire une classification : 1° Perte de l'arbre par la faute de l'homme ; 2° Perte de l'arbre par accident sans que la faute puisse en êtreattribuée à l'homme. 1° Perte de l'arbre par la faute de l'homme. — Dans les premièresannées, la mauvaise plantation est la cause la plus générale de la mortdes pommiers ; j'indiquerai plus loin comment il faut procéder pouropérer une plantation très bonne et peu coûteuse. Le défaut de tuteur entraîne souvent le décollement de la greffe etparfois même la perte de l'arbre qui, balloté par le vent, finit pars'écorcher ou se briser. Rappelons en passant que le tuteur doittoujours être mis en place très solidement, avant la plantation et nonaprès, comme cela se pratique souvent, afin de ne pas blesser les racines. Après la plantation, le pommier ne reçoit pas les soins qui luiseraient nécessaires pour activer sa végétation et obtenir des récoltesplus promptes et plus fructueuses. A peine si de loin en loin, on coupele buis mort et le gui, ce terrible parasite qui peut être comparé auphylloxéra de la vigne par la rapidité avec laquelle il tue l'arbre leplus vigoureux. Ce manque de soin est dû surtout à ce que les arbres, dans ce pays,sont plantés sur les haies, un peu partout, au lieu d'être rassemblésdans un verger. Vous avez certainement vu des pommiers atteints de maladie. Que fait lecultivateur ? Il ne s'en occupe pas, et avec un stoïcisme déplorable, ildira : « Les pommiers ne vivent pas vieux sur ma ferme, le terrain neleur convient pas, » et ce sera tout. Tant mieux encore s'il s'en tientlà et si, sous prétexte que le pommier ne peut rapporter sur sa ferme,il ne tire la conclusion qu'il est inutile d'en planter d'autres. Les propriétaires sont peut-être plus coupables encore que leursfermiers, parce que bien rares sont ceux qui s'occupent de lasurveillance de cette richesse de leurs fermes. Presque toutes lesmaladies des pommiers sont guéries par des traitements au pulvérisateur; mais malheureusement ces traitements sont trop rarement pratiqués, etpourtant, ils n'exigent ni beaucoup de temps, ni de fortes dépenses. Je demandais en 1892 à un fabricant de pulvérisateurs, s'il vendaitbeaucoup de ces appareils pour les pommiers. « En dehors de quelquesappareils expédiés dans deux départements de Normandie, me dit-il, nousvendons plus de mille appareils pour la vigne, contre un pour lespommiers. » J'avoue ne connaître qu'un seul propriétaire, à posséder unpulvérisateur pour arbres fruitiers. Et cependant les arbres fruitierssont une richesse de l'Ouest. Il est donc de notre intérêt de lesdéfendre contre les maladies, ce que nous ne pouvons faire d'unemanière efficace qu'en appliquant des traitements préventifs, commenous le verrons dans un prochain chapitre. Toutes les cultures de la ferme reçoivent du fermier une certainequantité d'engrais ; une seule exception est faite pour le pommier quidonne la récolte la plus avantageuse. Aucune plante, aucun arbre nepeut continuer à pousser vigoureusement et à produire régulièrement, sivous ne restituez au sol, sous forme d'engrais assimilables, lesrichesses qui sont enlevées chaque année par la récolte. Les essaisfaits dans ce sens depuis quelques années sont très probants. En outre,il faut prémunir les pommiers contre les blessures faites par lesbestiaux, les harnais, les voitures, etc. Et que dire de ce qu'onappelle le gaulage des pommes ? C'est la cause de presque tous leschancres qui existent dans les branches des arbres. Ce procédé doitdisparaître à jamais de toute ferme bien tenue, parce qu'il enlève toute espérance de récolteprochaine en détruisant les boutons à fruit, et qu'il diminueconsidérablement la vie de L'arbre qui meurt est, malheureusement, presque toujours la victime dupropriétaire ou du fermier, soit directement par de mauvais procédés deplantation, soit indirectement par le manque absolu de soins. A part les grands froids ou les chaleurs continues, les vents violentsou même la foudre, contre lesquels nul ne peut défendre sa propriété,presque toutes les pertes d'arbres fruitiers sont dues à l'homme. Quels sont donc les moyens à employer à l'avenir pour préserver nosarbres fruitiers de ces causes nombreuses de destruction et augmentercette partie de notre richesse nationale ? Comment disposer la plantation. La plantation de pommiers peut se faire dans une ferme de troismanières différentes que lieus allons examiner rapidement : 1° La plantation isolée est celle dans laquelle un arbre est mis enterre dans un emplacement plus ou moins propice, sans se préoccuper devoir si le pommier est dans la même ligne que les autres pommiers et àla même distance. Cette manière de planter était presque généraleautrefois, mais, heureusement, elle paraît disparaître petit à petit. Le long des haies, les pommiers étaient plantés près de grands arbresqui empêchaient la végétation et la fructification. Heureux encorequand leurs racines n'étaient pas enchevêtrées au milieu des racinesd'épines, ronces, etc., qui font de nos haies de véritables petitesfortifications. D'autres arbres, au contraire, sont disséminés au milieu des champssans former aucune ligne de sillon, de telle sorte que dix pommiers parexemple gêneront le laboureur dans quinze ou vingt sillons différentsau lieu d'être plantés sur le même. Qu'arrive-t-il forcément un jour oul'autre ? Le fermier ne peut prendre autant de précautions dans tousles sillons que s'il n'avait que deux ou trois lignes par champ, et lesarbres fruitiers sont sacrifiés avant même d'avoir pu rapporter; 2° La plantation en lignes à travers champs est trop connue pour qu'ilsoit nécessaire d'en donner la description. Elle est de beaucouppréférable à la plantation isolée parce qu'elle permet : aux arbresd'avoir l'air nécessaire, et au cultivateur en labourant de ne pascouper les racines, pourvu qu'il veuille bien sacrifier un peu deterrain. Les racines du pommier étant essentiellement traçantes seront forcémentdétruites par la charrue si le cultivateur n'a pas soin de suivre leconseil du Révérend Frère Henry, en laissant une bande de terre de deuxmètres de largeur environ sans labourer. « Cette bande de terrain, dit le Frère Henry dans son Traité desvergers, dans laquelle on a planté, ne devrait pas être labourée. Lelabour fait au pied des pommiers, avec la charrue, comme il se pratiqueordinairement, est plus nuisible que tout autre, car on ne peut manquerde briser ainsi un grand nombre de racines. On pourra, cependant, dansles conditions indiquées ci-dessus, planter des choux, des betteraves,etc., mais toujours à un mètre au moins du pommier. » Si nous insistons sur ce point, c'est que nous savons par expérienceque le terrain ainsi laissé sans labour est loin d'être un terrainperdu. Nous pouvons appliquer aux pommiers ce que nous avons constatépour des poiriers de grandes pyramides. Dans un potager où il y aquatorze cents mètres de terrain, deux mille huit cents mètres carrésont donné dans une bonne année six mille kilogrammes de fruits quireprésentent un produit bien supérieur à toute autre partie égale dupotager. » « Le terrain laissé ainsi sans labour est donc loin d’être perdu. Si,comme dans la plupart des cas, le cultivateur avait bêché jusqu'au pieddes arbres, de façon à en dégarnir le collet et à en mutiler lesracines, outre qu'il aurait eu des récoltes à peu près nulles commecelles que l'on recueille sous les pommiers, nous pouvons affirmer quela récolte des fruits aurait été diminuée de moitié. » Il est utile que les lignes soient disposées du Nord au Sud afin queles deux côtés des arbres reçoivent la bienfaisante chaleur du soleil,surtout au moment de la fécondation des fleurs. Néanmoins, dans les terres cultivées en sillons, il sera nécessaire demettre les lignes dans le sens de ces derniers et d'espacer un peu plusles arbres si la ligne n'est pas dans la direction Nord-Sud. Les seuls reproches que l'on puisse faire à la plantation en lignes,c'est, d'abord, d'empêcher le labour auprès de l'arbre, et ensuite,lorsque l'arbre est grand, de diminuer légèrement la récolte placéeau-dessous. Mais, remarquons bien que la plus-value considérable de larécolte de pommes permet de répondre victorieusement à ces objections,car aucune culture ne peut donner le même produit net et presque sanstravail. 3° La plantation en verger est de beaucoup préférable aux deuxpremières méthodes et semble avoir tous les avantages que nousdemandions pour la plantation des arbres à fruits. Tous les pommiers étant réunis dans un ou plusieurs champs à proximitéde la ferme peuvent recevoir les soins que jamais ils n'auraient s'ilsétaient disséminés. La facilité de la surveillance pour le fermier lui permettra de soignerles arbres, de voir les premières attaques de maladies et d'y remédier.Les pulvérisations seront beaucoup plus faciles, tous les arbres étantproches les uns des autres. Si un tuteur ou un entourage vient à sebriser, cet accident sera vite réparé. La distribution de l'engrais auxpommiers sera facilitée également. Le grand avantage des vergers est d'empêcher le gaulage des fruits à larécolte. Dans les terres labourées, il arrive forcément que, pour nepas faire les semailles en retard, ou, pour ne pas faire passer lescharrettes chargées de pommes sur les ensemencés, les fermiers abattentà grands coups de gaule, vers le 15 octobre, des pommes qui nedevraient tomber de l'arbre que fin novembre. Il résulte de cette manière de faire que la récolte suivante estsacrifiée, et que l'arbre lui-même en ressent les plus grands dommages.Avec la culture en verger, rien de tout cela n'arrive ; dès que lespremières pommes tombent, vous retirez de la pâture les jeunesbestiaux, si vous êtes forcés de les mettre dans votre verger, et vousramassez, suivant les variétés, les pommes de vent d'abord et ensuiteles pommes de première, deuxième et troisième saison. Vous constaterezalors que vos pommiers n'étant plus gaulés, vous rapporteront presquerégulièrement tous les ans. Par ailleurs, grâce à la facilité de surveiller les arbres et deréparer les 'accidents dans l'entourage, les blessures faites à vosarbres par les bestiaux seront très rares, et même le cas échéant, vouspourrez les recouvrir de suite de mastic à greffer et éviter ainsi ceschancres qui détruisent tant de pommiers. Nous recommandons donc très vivement cette dernière méthode et il nedevrait exister aucune ferme, grande ou petite, dépourvue de verger. Malgré toutes nos préférences pour les vergers, nous devons toutefoisreconnaître que dans toute ferme, il est nécessaire de se servir destrois modes de plantation. Ainsi, le long d'une route, d'un chemin, surune haie nouvelle, il est important de planter des pommiers partout oùl'emplacement et la nature du terrain le permettent. De longues lignes de pommiers bien orientés au milieu de grands champs,seront également une grande source de revenus ; mais, la plus grandequantité d'arbres à fruits, celle qui devra fournir la récolte et lerevenu, devront être en vergers. Choix du terrain. Tout terrain peut, convenir au pommier pourvu qu'il ait 40 centimètresde terre ; néanmoins, les terres argilo siliceuses sont celles où cetarbre prend ses plus grandes dimensions. J'ai planté un verger dans un terrain que le fermier se refusait àlabourer, le trouvant trop mauvais : les pommiers y sont trèsvigoureux. Dans les terrains de sable, on rencontre de forts beauxsujets donnant des cidres très parfumés. Beaucoup de terrains incultes, sur des buttes ou des coteaux ne donnantaucun revenu, seraient d'un rapport excellent après 12 à 15 ans deplantation et même moins, à la seule condition d'apporter à l'entretiendes arbres des soins convenables. Distance. La distance à laisser entre les arbres varie d'après le genre deplantation : vergers, lignes, arbres isolés. La qualité du terrain sera également à faire entrer en considération,et en outre, on devra tenir compte de la vigueur probable de l'arbrepour augmenter ou diminuer l'écartement. En vergers, les lignes devront toujours être disposées du Nord au Sud,afin que le soleil puisse atteindre les fruits des deux côtés. Unedistance très recommandable est de 12 mètres entre les lignes et 10mètres sur le rang, soit environ cent arbres à l'hectare ; à cause dela ligne de clôture, cette distance donne donc 100 à 120 mètres carréspar arbre. La plantation en carré est plus avantageuse et elle permet de remplacerplus tard avec une grande facilité les arbres du verger. En lignes, il est encore préférable de planter du Nord au Sud, et dansce cas, une distance de huit mètres est très suffisante entre lesarbres. Si, par hasard, les lignes par la position du terrain devaientêtre dirigées de l'Est à l'Ouest, il serait bon de laisser une distancede 9 à 10 mètres. Quant à la distance des lignes entre elles, la configuration du terrainsera presque le seul guide. En général une distance de 25 à 30 Mètressera utile pour la culture du champ. Les arbres isolés doivent être plantés autour des champs, sur leshaies, à des distances variables suivant les autres arbres et leurnature, la qualité du terrain, etc. Ainsi, dans un terrain rocailleux,il est préférable de chercher par des sondages les endroits où la terreest plus épaisse et de qualité supérieure. Il est nuisible dans ce casde tenir compte des lignes et de leur symétrie. Les arbres plantés sur les bords des routes fréquentées donnent presquechaque année d'abondantes récoltes. On attribue ce fait à la poussièredes routes qui favorise la fécondation des fleurs et par suite lafructification de l'arbre. Les arbres isolés doivent être plantés dans les terrains incultes,partout où ils ont quelque chance de pouvoir vivre. Vous voyez souventdes arbres s'élever entre deux rochers où jamais vous n'auriez osé enplanter. Nécessité de planter ensemble les variétés mûrissant à la même époque. On doit prendre le plus grand soin, lorsqu'on greffe différentesvariétés, ou lorsqu'on plante en verger, ou en ligne, de toujoursréunir ensemble les variétés mûrissant à la même époque, afin de ne pasgêner le transport des pommes de première saison, de faciliter lamain-d’œuvre, et d'augmenter, par la suite, les qualités du cidre enn'employant que des pommes parfaitement mûres. La même observation s'applique aux poiriers à cidre. Plantation. — Trous. Les trous à pommiers doivent être parfaitement faits, suivant la naturedu terrain, car l'avenir de l'arbre dépend pour beaucoup de saplantation. Les dimensions d'un trou doivent être au moins de deux mètres de côtésur 40 centimètres de profondeur. Dans une mauvaise terre ou un terraintrès sec, les dimensions en surface doivent même être augmentées. Lesracines du pommier n'étant pas pivotantes, ne réclament pas cesvéritables caves de un mètre ou même plus de profondeur, comme on enfaisait autrefois, dans lesquelles les racines, attirées par la bonneterre, poussaient avec une grande vigueur jusqu'au jour où, ne pouvantplus remonter à la surface, elles pourrissaient, manque d'air. Lesracines des arbres fruitiers ont un besoin absolu de l'airatmosphérique, il est nécessaire qu'elles puissent se développer à leuraise à une très petite profondeur. Voici comment un trou à pommier doit se faire : Il peut être rond ou carré, peu importe, pourvu qu'il ait la grandeurdésirable. On doit commencer par tracer les bords du trou à la pioche ;ensuite on enlève le gazon ou la terre du dessus que l'on place d'uncôté du trou, mais toujours le même pour toute la plantation. Nous enverrons plus tard l'utilité. Le creusement du trou doit se faire jusqu'à 35 ou 40 centimètres auplus. La terre de moyenne qualité sera placée en tas sur une autre face dutrou, et enfin, toutes les grosses pierres devront être enlevées etformeront un troisième tas. Lorsque le fond du trou sera parfaitement fini, il est utile de donnerun léger coup de pioche à 10 centimètres environ, mais sans enlever laterre. En règle générale, les dimensions du trou sont à l'inverse de laqualité du terrain ; ainsi, dans une très bonne terre, deux mètres deterrain suffiront, lorsqu'il faudra trois mètres dans un terrain demauvaise nature. Époque. Les propriétaires auraient grand intérêt à faire faire les défoncementsplusieurs mois à l'avance, car, la terre du fond emmagasinerait unecertaine quantité d'azote, et gagnerait certainement en qualité et enlégèreté. Dans la pratique, malheureusement, à cause des grands travauxde la récolte, il est difficile de trouver des travailleurs. Nousrecommandons en tous cas de faire creuser les trous avant le 15octobre, de façon à pouvoir planter du 1er novembre au 1er décembre. Lepommier mis en terre à ce moment reprendra beaucoup plus facilementparce que le traitement des terres bêchées sera déjà presque fait etles radicelles commenceront à se former pendant l'hiver avant l'entréeen végétation. L'arbre planté dans ces conditions avant le 1er décembregagnera un an et sa reprise sera certaine. Il est très rare qu'il soitpossible de planter en décembre ou janvier, car, si la terre est tropmouillée, la plantation se fait dans de très mauvaises conditions quiinflueront sur l'arbre pendant toute son existence ; s'il gèle, d'unautre côté, il est impossible de songer à planter parce que tout arbredont les racines auront été recouvertes par la terre gelée, risque dene pas prendre. Si on ne peut planter en novembre, mieux vaut encore attendre févrierque de mettre un arbre en terre par le gel ou lorsque le sol a tropd'humidité. Rappelons en passant qu'il ne faut jamais laisser en terre de vieillesracines, et que la pratique de mettre au fond des trous des fagots debois ou de genêts, est détestable parce que le pourridié (blanc desracines) se développera et détruira l'arbre en quelques années. Mise en terre. Avant de procéder à la plantation, il faut tout d'abord fixer trèssolidement, à l'emplacement voulu, le tuteur du pommier. Vous éviterezainsi les meurtrissures des racines, inévitables lorsque le tuteur estplacé après la plantation et vous aurez le grand avantage de maintenirvotre arbre droit contre le vent, grâce à la solidité du tuteur.Autrement, souvent il arrive que c'est l'arbre qui soutient le tuteur. Vous devez profiter d'un temps doux et sans eau pour faire votreplantation. Comme ces jours sont trop rares en hiver, c'est le momentde ne jamais remettre au lendemain ce qui peut être fait le jourmême. Il est nécessaire d'être trois pourbien planter. Vous commencerez par mettre autour de votre tuteur des mottes de gazonsi vous en avez, en retournant l'herbe à l'envers, ou de la bonne terreretirée du dessus du trou. Ce petit monticule doit avoir la hauteursuffisante pour que le collet de l'arbre se trouve au niveau du sol.L'arbre en pépinière a toujours ses racines plus fortes du côté duMidi, aussi, il est préférable en le plantant de toujours disposer lesplus fortes racines de ce côté, et de placer par conséquent le pommiertel qu'il était en pépinière par rapport au soleil, ce qui est facile àvoir par les racines et souvent la peau du sujet. Il est préférable de placer l'arbre contre le tuteur du côté où lesvents sont plus à craindre. Pendant qu'un des aides tient le pommier dans la position voulue,l'autre jette doucement et très peu à la fois, la terre la meilleurequ'il a eu soin de bien émietter auparavant. Vous devez faire entrercette terre entre toutes les racines que vous aurez écartées auparavantsur le petit monticule du fond du trou. Ensuite, lorsque les racines auront été recouvertes de quelquescentimètres de terre, vous devez répandre sur la terre à l'extrémité etsur les racines, quelques poignées d'engrais chimiques préparésspécialement pour le pommier. Votre aide continuera à mettre la terre doucement au pied, pendant quevous-même, de temps en temps, vous répandrez un peu d'engrais sur cecône de terre qui va toujours en s'agrandissant. Les racines du pommiertrouveront en peu de temps l'engrais répandu en plusieurs couchesau-dessus et devant les radicelles, qui, en dix ans, acquerront undéveloppement qu'autrement ils auraient à peine obtenu en vingt ans. Dans un chapitre spécial, je parlerai de l'engrais des pommiersabsolument nécessaire pour obtenir à peu près régulièrement de trèsbelles récoltes de pommes. Vous devrez fouler très légèrement au piedla terre autour de votre arbre, mais, si la terre est mouillée, mieuxvaut laisser le tassement se faire naturellement. Le trou devra être recomblé de suite en évitant de déranger l'arbre eten ayant soin de former autour du tronc une petite cuvette destinée àretenir la pluie. Il est nécessaire de n'attacher le pommier au tuteur que lorsque letassement est déjà bien avancé, car, dans le cas contraire, l'arbreresterait suspendu à son tuteur et des vides se produiraient autour deses racines qui pourraient par la suite périr. Vous devrez avoir habillé vos pommiers avant la plantation,c'est-à-dire que vous leur couperez à la serpette et non au sécateur,l'extrémité des racines mutilées seulement par l’arrachage ou letransport, en ayant grand soin de conserver tout le chevelu ouradicelles si elles sont encore vivantes. Dans le cas contraire vousdevez les couper, mais seulement jusqu'à la partie vivante. Beaucoup dejardiniers taillent à même les racines des arbres qu'ils plantent,c'est un tort. Qu'ils essayent de planter en conservant toutes lesracines vivantes et ils se rendront compte que ce procédé est lemeilleur. Pour faciliter la reprise, il est recommandé de tremper les racinesdans un mélange de terre, de bouse de vache et d'eau. Il est utile, les premières années de la plantation, de badigeonner lesarbres avec un mélange de terre, de chaux et de bouse de vache auxquelson ajoute un peu de sulfate de fer. En employant ces moyens trèssimples et peu coûteux, votre verger vous donnera des récoltes lorsquevotre voisin, qui n'aura pas suivi cette méthode si simple, en seraencore réduit à remplacer chaque année les victimes que son ignoranceou le défaut des précautions que je viens d'indiquer fera parmi sespommiers. Les propriétaires mettent Souvent dans leurs baux, « que les fermiersdevront planter un certain nombre de pommiers qu'ils épineront,cobêcheront, et rendront pris et vifs, greffés de bonnes espèces. »Cette clause peut exister sur le papier, mais jamais elle n'est mise enpratique. Le fermier, trop souvent, néglige les soins nécessaires àdonner dans la plantation, dans le choix et dans l'entretien dessujets. Beaucoup sont difformes ou sans vigueur et, fréquemment, ceuxqui échappent aux coups des bestiaux ou de la charrue, ne sont jamaisébourgeonnés et sont greffés avec des espèces locales souvent sansvaleur. En un mot, la grande généralité de ces pommiers périt avantd'avoir rapporté. Il me semble que le propriétaire aurait au contraire tout avantage àacheter lui-même les meilleurs sujets, et à les faire planter sous sadirection et comme il l'entendrait par le fermier qui alors, par bail,s'engagerait à donner les soins aux arbres et se porterait responsabledes accidents. Le propriétaire en donnant un peu de bois peut obtenirde très bons tuteurs et des entourages capables de résister auxbestiaux, tandis que le fermier se contentera de mettre quelquesépines, sans valeur il est vrai, mais aussi sans durée efficace. D'un autre côté, on voit des agriculteurs s'occuper avec le plus grandsoin de la surveillance des récoltes, de l'élevage des bestiaux, en unmot, de tout ce qu'ils croient regarder leurs intérêts dans la ferme ;mais, bien rares sont ceux qui surveilleront leurs vergers et quitiendront à ce que leurs pommiers aient les soins qu'ils méritent.Comment voulez-vous que les fermiers qui sont peut-être pour un bail de9 ans, peut-être pour quelques années dans la ferme, fassent le peu detravail nécessaire aux pommiers, si vous ne leur montrez pas l'intérêtque vous portez à la réussite de vos arbres ? C'est même l'intérêt dufermier, parce que beaucoup d'entre eux sont dans les mêmes fermesdepuis de longs baux, et qu'ils ont toute chance d'y rester s'ils fontbien leurs fermes. Les intérêts du propriétaire et du fermier sontidentiques. Combien connaissons-nous de cultivateurs laborieux quipresque chaque année paient la plus grande partie de leur fermage avecle produit des pommes et du cidre Aucun propriétaire ne refusera à un fermier de lui payer les plantspour faire un verger tel que je l'indique, s'il a confiance quo laplantation sera bien faite et bien entretenue dans la suite. SOINS A DONNER AUX ARBRES Après la plantation, l'agriculteur doit surveiller avec leplus grand soin ses arbres et les mettre à l'abri des bestiaux qui,souvent dans une nuit, peuvent détruire le commencement d'un verger. Entourages. Les pommiers doivent donc être protégés par une armature, suffisammentforte pour résister aux bestiaux, faite dans des conditions tellesqu'elle ne blesse pas l'écorce de l'arbre. En outre, il est désirablequ'elle soit très bon marché et facile à faire, à réparer ou àentretenir par le premier ouvrier venu. Les entourages en fer sont excellents comme solidité, mais souvent, parles grands vents, lorsque les arbres sont vigoureusement secoués,l'écorce est enlevée par le frottement continu contre le fer, ce quidonne naissance aux chancres. Il est juste, néanmoins, de reconnaîtreque cet accident n'arrive pas lorsque l'arbre est parfaitement attachéà un tuteur déjà très solidement piqué en terre ; mais il arrive,malgré tout, qu'un jour ou l'autre l'attache vient à pourrir et alors,dans ces conditions, l'accident évité au début se produit fatalement.En plus, quelquefois les bestiaux enlèvent l'armature tout d'une pièceet font aux pommiers des plaies très profondes et incurables. Nous conseillons pour entourer les pommiers, des perches de châtaignierfendues et réunies entre elles par des fils de fer ou une lame de zinccomme les barricades de chemin de fer. On peut aussi placer trois perches de châtaignier fendues en deuxautour de l'arbre, en forme de triangle, réunies en haut et en bas pardes planchettes. En plus, une ronce artificielle attachée au haut,faisant plusieurs fois le tour de l'entourage avant d'être fixée aubas, protègera facilement l'arbre contre les bestiaux qui auraient lafantaisie de s'y gratter. Ces deux genres d'entourages sont très pratiques et peu coûteux. Paillage. Pourfaciliter la reprise de l’arbre et lui donner une végétation trèsvigoureuse, il est utile de couvrir la terre autour de l'arbre, defumier, genêts, ajoncs, de tous détritus en un mot qui pourront formerécran contre le soleil et empêcheront les mauvaises herbes de croîtreen s'emparant des engrais réservés aux arbres. Cetteméthode, préconisée pour la première fois par le Révérend Frère Henry,a rendu les plus grands services dans les vergers. Ce savantarboriculteur se fera un plaisir, si un jour votre bonne étoile vousconduit à l'Institut Saint-Vincent, à Rennes, de vous montrer, dans sonverger, les résultats surprenants obtenus dans une mauvaise terre avecce procédé. Il vous montrera des pommiers paillés, suivant sonexpression, avec de la sciure de bois, des feuilles d'arbres vers, mêmeavec des pierres d'ardoises. Les troncs de choux, qui souvent ne sont pas utilisés, conviennent très bien pour le paillage. Cobéchage. Lesjeunes arbres doivent être cobéchés chaque année pour détruire lesmauvaises herbes et pour tenir la terre très émiettée. En voici laraison : l'humidité qui entre l'hiver en terre en sort beaucoup plusvite lorsque la partie supérieure n'est pas ameublie et forme unecroûte ; c'est la loi de capillarité qui est traduite par ce proverbepopulaire : « Un binage vaut quatre arrosages. » Une expérience biensimple vous prouvera le fait. Prenez une soucoupe, versez un peu de vinrouge et placez une pierre de sucre ; le vin montera petit à petit etbientôt le sucre sera rouge ; c'est la capillarité qui aura attiré levin en haut. Recommencez l'expérience avec une pierre de sucre platesur le dessus, où vous formerez une petite pyramide avec du sucre trèsfinement pilé. Vous constaterez que le vin monte très facilement dansla pierre de sucre et que, dès qu'il atteint le sucre pilé, il ne peutplus monter que très lentement, si encore il ne s'arrête pascomplètement. C'est la meilleure preuve que la terre se dessèchebeaucoup plus vite lorsqu'elle est en croûte que lorsqu'elle estparfaitement ameublie. Taille. Ilne peut être question pour le pommier à cidre de le tailler comme lesautres de jardin. Il est néanmoins très utile, les deux ou troispremières années au moins, de rabattre légèrement les jeunes tiges afinde les faire ramifier. Pour faire cette opération si facile, pour bienformer la tête de l'arbre, nous vous recommandons de toujours rabattreau-dessus d'un œil dirigé vers l'extérieur de l'arbre. Il résulte decette manière de faire, que la branche se dirigera en dehors et que lecentre sera dégagé pour permettre l'introduction de la chaleur et de lalumière. Quelques variétés demandent à être taillées unpeu plus longtemps, comme la Médaille d'Or, ces variétés poussent bien,mais les branches restant grêles, le cultivateur a intérêt à fairegrossir les branches charpentières. Incision. Ilarrive fréquemment que l'écorce de l'arbre, devenant très dure, ne peutpas facilement se prêter au développement de l'arbre et que celui-ciest ainsi gêné dans sa croissance. Un moyen excellent, toujoursindispensable quand on emploie les engrais à pommiers, est de faire desfentes longitudinales dans l'écorce de l'arbre. Ces fentes doiventcouper très proprement l'écorce seulement, sans attaquer le bois etêtre faites sur le côté regardant le nord, au mois de mars. Pour éviterde faire les fentes trop profondément, il est utile de se servir d'uninciseur à arbres : une petite lame très tranchante est disposée autravers d'une bouled'acier, destinée à empêcher de blesser les arbres. On règle lalongueur de la lame par une vis, suivant l'épaisseur de l'écorce. 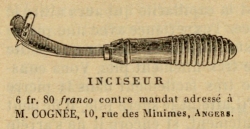 Engrais des arbres. Depuisquelques années, on a reconnu la nécessité absolue de donner desengrais aux arbres fruitiers. Les premiers essais ont été faits enBelgique, dans le duché du Luxembourg et en Allemagne ; les essaisfurent des plus fructueux, et dans ces différents pays la fumure desarbres fruitiers est presque générale. Tout arbre, engrandissant, enlève au sol une certaine quantité de matièresnutritives, comme l'azote, l'acide phosphorique, la potasse, etc. Laterre garderait la même fertilité si les produits restaient sur le mêmesol et lui restituaient pour ainsi dire les éléments mêmes de leurformation. Pour toutes les cultures, et notamment le pommier, il n'enest pas ainsi. Les récoltes de pommes sont vendues et transportées auloin ; les feuilles mêmes qui, dans les forêts conservent la fertilitédu terrain, sont enlevées par le vent ; aucun des produits des pommiersne rend au sol les matières dont il est formé. Dans ces conditions, ilest donc certain que la meilleure terre ne peut longtemps prodiguer desrécoltes abondantes et que l'agriculteur est forcé de rendre au sol pardes engrais de restitution tout ce qui lui a été enlevé. Sivous voulez avoir de bonnes récoltes sur vos champs, vous ne craignezpas de mettre quelques sacs d'engrais. Pourquoi ne pas en faire autantpour les pommiers ? Autrefois, jamais les prairies ne recevaient de fumure ; l'expérience a prouvé que la récolte était doublée par ce moyen. Lavigne aurait été perdue, disait-on, si elle avait reçu des engrais, sonvin serait devenu détestable. Aujourd'hui, il est reconnu que la vignedoit être graissée pour avoir de bonnes récoltes. Pourquoi voudriez-vous que les pommiers seuls fassent exception à cette loi de la nature ? Toutd'abord , les marcs de cidre sont un très bon engrais pour les pommierset donnent des résultats surprenants. Voici comment il faut lesemployer : A la sortie du pressoir, vous en formez une couche de 10 à15 centimètres de hauteur. Au-dessus, vous répandez un peu de phosphatede chaux ou de scories de déphosphoration. - La troisième couche seracomposée de terreau ordinaire et vous continuerez ainsi jusqu'à la finde la fabrication du cidre. Environ deux mois après,brassez le tout ensemble et recommencez l'opération plusieurs fois dansl'année. Vous aurez un terrain excellent qui ne vous aura coûté quequelques sacs de phosphates ou de superphosphates et vos pommiers vousprouveront par leur récolte abondante leur reconnaissance. Laquantité de marcs de cidre, malheureusement, ne peut suffire à fumertous les arbres, et nécessite des frais de transport assez élevés ;aussi les engrais chimiques sont-ils très employés pour les vergers. Lafacilité de transport, de distribution et la possibilité de les enfouirsur les radicelles, expliquent la vogue dont ils jouissent dans lespays cités plus haut. Un seul engrais complet, malheureusement, ne peut servir à tous les arbres. Parmiles pommiers, les uns poussent avec une vigueur exubérante qui lesempêche de fructifier, la sève se transforme en feuilles et en bois, cequi n'est pas le but de l'arbre qui nous occupe. Les autres, aucontraire, ne viennent pas, ils sont chétifs et donnent pendant decourtes années quelques fruits jusqu'au moment où on sera forcé de lesabattre. D'autres, enfin, sont assez vigoureux et donnent de bonnesrécoltes qui néanmoins s'amoindrissent petit à petit. Vousdistribuerez à tous les éléments qui leur font défaut sous formed'engrais. Vous donnerez à ceux qui se portent tout en bois et enfeuilles les matières qui leur manquent pour se mettre à fruits. Les arbres faibles recevront un engrais qui activera leur végétation. Et, enfin, vous rendrez aux troisièmes les matières nutritives enlevées par les précédentes récoltes. Nous devrons donc diviser nos engrais pour trois catégories d'arbres : 1° Engrais pour pousser à bois et activer la formation de l'arbre ; 2° Engrais pour l'entretien de l'arbre et la restitution des récoltes ; 3° Engrais pour amener la fructification des arbres trop vigoureux poussant à bois et sans fruits. Lesengrais à pommiers doivent être enterrés au-dessus des radicelles del'arbre, plus ou moins loin du tronc, suivant la grosseur de l'arbre.La première qualité de ces engrais spéciaux à rechercher est d'êtretrès facilement assimilables, afin que les dernières pluies duprintemps dissolvent tous ces produits. Des essais comparatifsd'engrais à base d'acide phosphorique ont été essayés dans mon vergerd'étude et ont donné des résultats parfaits pour l'accroissement desarbres. Nous tenons à remercier M. Delafoy, de Nantes, M.Mellet, phosphates de Carentan (Manche) et la Société des scoriesThomas, qui ont mis généreusement à notre disposition tous les engraisnécessaires. Bien que les résultats ne puissent être connusqu'en novembre, nous pouvons assurer que l'emploi de ces différentsengrais est à propager et à conseiller à tous nos lecteurs, pourl'accroissement de l'arbre et la mise à fruit. Les essaisauraient été plus concluants si la grêle n'avait pas arrêté en Août lavégétation des arbres ; aussi comptons-nous poursuivre l'expérience en1898. La maison Pilon frères, Buffet et Durand-Gasselin ,de Nantes, fournit un engrais de poudre d'os azoté qui a égalementdonné de bons résultats. Voici du reste la note publiée à ce sujet par cette maison : NOTE sur la POUDRE D'OS PILON préparée spécialement pour l'emploi direct en Agriculture. Le bas prix actuel de la Poudre d'Osnous engage à appeler l'attention des agriculteurs sur ce produitprécieux, comme engrais, puisque 100 kilogrammes de Poudre d'Oscontiennent (1) : 2 à 3 kilogrammes d'azote. 20 à 25 « d'acide phosphorique. 1O à 30 « de matières organiques animales. Les agronomes ont tous, et toujours considéré la Poudre d'Oscomme l'engrais par excellences à la condition qu'elle soit présentée àla plante sous une forme bien assimilable, résultat qu'atteintparfaitement le traitement que nous lui faisons subir par des procédésspéciaux. L'analyse démontre, en effet — et nous le garantissons — que dans ces Poudres d'Os l'acide phosphorique est à l'état : pour 1/3 environ soluble dans l'eau et le citrate d'ammoniaque etle reste 2/3 « « » le citrate acide(méthode Wagner). Quant à l'azote, sa provenance des os, chairs, sang, débris d'animaux, indique qu'il est d'une assimibilité parfaite. Dansde telles conditions, il est certain que l'acide phosphorique estentièrement assimilable et solubilisé par les acides faibles du sol,particulièrement par l'acide carbonique, produit par la décompositionde la matière animale de l'os, dont l'azote, se transformant enammoniaque et en nitrate, est absorbé par la plante au fur et à mesurede la décomposition. Les radicelles trouvent donc ainsi etsuccessivement tout préparés les aliments nécessaires à la végétationde la plante qu'elles ont mission de nourrir. La Poudre d'Osne fatigue pas et n'épuise pas la terre ; comme du fumier on peut enuser et en abuser, car, avec le fumier, elle est simplement larestitution au sol de ce que les récoltes et animaux lui ont enlevé,c'est-à-dire la mise en pratique de la théorie la plus vraie de lascience agricole. Aussi les agriculteurs ont-ils pu, par des fumuresannuelles de fumier et de Poudre d'Os, cultiver pendant plusieursannées consécutives des blés sur la même terre, avec d'excellentsrendements, sans qu'elle manifestât le moindre épuisement. Du reste — et c'est là sa grande supériorité sur les engrais minéraux — par sa composition exclusivement organique, la Poudre d'Os arrive fatalement dans le sel à une décomposition entière et intégrale, et si une première récolte n'utilise pas tous ses éléments, une prochaine récolte en profitera, mais rien ne sera perdu. L'Angleterre,l'Allemagne, la Belgique, où la culture est malheureusement plusavancée qu'en France, consomment des quantités considérables de Poudre d'Os ; en Angleterre, c'est le fond de toutes les fumures, sans exception ; en France, nous restons en arrière. Celapouvait s'expliquer autrefois, alors que ce produit était ici à un prixélevé. Aujourd'hui nous fabriquons à meilleur marché que les Anglais etleur en expédions des quantités importantes qui, dans l'intérêtgénéral, seraient bien mieux employées en France. Que nos cultivateurs usent donc largement de la Poudre d'Os ; ils s'en trouveront bien. EMPLOI La Poudre d'Os,par sa composition naturelle, sa teneur en azote organique, acidephosphorique et matières animales, doit être considérée comme un fumierconcentré et appliquée comme lui à toutes les cultures, sans crainte defatiguer ni d'épuiser la terre qu'elle enrichit, au contraire, en humus: aucun autre engrais ne peut remplacer aussi utilement le fumier quimanque à la ferme ; les résultats qu'elle donne dans la culturemaraîchère en sont la preuve. En culture ordinaire, la Poudre d'Oss'emploie seule à la dose de 500 kilog. à l'hectare, ou commecomplément du fumier en calculant que 100 kilog. équivalent à 6 à 8mètres cubes de bon fumier d'étable. — Il faut l'épandre aussisoigneusement que possible, soit à la volée, soit au semoir quifonctionne toujours très régulièrement avec ce produit d'unepulvérulence absolue, — recouvrir ensuite par un hersage ou un légerlabour. En culture intensive, que tous les cultivateurs devraient aujourd'hui pratiquer, nous conseillons les compositions suivantes qui sont très faciles à faire à la ferme, la Poudre d'Os étant un produit très sec et pulvérulentd'un mélange aisé avec les sels ammoniacaux et potassiques ; pour lesquantités d'une certaine importance, nous faisons ces mélanges àl'usine, moyennant 0,25 cent. par 400 kilos. 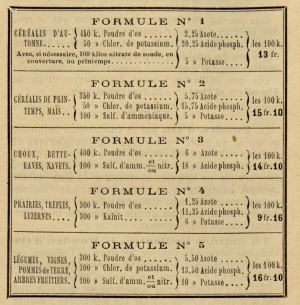 Les prix de revient sont calculés en prenant pour bases les prix moyens de : fr. 12 les cent kilog. pour la Poudre d'Os ; »22 » » le chlorure de potassium à 50. ; » 22 50 » » le sulfated'ammoniaque à 20/21°; » 21 50 » » lenitrate de soude 15/16'; 6 50 » « « le kiinit 12/14°. Il est facile au cultivateur de lesfaire exactement en modifiant les prix des éléments suivant les cours ;il doit aussi modifier les quantités de chaque élément suivant lesbesoins de sa terre, dont il se rendra aisément compte par des essaiscomparatifs avec des formules variées. Nous pensons, en tout cas, luidonner à coup sûr un bon conseil en l'engageant à faire des formulestrès riches en acide phosphorique, cet élément faisant toujours défaut,surtout dans notre région de l'Ouest. PILON frères, J. BUFFET et H. DURAND-GASSELIN, à NANTES (Loire-Inférieure). (1) Les chiffres exacts de ces trois éléments varient quelque peusuivant que les os travaillés sont plus ou moins frais : les os fraisétant proportionnellement plus riches en azote et matières animales etmoins en acide phosphorique ; les os secs, plus riches en acidephosphorique et moins en azote et matières animales. La moyenne 21/2d'azote, 22 1/2 d'acide phosphorique et 25 de matières animalespeut-être considérée comme exacte. Voici notre mode d'emploi : Enfévrier ou commencement de mars, lorsque le temps semble indiquer unepluie prochaine, un ouvrier répand autour de la zone des radicelles unecertaine quantité de l'engrais 1, 2 ou 3, suivant la vigueur del'arbre. Cet engrais est ensuite cobêché en terre au-dessus desracines, mais en évitant de les atteindre avec la binette. Pour lesarbres moins vigoureux, nous conseillons de faire quatre ou cinq trousde 8 à 40 centimètres autour du tronc vers l'extrémité des radicelleset d'y déposer l'engrais. Ces trous, restant découverts, recevront la'pluie, et les engrais, très vivement 'décomposés, seront assimilablesde suite. La quantité d'engrais est variable d'après l'arbre ; mais, engénéral, 1 kilo par jeune pommier est très suffisant. Il est évidentque la quantité doit être désignée par l'expérience, par la nature duterrain, l'exposition, etc. Les arbres vigoureuxrésistent beaucoup plus facilement aux grands froids comme aux extrêmeschaleurs, ainsi qu'à toutes les maladies diverses et à tous lesparasites, animaux ou végétaux. Maladies. Nousavons pu voir dans les précédents chapitres que les pommiers nereçoivent pas les soins les plus élémentaires ; est-ce donc que cetarbre n'a pas, comme la vigne, les ennemis les plus terribles ? Lepropriétaire doit donner à ses arbres les mêmes soins que le vigneronapportera à sa vigne, car le pommier a, malheureusement, un très grandnombre d'ennemis que je passerai très rapidement en revue en indiquantle traitement. Tous ces ennemis s'attaquent de préférence auxarbres les plus faibles, à ceux qui ne reçoivent aucun engrais. Ilspeuvent passer l'hiver sous les écorces des pommiers, dans lescrevasses et les fentes produites par les chancres, sous la moussesurtout qui envahit tant d'arbres souffreteux. Letraitement général contre tous les ennemis du pommier est de gratterles vieilles écorces, couper les bois morts, et ensuite projeter surl'arbre, avec un pulvérisateur à pommiers, un lait de chauxnouvellement éteinte auquel il sera bon d'ajouter 15 à 20 kilogs desulfate de fer par hectolitre de liquide. Ce traitement, très promptement fait, donnera les meilleurs résultats, même en l'employant seulement tous les deux ans. Lepulvérisateur est donc un instrument que tout propriétaire et toutfermier doivent avoir pour défendre leurs récoltes de pommes, d'autantplus qu'il peut servir également pour les vignes, poiriers, pêchers,tomates, pommes de terre. Nous nous servons à notre grande satisfactiondu système Besnard qui pulvérise parfaitement et d'une soliditéremarquable. Le puceron vert s'attaque aux jeunes poussesde l'arbre et aux feuilles nouvelles. Dès qu'un arbre a des puceronsverts, vous voyez de suite des fourmis grimper le long de l'arbre poursucer la liqueur mielleuse secrétée par les pucerons. Traitements.- Un litre de jus de tabac dans quinze à vingt litres d'eau, ou leSolutol Lignières (que je recommande aussi très vivement), un litre parquinze litres d'eau. Le puceron lanigère est ce petit insectequi semble couvert de laine blanche, et qui produit sur les pommiersles ravages les plus grands en s'attaquant aux jeunes branches et en yformant des plaies ineffaçables. Traitement.— Le Solutol Lignières (un litre sur quinze litres d'eau, tous lesquinze jours jusqu'à disparition complète) donne des résultatssatisfaisants, ainsi que le jus de tabac mélangé à l'eau de savon oul'essence de térébenthine. Prendre un kilo de savon noirà faire dissoudre dans vingt à vingt-cinq litres d'eau chaude, ajoutertrès doucement un kilo de jus de tabac ou d'essence de térébenthine enremuant vigoureusement le mélange. Le ver blanc est tropconnu, malheureusement, et fait des ravages considérables sur lesjeunes pépinières. Aucun remède sérieux n'a été indiqué, car le Botrytis tenella, à ma connaissance, n'a jamais produit le moindre effet et je ne pourrai le recommander. Le Kermès est un insecte nouveau, paraît-il, puisqu'il n'est connu en Normandie que depuis 1865. Il a la forme d'une très petite coquille de moule. Il paraît que ces insectes, en peu d'années, détruisent un arbre en suçant toute la sève. Traitement comme pour le puceron lanigère. L'anthonome est ainsi décrit par M. Power : « L'anthonome du pommier, Anthonomus pomorum, Schonerre,est un coléoptère de la famille des Curculionides ; sa longueur estd'environ 6 millimètres et sa largeur 2 millimètres. Boisduval ledécrit ainsi dans son Essai sur l'Entomologie horticole : Couleurplus ou moins brunâtre, avec duvet ou pubescence grisâtre. Les élytres(ou enveloppes dures qui recouvrent les ailes) sont d'un roux obscur,marquées vers l'extrémité postérieure d'une tache blanche. Éclos à lafin de mai ou au commencement de juin, il passe l'été et l'hiver dansl'engourdissement pour se réveiller et s'accoupler vers la fin d'avrilou les premiers jours de mai. Après sa fécondation, la femelle se met àla recherche des fleurs de pommiers, dont elle perce le bouton avec sonrastre ou bec ; elle y dépose un œuf dans chaque trou sans jamaismettre deux œufs dans la même fleur. Au bout de quelques jours, l’œufdonne naissance à une petite larve qui dévore les étamines, le pistilet l'ovaire. Elle grossit rapidement et, quinze jours environ après sanaissance, elle se transforme en nymphe, dans son propre berceau. Lafleur ainsi atteinte cesse bientôt de se développer et devient d'unjaune brun ; les paysans normands disent qu'elle tourne au clou degirofle. Jusqu'ici on admettait généralement que la nymphe se laissaittomber à terre, s'y enfonçait et attendait le moment favorable pourreparaître à l'état d'insecte parfait. La souplesse et la vivacité deces nymphes rendaient cette opinion très admissible. » Quandvous verrez un pommier perdre presque complètement ses fleurs, examinezplusieurs boutons et vous trouverez certainement ce petit charançon quiaura détruit votre récolte. Le traitement préventif est le remède général indiqué plus haut contre les parasites. Lesabeilles, en favorisant la fécondation des fleurs, rendent de trèsgrands services, car, dès que le pollen est déposé sur le pistil, lesfleurs se ferment et l'anthonome ne peut y pondre. Lerynchite ou coupe-bourgeons fait surtout des torts sérieux dans lapépinière et est détruit comme l'anthonome par le traitement général àla chaux et sulfate de fer. La chématobie est un petitpapillon qui roule la feuille tendre du pommier et fait le plus grandtort à la végétation de l'arbre. Traitement. — Pulvérisation au Solutol Lignières ou au savon noir et térébenthine (voir puceron lanigère). M.de la Hayrie, président de la Société d'horticulture de Lorient,travaille spécialement la question des parasites des pommiers, et aécrit un petit opuscule très savant et très complet sur cette matière. Depuis quelques années, différents produits antiparasitaires ont été lancés pour la destruction de tous les parasites. LeSyndicat pomologique, ayant organisé un concours expérimental de sesproduits, fera connaître prochainement les résultats si intéressantspour les producteurs de pommes. Les maladies des pommiers sont aussi très nombreuses. Nous ne parlerons que des chancres et du blanc des racines. Lechancre est dû à un champignon microscopique qui s'attaque à l'arbre àla suite d'un coup, d'une blessure. Quelques variétés sont plussensibles que les autres à cette maladie qui peut se guérir en ayant lesoin de couper le bois attaqué jusqu'au vif, de le cautériser ensuiteavec de la créoline Pearson, 25 % ou une solution très forte de sulfatede fer et ensuite de recouvrir la plaie avec un mastic. Le blancdes racines est un pourridié analogue à celui de la vigne contre lequelil n'existe pas de remèdes. Il se déclare surtout par l'échauffaisondes racines enterrées trop profondément, ou se forme même sur lesgenêts, bruyères, etc., qui sont enfouis quelquefois à tort dans lestrous de pommiers. Le blanc amène la perte du pommier en un ou deux ansau plus. Nettoyage du pommier. Bois mort, mousse.— Chaque année, pendant l'hiver, les arbres fruitiers doivent êtredébarrassés des branches mortes ou à moitié brisées, ainsi que detoutes les mousses, champignons, etc., qui peuvent envahir le tronc. Nousdevons surtout faire la plus grande attention au nettoyage de l'arbreparce que la plupart des insectes ne peuvent résister à toutes lesintempéries de l'hiver qu'en se cachant dans la mousse et dans lescrevasses de l'écorce. Il est à remarquer qu'à la suite d'hiver trèspeu rigoureux, les insectes nuisibles occasionnent des dommagesconsidérables, comme en 1896. Le gui.— Parmi tous les parasites de l'arbre, aucun n'est plus dangereux quele gui, car il est impossible à détruire et, lorsqu'il est coupé sur labranche, il repousse avec une nouvelle vigueur après quelques années.Les suçoirs traversent la branche souvent de part en part et absorbentau passage tous les sucs nourriciers. Une campagneactivement menée par M. Sarcé, de Pontvallain (Sarthe), a déjà eu dansce département un grand résultat. Les pouvoirs publics ont rendu ladestruction du gui obligatoire dans la Sarthe, et actuellement ceparasite n'y existe que rarement, paraît-il. Il est àespérer que les Conseils généraux tiendront à défendre l'intérêt ducultivateur et que d'ici peu d'années, cette mesure sera obligatoiredans toute la France. On objecte que le gui est un produitd'exportation pour l'Angleterre et qu'il en est expédié de Saint-Maloet de Honfleur des bateaux entiers. Peu importe la qualité à vendre,car, d'après les données de M. Sarcé, le gui fait un tort de un francpar pommier et par an au minimum et détruit pour l'avenir l'arbre etses récoltes. Si nos voisins ne peuvent se passer de guipour Noël, il leur est facile de le propager dans les cultures depommiers qu'ils ont dans le Sud de l'Angleterre, mais ils s'engarderont bien et franchement ils auront raison. Lescultivateurs qui ont encore du gui ont le plus grand intérêt à lecouper, et s'ils veulent, ils peuvent le vendre, ce sera toujoursautant de détruit. En 1895, les mille kilos de gui sepayaient de 30 à 40 francs sur wagon, selon la qualité, qui consiste àavoir les plus grosses touffes, entières et chargées de tous leursfruits. M. Juret, négociant en cidres à Segré, achètechaque année une certaine quantité de gui dont les livraisons se fontdu 15 novembre au 10 décembre. * * * LA CIDRERIE Depuisquelques années, une véritable révolution s'opère dans la manière defaire le cidre. Ainsi le cultivateur, encore aujourd'hui, ne consacre àcette fabrication que le temps, que pour ainsi dire, il peut voler auxautres travaux de la ferme. Il croira perdre son temps en consacrantquelques heures dans l'année à remplir ses barriques ; le soutirage luiparaîtra même inutile, et lorsqu'il recevra le conseil de soutirer deuxou trois fois, il s'empressera de penser qu'il est préférabled'économiser cette opération pourtant si nécessaire. Lorsqu'un fût seravide, il se gardera bien de le nettoyer ; heureux encore si au momentd'entonner le cidre nouveau, quelques litres d'eau lui serviront àenlever les impuretés les plus grosses. Je ne parle pas des pressoirset des broyeurs qui souvent servent de perchoirs pour les poules etsont contaminés par des épaisseurs d'excréments de ces volailles ; uncoup de balai légèrement donné suffira à avoir une propreté, trèsrelative. Qu'arrive-t-il à tous les cidres fabriqués avecune telle négligence, avec un tel oubli de la propreté la plusélémentaire ? Dès que la fermentation s'achève, ces cidres sontimbuvables, les uns sont forts et sentent l'acidification, les autressont gras et deviennent impropres à tout usage, sinon à brûler. Lafermentation alcoolique était jusqu'à ces dernières années laissée àtoutes les chances du hasard. Si le cidre se conservait mal, la fauteen était à l'année, au cellier, à toute cause en un mot, sauf la vraie,au manque de propreté. Toutes ces maladies du cidre sontétudiées et connues depuis les admirables découvertes de Pasteur, etdes hommes dévoués aux intérêts de leurs concitoyens passent leur vie àrechercher les meilleures méthodes de fabrication. A unsiècle de culture intensive comme le nôtre, il était nécessaire derechercher quels sont les moyens les plus certains et les pluséconomiques d'arriver à produire un cidre excellent et de longueconservation. C'est ce qu'a si bien compris le dévoué Président duSyndicat de la Manche, en demandant au Syndicat pomologique d'étudierles meilleurs modèles de cidrerie pour une fabrication de dix àcinquante barriques bordelaises. Les deux questionsprincipales dans une cidrerie sont d'abord de permettre de faire unefabrication très économique, supprimant le plus possible lamain-d’œuvre toujours si chère, et permettant ensuite une fabricationrationnelle et une conservation parfaite du cidre. Ilsemble difficile d'admettre qu'on soit forcé de faire une cidrerie pourun nombre si restreint comme dix barriques. On se sert ordinairementpour cette minime fabrication des locaux déjà existants dans une ferme,aussi ai-je pris comme base de cette étude la quantité de cinquantebarriques. Il sera facile au propriétaire qui désirera avoir un localspécial de diminuer ou d'augmenter dans une certaine mesure les donnéesque je pourrai citer. Ainsi cette cidrerie organisée pour cinquantebarriques, pourra, une année de récolte abondante, loger près de deuxcents barriques, soit : Deuxciternes 90 barriques. Demi-muids et barriques superposés 110 Total.. . 200 barriques. Et 300 barriques en supprimant lemassif de maçonnerie sous les cuves de fermentation et en lesagrandissant. La première question d'une cidrerie est d'être économiqueet par conséquent il est nécessaire que les frais de construction,d'amortissement et de réparations ne soient pas complètement à lacharge du compte cidre ; en d'autres termes il faut que la plus grandepartie du bâtiment puisse servir pendant neuf à dix mois à d'autresusages qu'à celui de la cidrerie. Nous devons étudier trois parties de la cidrerie absolument distinctes : 1°Le bâtiment lui-même qui pendant un ou deux mois servira à lafabrication du cidre et devra le reste du temps être d'une utilitéincontestable à la ferme ; 2° Le matériel de fabrication ; 3° Le matériel de cave. Le bâtiment. Le bâtiment très simple se compose de trois parties : 1°Au sud un hangar divisé lui-même en deux parties d'un côté renfermantle matériel de fabrication, et de l'autre destiné à recevoir les pommesà l'abri de la pluie. Ce hangar aura le sol légèrement incliné au sudafin que les moindres traces d'eau puissent être enlevées trèsrapidement. Le terrain devra être revêtu de ciment, d'asphalte ou plussimplement de cendre de chaux, car il est de la plus grande importanced'éviter autour du broyeur et du pressoir ces flaques d'eau stagnantes,véritables repaires à mauvais ferments. Pourrecevoir les pommes dans la partie qui leur est réservée, je conseillede mettre par terre un lit de simples fagots de gros bois les uns àcôté des autres, dans le sens de la longueur, afin d'attirer l'airjusque sous le tas de pommes et empêcher ainsi l’échauffaison. Unecouche de paille posée transversalement recevra les pommes. Si lahauteur du tas devait devenir trop considérable, il serait nécessairede placer quelques fagots debout entre les autres avant de déposer lespommes. Ces derniers fagots serviraient ainsi de cheminées d'appel etla conservation des pommes serait assurée autant que possible contrel’échauffaison. L'autre côté du hangar sera destiné à recevoir lebroyeur dont le manège se trouvera à l'extérieur du bâtiment. Un peu enarrière le pressoir ou les pressoirs de préférence, pour ne perdreaucun temps et permettre toujours à un pressoir le temps de s'égoutter.Près du mur de refend une cuve qui recevra le moût au sortir dupressoir. Près de cette cuve une pompe de cave enverra directement lemoût, dans les citernes de fermentation placées dans le cellier, par untuyau de caoutchouc qui traversera le mur par une très petite ouverturede 10 à 15 centimètres carrés. Si le propriétaire veut éviter les fraisde citerne, le même tuyau de caoutchouc servira à remplir directementles tonnes beaucoup plus vite qu'en le portant avec des seaux etsurtout en le tenant absolument à l'abri de toute impureté. Al'Ouest près du pressoir une certaine quantité de cuves en boispourront être installées pour la fabrication du second et troisièmecidre. 2° Entre la partie du hangar destinée à lafabrication et le cellier, une ouverture sera faite dans le mur. Cetteouverture aura une porte de chaque côté du mur pour les raisonsci-dessous. Ce passage servira, pendant la fabrication, à surveiller leremplissage des citernes ou des tonnes, à permettre à l'air chaudd'entrer dans le cellier et de faciliter ainsi la fermentation. Dèsque la fermentation prendra fin, il sera nécessaire de fermer d'abordla porte du côté du cellier, puis pour empêcher l'introduction de l'airchaud, on remplira l'espace libre dans l'épaisseur du mur avec dumauvais foin ou toute autre matière insolante. Lecellier sera enfoncé en terre de trois marches et renfermera lesciternes de fermentation, si nécessaires avec les nouveaux procédés defabrication, les tonnes et les barriques. Le sol sera égalementcimenté ou à la cendre de chaux, et une rigole de chaque côté del'allée permettra aux eaux de lavage de sortir par la porte située àl'Est. Si une cave spéciale pour le vin est nécessaire, il est facileavec une cloison de faire un petit caveau dans un coin. Le propriétairequi regardera trop à la dépense pourra peut-être, mais à tort, sedispenser d'établir les deux citernes de fermentation, dont l'utilitéest très grande comme nous verrons plus loin. La porte ducellier sera à l'Est et-devra être faite en bois très épais. Cetteporte peinte en blanc pour éviter la chaleur, aura deux battants afind'entrer les plus grosses tonnes. Il sera bon l'été de l'abriter dusoleil levant par un paillasson ou par un revêtement de feutre passé àla chaux. Le plafond du cellier sera fait avec desbarreaux de châtaignier entourés de foin de mauvaise qualité ; le touttrempé dans un bon mortier et recouvert au-dessus de carreaux. Ce genrede plafond très peu coûteux est presque inaccessible, aux écarts de latempérature, ce qui doit être recherché avant tout dans la constructiond'un cellier, quel que soit le système employé d'après les différentspays. Si le propriétaire ne regardait pas trop aux frais,le meilleur moyen de préserver le cidre de la chaleur, serait de faire,le long des murs une cloison à 10 ou 20 centimètres de distance. Cematelas d'air s'opposerait parfaitement à la variation de latempérature. Un plafond voûté serait certainement préférable, mais la dépense serait bien plus élevée que le moyen si simple que j'indique. 3°Le grenier qui s'étendra au-dessus du cellier et même si on désire surtout le bâtiment sera carrelé. Ce grenier sera d'une très grandeutilité pour ramasser pendant l'hiver les pommes de troisième saison,les années de grande abondance. Pour faciliter la misedes pommes en tas dans le grenier, il est facile d'installer une simplepoulie en haut de la porte Est avec un petit treil à encliquetage pourarrêt, pouvant se manœuvrer du bas par un seul homme qui monteraitensuite par grandes caisses les fruits, tandis qu'un autre homme lesconduirait ainsi sur un petit chariot à deux roues à l'endroit voulu. Une seconde caisse faciliterait considérablement le travail. Lespommes seraient déposées comme en bas sur un lit de bois et de pailleet seraient à l'abri de l'échauffement et des intempéries. Si oncraignait la neige ou les trop fortes gelées, il serait faciled'employer le moyen si simple dont je me suis servi et que j'indique entoute confiance : sous les ardoises ou tuiles vous clouez sur leschevrons un rouleau de carton ou de feutre bitumé, qui forme matelasd'air et protégera efficacement du froid. Lebâtiment tel qu'il est indiqué dans ses grandes lignes peut êtremodifié en grandeur suivant l'espace donné ou la quantité de cidre àfaire par an, mais il a surtout le très grand avantage de servir,pendant dix mois environ, de grange pour battre le blé par exemple etle mettre à l'abri d'un orage, pour ramasser une ou plusieurscharretées de foin ; en un mot ce hangar peut servir à tout usagependant la plus grande partie de l'année ainsi que le grenier à pommes. Nous étudierons dans un prochain chapitre le matériel de fabrication. Matériel de fabrication. Lebroyeur dont je me suis servi est du système Simon, de Cherbourg. Il secompose d'un seul arbre muni d'un cylindre armé de palettes mobilesentrant et sortant pendant la rotation. Ces palettes entraînent lesfruits et les obligent à suivre le mouvement du cylindre pour êtrebroyés contre une plaque munie de rainures appelée dossier. Telle estla description de ce broyeur par M. Simon. Je n'ai pasl'intention de conseiller tel ou tel fabricant, d'autant plus que lesexpériences de précision de la Société des Agriculteurs de France, auconcours de Segré, indiqueront les avantages et les désavantages de telou tel instrument. Il faut, à mon avis, que le broyeur soit muni d'un distributeur pour activer ou retarder l'arrivée des pommes, et d'un régulateur pour augmenter ou diminuer le degré de broyage. Enpossédant un instrument ayant ces avantages, tout fabricant de cidrepourra à son gré obtenir le degré de broyage nécessaire selon la naturedes pommes, la maturité, et sera à même de repasser très vivement lemarc déjà pilé pour le second et troisième cidre. Pour obtenirla meilleure qualité du cidre, il est nécessaire que la fabricationsoit faite avec la plus grande rapidité possible pour empêcher lesmauvais ferments de s'emparer du moût. Je conseille doncl'emploi d'un moteur quelconque, soit manège à un cheval pour lespetites cidreries, soit moteur à pétrole ; ces moteurs peuvent servirutilement pendant le reste de l'année à actionner les pompes de jardin,et même les barattes dans les grandes exploitations, enfin à toutusage. Le moteur à pétrole Grobbe est très simple, solide, et peut êtreemployé dans toute cidrerie. Le moteur à cheval dont jeme sers provient encore de chez M. Simon et m'a donné de bons résultats, son prix très modéré (130 fr.) le met à la portée de toutesles bourses. Sous le broyeur je conseille vivementde faire établir une caisse en chêne facile à déplacer pour les soinsde propreté, plus évasée en haut qu'en bas à chaque extrémité afin depermettre à l'homme chargé du broyeur de retirer facilement la pulpe depommes pour la mettre au pressoir. Ces dispositions facilitant beaucoup le travail économique peuvent être employées avec tous les broyeurs. Pressoirs. Unpeu en arrière du broyeur, se trouvent placés sur la même ligne, à 30ou 40 centimètres de distance l'un de l'autre, un ou deux pressoirs depetite dimension de préférence, c'est-à-dire donnant environ leurbarrique. Cette dimension est celle, à mon avis, qui donne lesmeilleurs résultats et qui, est la plus pratique aussi bien pour lerendement que pour le remplissage et le serrage par un seul homme. Le serrage est obtenu par les appareils de pression Mabille. Il est bon d'avoir deux pressoirs parce que pendant que l'un d'eux est en pression, et s'écoule, le second peut être en charge. Decette manière, jamais une minute ne peut être perdue dans lafabrication du cidre, si toutefois vous le voulez bien, et en plus lepetit cidre et le troisième cidre sont faits avec une régularitéparfaite à tour de rôle. Les pressoirs doivent êtrenettoyés avec les plus grands soins avant la mise en marche avec unesolution de bisulfite de chaux (1 litre par 5 litres d'eau), lavésensuite à grande eau à plusieurs reprises et pendant la fabrication ilest utile de laver à grande eau les instruments deux fois au moins parsemaine. Filtres. Pourobtenir des cidres très fins et de très bonne conservation, ainsi queje l'indique dans le petit traité que la Société des Agriculteurs deFrance a bien voulu récompenser du Prix Agronomique, j'emploie lesfiltres en amiante système Maignen. Le filtrage a, à mon avis du moins,le très grand avantage d'empêcher l'introduction dans le moût de lacause même et de la nourriture des mauvais ferments. En réalité c'estun surcroît de propreté apporté à la fabrication du cidre. Les résultats obtenus par le filtrage sont : 1° Fermentation beaucoup plus prompte, plus active, plus régulière ; 2° Augmentation d'alcool ; 3° La lie de très bon goût ne s'acidifie que beaucoup plus tard ; 4° Finesse de goût remarquable ; 5° Conservation des cidres beaucoup plus longue. Cesfiltres durent très longtemps, mais il est utile pour la facilité de lafabrication d'avoir le nombre nécessaire en double afin d'avoirtoujours prêt à être employé un filtre venant d'être lavé et nettoyé. Ladifférence de qualité obtenue paie très facilement le prix d'achat deces filtres après quelques barriques. J'attribue du reste à ce procédéindiqué par moi, la réussite que j'ai obtenue dans différents concoursde 1895. Le moût demanderait un certain temps à traverser cesfiltres si on n'activait l'opération par une pompe aspirante etfoulante qui attire le liquide à l'intérieur du filtre d'abord et lerejette ensuite dans les cuves de fermentation. Pompes. Cettepompe, en plus de son usage pour le filtrage, peut servir de pompe decave pour la transvasion du liquide lorsqu'elle ne peut se faire seulecomme nous l'indiquerons plus loin. Cuves. Lescuves destinées à la macération des marcs de deuxième et troisièmecuvée sont des barriques ou des tonnes coupées par le milieu, tenuesdans un état de propreté parfaite. La robinetterie et latuyauterie d'une cidrerie industrielle sont très importantes, aussicroyons-nous rendre service à nos lecteurs en leur indiquant lefournisseur que nous avons pour ces articles destinés à notre cidrerieindustrielle : M. J. DEPAGNE, 30, quai de la Rapée, PARIS. Matériel de cave. Lacondition essentielle d'un matériel de cave est d'être très pratique,de pouvoir conserver dans un espace donné une très grande quantité decidre dans un état de conservation parfait. Depuisquelques années, la nécessité de plusieurs soutirages est absolumentreconnue et nous devons donc prendre les meilleures dispositions pourles faire avec la plus grande économie de temps, de liquide et dematériel. Cuves de fermentation. Lafermentation s'établit très tôt dans le cidre, surtout en employant lesmoyens rationnels du filtrage et des levures sélectionnées. Enplus la fermentation se fait d'une manière d'autant plus régulière quela masse de liquide est plus grande ; la qualité du cidre par elle-mêmeest d'autant plus homogène que la quantité est plus forte, et enfinpour le fabricant de cidre qui le destine à la vente, il est préférabled'avoir toutes ses barriques de même fabrication, de qualité égale, qued'avoir des variations de prix qui ne peuvent s'expliquer que par leplus ou moins de malpropreté de la barrique, en particulier, ou de lafabrication en général, ce qui en est du reste très souvent la cause. Pourempêcher ces défauts propres à la fabrication, je crois pouvoirconseiller les cuves ou citernes à fermentation tumultueuse aprèslaquelle le cidre sera, d'après l'importance de la cidrerie, confié àdes citernes de moindre contenance ou à des tonnes et barriques. Lesciternes de fermentation doivent être excessivement faciles à nettoyeret d'une solidité parfaite, tout en tenant peu de place. Les plussimples sont celles de fer et ciment, appelées Siderio-Ciment,recouvertes à l'intérieur de plaques de verre qui se joignentparfaitement et sont d'une propreté parfaite. Ces citernes oucuves recouvertes reviennent à très bon marché puisque l'hectolitrelogé ne coûte pas plus de 3fr. 50 à 4 francs. La construction de cesciternes en sidéro-ciment, c'est-à-dire en acier et ciment, est trèssolide et en plus la conservation du liquide est parfaite, puisque lerevêtement intérieur de ces immenses cuves étant en verre, le cidre setrouve exactement renfermé comme dans une immense bouteille. Notreexposition de Segré pourra très probablement faire connaître cesexcellentes plaques en verre. Ces citernes ou cuvesrecouvertes sont très pratiques parce qu'étant disposées au-dessus dusol à 1 mètre 50, elles permettent, à l'aide d'un seul tuyau decaoutchouc, de remplir très vivement et sans aucun travail, les tonnes,demi-muids et barriques. Pour augmenter le logement ducellier, ces citernes peuvent être faites à terre ou même sous terre,au lieu d'être sur massif de maçonnerie, ce qui diminuerait le prix deconstruction de 421 francs et augmenterait le logement de 100barriques, soit au total 300 barriques. Une pompe de caveremplirait les tonnes. Une série de ces cuves desidéro-ciment serait très facile à utiliser pour les différentssoutirages, et d'une exploitation commerciale très pratique. Enplus, il serait très facile d'établir sous le cellier représenté parnotre plan, une série de citernes renfermant des milliers d'hectolitresau besoin. Les tonnes ou les demi-muids de 600 litres, depréférence, sont indispensables et économiques parce que lesréparations sont nulles et que le cellier contiendra une quantitéd'hectolitres beaucoup plus grande de liquide en demi-muids qu'enbarriques, et que, d'un autre côté, le cidre aura d'autant moins dechances d'être en rapport avec l'air extérieur, que le fût sera plusgrand, et en plus je préfère les demi-muids parce que ces dernierspeuvent être nettoyés et mis en place par un homme seul ou par deux auplus. Quant à la conservation d'une très grande quantitéde cidre à l'état doux, c'est-à-dire n'ayant pas fini sa fermentationpour faire en toute saison d'excellent 'cidre mousseux, je puisassurer, d'après mes expériences, que d'ici quelques années, peut-êtremoins, nous pourrons garder cette délicieuse boisson plusieurs annéeset en faire ensuite du cidre mousseux. Mes expériences n'étant pasterminées, je ne puis m'expliquer plus complètement sur ce nouveau modede conservation. Les barriques ne sont utiles dans uncellier que pour la vente du cidre ou pour la consommation de lafamille si elle est peu nombreuse. En tout cas quelle quesoit la nature des récipients la recommandation la plus essentielle estde les tenir dans l'état de propreté la plus complète. Une pompe à eau d'excellente qualité devra être à proximité du cellier pour les soins de propreté du matériel. Mode de fabrication du cidre. En quelques mots j'indiquerai l'économie du système de fabrication que je préconise. Lamise sous bâtiment des pommes est faite bien facilement puisque unetrès grande partie peut être déchargée directement par charrette àl'endroit désigné sous le hangar. L'autre portion plus restreintedemandera en tous cas peu de travail pour être répartie sur le grenieren tas différents. Le broyage et la pression nécessiteront 1°Un chef de fabrication surveillant le manège ou moteur, lefonctionnement du broyeur et transportant au fur et à mesure la pulpebroyée dans les pressoirs ou les cuves de macération. 2° Unhomme de service chargé de fournir le broyeur de pommes, soit à l'aidede paniers si les fruits sont sous les hangars, soit par un conduit enbois incliné s'ils sont au grenier. 3° Une femme ou unenfant devra remplir les paniers de pommes à l'avance, nettoyer lesfiltres et donner de temps en temps quelques coups de pompe à filtre aubesoin. Pour la pression, le lavage des fûts, etc., lesdeux hommes s'aideront et feront manœuvrer la pompe du filtre pendantque je pressoir serré laissera écouler le cidre. Cepersonnel est très suffisant pour obtenir quatre à cinq barriques parjour au minimum. Ce chiffre peut être considérablement augmenté enadjoignant un homme de service supplémentaire. Pendantles heures de repos nécessaires pour que les pressoirs puissent rendrecomplètement la plus grande quantité de liquide, les hommes et la femmeou l'enfant pourront nettoyer les fûts, les filtres, etc. Monbut, en écrivant en quelques lignes cette étude, a été de prouver,d'après ce qui se fait chaque année à mon domaine, que la fabricationtrès propre, très, simple et très économique du cidre est à la portéede chacun, et qu'il est facile, à peu de frais, d'obtenir pour soid'abord et pour la vente ensuite d'excellent cidre à très bas prix. Étanten rapports journaliers avec tous les principaux fabricants d'appareilspour cidrerie, je suis à la disposition des lecteurs pour toutrenseignement. Puissent ces, simples indications rendreservice à la classe laborieuse qui consomme presque exclusivement et àjuste raison cette excellente boisson. * * * APICULTURE Utilité de l'apiculture pour la fructification des fruits. Ilsemble singulier, au premier abord, dans un concours pomologique,d'entendre chanter les louanges de l'abeille ; et qui plus est, de lavoir recommander vivement aux pomologues. Il n'en est rienpourtant, lorsque, sans parti pris, ou examine attentivement le rôle decet insecte dans l'apiculture en général, et en particulier dans lapomologie. I Ilest un fait certain connu de tous les apiculteurs, et facile àremarquer partout : Pourquoi les pommiers plantés sur les bords desroutes produisent-ils des fruits presque très régulièrement tous lesans ? Un auteur prétend que la poussière des routes empêche l'anthonomede faire ses ravages terribles sur ces pommiers, et il croit même qu'ilserait suffisant au moment de la floraison de jeter une poudrequelconque très fine pour les écarter et assurer la récolte. Ilme semble au contraire beaucoup plus naturel de donner de ce fait deproduction régulière des arbres plantes près des routes, l’explicationsuivante : Lorsque les arbres sont en floraison et que letemps reste calme pendant plusieurs jours, les jardins sontmerveilleusement parés de cette multitude de fleurs ; les espérancesd'abord si belles de récolte s'évanouissent petit à petit pour faireplace souvent après quelques semaines à la certitude absolue d'unmanque total de fruits. Tantôt, au contraire, les fleurs sont-elles àpeine épanouies en petite quantité qu'un vent violent agite les arbreset fait perdre au pauvre cultivateur, pour cette année encore, l'espoirde remplir sa cave d'excellent cidre. Si cette période de tempête enmême temps qu'une légère chaleur continuent pendant la floraisonentière, les arbres ne semblent pas fleurir, car à peine la fleurépanouie, les étamines sont-elles enlevées. La fructificationcependant s'est opérée par le vent qui s'est chargé de transporter lepollen de la fleur sur le pistil et une récolte parfaite sera laconséquence forcée de ce temps réputé mauvais. Ce fait qui sepasse dans tous les arbres explique naturellement que les pommierssitués près des routes, plus exposés aux tourbillons d'air causés parles voitures et par toute autre cause, rapportent presque régulièrement. Orsi le vent aide la fructification, les abeilles rendent d'abord le mêmeservice en mettant au contact le pollen et le pistil et même entransportant le pollen d'une fleur sur une autre. Il est prouvéparfaitement que des arbres fruitiers improductifs pendant de longuesannées donnaient de suite, après l'établissement d'un rucher dans levoisinage, de magnifiques récoltes. Voici un fait raconté par unagriculteur de l'Est : « En Normandie, une commune fut trois annéessans abeilles et pendant tout ce temps, quoique les pommiers fussentchargés de fleurs, on ne récolta pas de pommes. Aussitôt qu'on eutrétabli les ruches, les pommiers recommencèrent à donner des fruits etnulle part aujourd'hui les abeilles ne sont mieux soignées. » L'abeille rend forcément le même service à toutes les plantes, depuis la plus petite fleur jusqu'au plus grand arbre des forêts. II Lesabeilles, en transportant d'un arbre à l'autre le pollen, favorisent lamultiplication des variétés nouvelles et empêchent les désastreuxeffets de la propagation de l'espèce par des individus toujours issusd'une même souche. Elles font naturellement pour les plantes ce que lesgrands horticulteurs ont appelé la fécondation artificielle. Leséleveurs de bestiaux, en empêchant la consanguinité, ne font pas autrechose que d'imiter les abeilles qui changent pour ainsi dire le degréde parenté d'un arbre à un autre. De combien de variétés nouvelles de fruits sommes-nous ainsi redevables à ces humbles auxiliaires de nos vergers ? III Lerôle de l'abeille pour le pomologue ne s'arrête pas à la fécondationdes fleurs ; après avoir assuré en grande partie une bonne récolte ellevient même en aide au cultivateur soit pour obtenir un cidre excellent,soit pour augmenter pendant une année de disette, dans de très notablesproportions, la quantité de boisson. Le sucre est en effet très commundans la nature ; toutes les fleurs en contiennent des proportions plusou moins élevées ; presque toutes les plantes en possèdent desquantités parfois si infinitésimales qu'elles empêchent l'homme de s'enrendre propriétaire, tandis que l'abeille par son travail ramasse petità petit ces trésors qui autrement seraient perdus pour nous. Lemiel peut nous servir très avantageusement à améliorer la qualité ducidre et surtout en cas d'année de disette comme celle-ci, à faire despetits cidres de bonne conservation tout en augmentant dans une largemesure la production de l'alcool. IV Enfinil est prouvé que l'anthonome fait beaucoup moins de dégâts dans lesvergers situés près des ruches. L'abeille en récoltant le miel feraittomber à terre l'œuf de l'anthonome et en détruirait ainsi une grandequantité. CONCLUSION En résumé le cultivateur da pommiers a tout intérêt à avoir un rucher pour les raisons suivantes : 1° L'abeille favorise la multiplication des variétés par la fécondation artificielle ; 2° L'abeille favorise la fructification des arbres fruits ; 3°Le rucher produit une quantité de miel pouvant augmenterconsidérablement, sans frais, en qualité et en quantité, la productiondes cidres do première, deuxième et troisième cuvée; 4° Enfin l'abeille détruit chaque année une très grande quantité d'anthonomes. * * * Prime à nos Lecteurs LA DIFFUSION 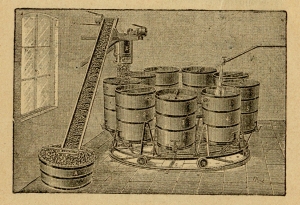 Jetiens à faire connaître au lecteur ce procédé qui, bien que connudepuis longtemps, n'avait jamais donné un résultat comparable à celuiobtenu par le Diffuseur BRIET. Je ne puis mieux faire connaître l'appareil que par la courte notice de M. BRIET. Mesessais personnels en 1896 me permettent d'assurer que l'on obtient parla diffusion des cidres excellents, faciles à clarifier et de longueconservation. Une remise de Cent francs par appareil m'a été promise par M. BRIET pour tous les lecteurs de l'Almanach du Pommier et du Cidrequi lui enverront leur demande d'appareils avec la page d'annonce duDiffuseur (page 123). Cette demande devra être revêtue de ma signaturepour être valable et devra m'être envoyée à SEGRÉ (MAINE-ET-LOIRE). * * * DEUXIÈME PARTIE LE CIDRE Sa fabrication et sa conservation. PRÉFACE L'hommes'est créé le besoin de boissons excitantes dans des temps trèsreculés, et n'a cessé de les perfectionner pour la satisfaction de sesgoûts et dans l'intérêt de son hygiène. Son génie a enfanté trois types: le vin, le cidre, la bière, sans parler des eaux-de-vie et desliqueurs, qui constituent un quatrième type. Le cidre occupe enFrance le second rang comme importance dans la série des boissonsfermentées. C'est par millions d'hectolitres que se chiffre laconsommation que l'on en fait, et cette consommation va d'année enannée en croissant, s'étend comme la tache d'huile, et fait concurrenceau vin lui-même et à la bière. Il importe donc aupremier chef de fabriquer le cidre, afin de lui faire acquérir lesmeilleures qualités possibles, et de lui procurer les avantages d'uneparfaite conservation, c'est ce qu'a si bien comprisM. Roger de la Borde dans sa remarquable brochure intitulée : «Fabrication et conservation du cidre », où il traite en maître cettegrande question qui intéresse au plus haut degré le propriétaire,l'agriculteur et la classe si nombreuse des consommateurs. Dèsles premières pages, l'auteur attaque le problème par le point le plusimportant : la fermentation, et c'est en effet le cœur de la question,car la fermentation normale a pour conséquence bonne réussite de lafabrication et parfaite conservation du cidre. C'est pour ne pasl'avoir suffisamment compris que cette grande industrie agricole estrestée jusqu'à présent si routinière, ou, si l'expression employéefroissait le sentiment du producteur, nous dirions si stationnaire. Ilreconnaît que le moût des pommes renferme des spores de ferments denature différente, adhérents à l'enveloppe, à la peau du fruit, les unséminemment utiles, les saccharomyces, et les autres au contraire fortnuisibles, les bactéries, qui causent les maladies du cidre, et samauvaise conservation. Il signale d'autres sources d'impuretés et parconséquent d'autres origines de ferments nuisibles, que l'on constatepresque toujours dans les cidres de fermes : des débris de fumier, depaille contaminée, de matières altérées, sans oublier les additions depetite quantité de purin ou d'eau de mare corrompue, auxquelles ontrecours, dans leur inconscience absolue et dans leur profondeignorance, tant de cultivateurs, sous prétexte d'activer lafermentation, et avec la ferme croyance qu'elle purifie tout et rejetteles impuretés hors de la barrique. A ce défaut de propreté dansla fabrication il faut encore porter en compte la malpropreté dumatériel, finalement l'entonnage du cidre dans des fûts mal nettoyés,et par suite une nouvelle cause de mauvaise conservation de cetteboisson. M. Roger de la Borde ne s'est pas contenté de lacritique, il a étudié chez lui la fabrication du cidre, il a recueillides observations, il a travaillé pendant plusieurs années auperfectionnement des indications obtenues, et a réussi à créer unprocédé méthodique de cidrification en parfait accord avec la science,qui assure la bonne qualité et la conservation du cidre. Levoici, dans ses grandes lignes : le jus des pommes, au sortir dupressoir, est passé au tamis de crins très serrés, qui retient leprincipal de la pulpe en suspension et des impuretés, puis à unefiltration sur filtres spéciaux en amiante, système Maignen, quifacilite plus encore l'élimination des spores de mauvais fermentslocalisés sur certaines parties de l'enveloppe du fruit. Un second etun troisième passage par ce filtre mettraient bien mieux lafermentation à l'abri de l'infection bactérienne. Toutefois le fait defiltrer trop souvent amènerait une stérilisation presque complète demoût, en enlevant en outre une trop grande quantité de bon ferment, ceque ne conseille pas l'auteur, parce que cela causerait trop de retarddans le commencement de la fermentation. Or, un retard un peu prolongépourrait déterminer une contamination de toute la masse du liquide parles mauvais germes de l'air, si l'on n'avait pas pris toutes lesprécautions recommandées en pareil cas, pour mettre le tonneau, destinéà la fermentation, complètement à l'abri du libre accès de l'air. Enpareil cas, et dans tous les cas, au lieu de compter sur les bonsservices des germes naturels de bons saccharomycès, il est préférabled'introduire dans le moût filtré, une première fois, de la levuresélectionnée et pure d'excellent cru de cidre ; qui, s'emparantimmédiatement du milieu, déterminera une fermentation prompte, rapideet saine, le peu qui pouvait subsister de mauvais germes ayant succombésous le coup de l'invasion et de la multiplication du bon ferment. Ensuivant les conseils de M. Roger de la Borde on peut compter que l'onobtiendra un cidre de bonne qualité et de conservation d'autantmeilleure que l'on aura fait intervenir une levure sélectionnéesupérieure. On ne saurait trop recommander la lecture dela brochure de M. Roger de la Borde, gui mériterait d'être intitulée «l'Art de faire le cidre », car elle est riche en renseignementspratiques de toute nature. Son grand mérite, d'ailleurs, a été reconnupar la Société des Agriculteurs de France, qui, dans sa dernièresession, lui a donné sa plus haute récompense au grand Prix Agronomique. G. JACQUEMIN, Chevalier du Mérite agricole, Directeur scientifique de l'Institut La Claire pour la culture des levures sélectionnées. * * * Monsieur le Président, En répondant à l'appel de la Société des Agriculteurs de France, demandant un mémoire sur la bonne fabrication et la conservation du cidre,je n'ai pas l'intention de vous adresser une œuvre scientifique, à laportée des savants et des chimistes seulement, et qui ne seraitd'aucune utilité pratique pour les petits cultivateurs. Cemémoire n'est pas fait pour les grands fabricants de cidre qui ont àleur disposition un matériel dispendieux et qui peuvent contrôler leursopérations cidricoles par l'analyse ; mon but est de faciliter aux pluspetits cultivateurs et aux propriétaires peu aisés la fabrication d'uncidre excellent et de très longue conservation. Lesgrands fabricants de cidre pourront néanmoins mettre en pratiqueindustrielle les quelques notions que l'expérience a pu nie faireconnaître. Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. ROGER DE LA BORDE, Président de la section de Maine-et-Loire du Syndicat pomologique de France. Château de LA LOGE , par SEGRÉ (Maine-et-Loire).Segré, le 28 décembre 4895. * * * Fabrication et conservation du cidre. Aucuneboisson ne s'est plus répandue que le cidre depuis quelques années.Autrefois le cidre était seulement la boisson du peuple dans toutl'Ouest de la France, depuis les rives de la Loire jusqu'à la Picardie.Aujourd'hui au contraire, le cidre est connu partout ; il est servi àla cruche au repas du pauvre et sur la table du riche, il serait l'égaldes vins de Champagne par sa mousse pétillante au sortir de labouteille s'il n'avait en plus sur ce dernier la grande qualité d'êtreune boisson naturelle. Depuis quelques années, la consommation apresque doublé à Paris pour les cidres naturels et presque triplé pourles cidres de fabrication où la pomme, hélas ! n'est pour rien ou pasgrand'chose. A l'étranger, le cidre commence à être en honneur, enAngleterre, en Égypte, en. Extrême-Orient, aux Antilles, etc.... Les Américains eux-mêmes commencent à nous inonder de leurs pommes sèches et envoient déjà des cidres en Angleterre. L'Allemagne, le pays de la bière, a acheté cette année des quantités prodigieuses de pommes françaises. Leseul reproche que l'on puisse faire au cidre est que cette boisson,renfermant en général peu d'alcool, est plus disposée que toute autre àdevenir la proie des différentes maladies. En plus, le bas prix de ce liquide empêche par lui-même une grande partie des soins qui lui seraient nécessaires. Laquestion de la bonne fabrication et de la conservation du cidre est unedes questions nouvelles qui intéressent le plus le propriétaire et laclasse si digne d'intérêt de l'agriculteur et de l'ouvrier. Jeferai connaître dans ce mémoire les expériences que j'ai faites etj'indiquerai les moyens pratiques, à la portée de tous, que j'emploiepour faire de bon cidre et le conserver avec toutes ses qualitéspendant plusieurs années. Fermentation du cidre. Lafermentation du cidre est la transformation du sucre de la pomme enalcool et en acide carbonique, par l'action d'un champignonmicroscopique appelé saccharomyce ou ferment. Les différentes variétésdes ferments connues actuellement peuvent se diviser en deux classesparfaitement distinctes : 1° Les ferments nuisibles ; 2° Les ferments utiles. Ferments nuisibles. Lesferments nuisibles sont introduits dans les moûts de pommes par toutesles impuretés qui se trouvent presque toujours dans les cidres deferme, débris de fumier, de paille, ferments de matières putréfiées,etc. Souvent même, croyant activer la fermentation, des cultivateurs necraignent pas d'ajouter à leurs moûts une petite quantité de purin oud'eau de mare corrompue, sous le prétexte que la fermentation purifietout et que toutes les impuretés sont rejetées hors de la barrique. Cettepratique est très blâmable et très dangereuse pour la santé publique,parce que les impuretés des eaux de mare activent la fermentationputride et que souvent des épidémies de fièvre typhoïde, par exemple àRennes, n'ont pas eu d'autres causes. Ces impuretés, cedéfaut de propreté dans la fabrication, dans l'entonnage du cidre dansdes fûts mal nettoyés, ont toujours pour résultat la mauvaiseconservation de cette boisson. La graisse des cidres est due à unmauvais ferment spécial, ainsi que l'acidification ; tout cidre troubleest le résultat d'une mauvaise fermentation. En résumé, tout cidremalade a pour cause une mauvaise fermentation, un défaut de propreté. Bons ferments. Toutau contraire, lorsque le cidre a été fait avec une grande propreté,lorsque les ferments de la pomme seuls ont pu se multiplier dans lemoût, après quelques jours, la fermentation tumultueuse s'établit dansle cidre, et souvent dix à quinze jours après la fabrication, un cidreexcellent, de goût très droit et très fin et de bonne conservation,peut être expédié à un prix rémunérateur. Nécessité d'empêcher les mauvais ferments. Lesbons ferments se trouvent toujours en quantité suffisante autour del'œil de chaque pomme, et pour assurer leur multiplication dans lemoût, il suffit en théorie d'empêcher la présence des fermentsnuisibles. Dans la pratique, il n'est pas facile d'avoirla propreté minutieuse que réclame la fabrication d'un liquide sidélicat ; quelques déchets de pommes avariées, un brin de paille sortidu fumier voisin, peuvent contaminer un cidre et en quelques jours luifaire perdre sa qualité et l'empêcher de se garder. Lapremière qualité de toute bonne fabrication du cidre est la propreté,et tout cidre bien fabriqué sera de très longue conservation. Je diraimême plus : un cultivateur n'apportant pas à la fabrication de celiquide tous les soins désirables, tout en ayant des pommesexcellentes, ne fera, jamais de mauvais cidre, alors que son voisin,avec les soins de propreté voulus, pourra obtenir avec des pommesmédiocres une très bonne boisson ; c'est un fait reconnu et impossibleà nier. Toutes les expériences que j'ai faites depuis sixans me prouvent que la fabrication du cidre de choix, de goût très finet très parfumé, de très longue conservation, se résume en un seul mot: la propreté dans la fabrication. La nécessitéabsolument, démontrée aujourd'hui d'empêcher les mauvais ferments desddévelopper dans les moûts de cidre m'a amené peu à peu à faire la filtration du cidre au sortir de l'anche du pressoir et avant toute fermentation. Je donnerai en quelques mots les essais faits depuis 1889, et j'indiquerai ensuite comment je brasse le cidre. Essais de 1889. En1889, un fait singulier me frappa un jour en goûtant les cidres de moncellier. J'avais marqué toutes les barriques d'un numéro afin de lesreconnaître et pouvoir désigner facilement à mon personnel telle outelle barrique ; je fus donc surpris de voir à la dégustation que trèsrégulièrement une barrique sur deux était de meilleur goût, que toutesles barriques de numéro impair, 1, 3, 5, par exemple, étaientpréférables aux fûts de numéro pair, 2, 4, 6. Les pommesétaient les mêmes, mélangées et conservées avec le même soin ; les deuxpressoirs absolument identiques, le même concasseur de pommes servaitles deux pressoirs. Enfin, après plusieurs jours de recherches, jeremarquai que les tamis en crins que j'employais pour empêcher lesdéchets de pommes et autres impuretés de pénétrer dans les barriques demoût, étaient de finesse différente. Chacun de ces tamis servantseulement à un pressoir, il me fut facile de me rendre compte, d'aprèsmes notes de fabrication, que le cidre le plus fin, le plus parfumé eten un mot le meilleur, provenait du pressoir ayant le tamis le plus fin. Essais de 1890. Jecontinuai en 1890 la même fabrication, mais au lieu d'employer destamis de crins toujours un peu gros, je me décidai de me servir detoiles en soie à bluter. Mes deux tamis furent encore de différentefinesse, tout en étant plus fins que mes tamis de crins. Lerésultat fut le même : l'ensemble de la fabrication avait augmenté dequalité, niais le tamisage le plus fin me donnait encore trèsrégulièrement le meilleur cidre. Je dois ajouter qu'en augmentant lafinesse des tamis, j'éprouvai une difficulté beaucoup plus grande àfaire passer le moût. Essais de 1891. Pourobvier à cet inconvénient, j'essayai en 1891 de tamiser le cidre ausortir du pressoir et ensuite, après la fermentation tumultueuse, dele filtrer dans des manches en coutil, en laine, en molleton. Monessai ne fut couronné d'aucun succès, car mes fûts témoins, simplementtamisés, étaient préférables aux barriques passées au tamis et aufiltre. J'attribuai cet insuccès au temps très long nécessaire pourfaire le filtrage après fermentation, d'où déperdition d'alcool,d'acide carbonique, de parfum, facilité aux mauvais ferments d'envahirle liquide. Essais de 1892. Jerésolus donc, pour la fabrication du cidre de 1892, de faire des essaisaprès la fermentation tumultueuse, avec des filtres à pression tels quel'on s'en sert pour séparer des lies de vin, le liquide qui peutrester. Mes essais faits en petit furent négatifs, car les filtresétaient obstrués après une vingtaine de litres par toutes les matièrespectiques, d'où nécessité de nettoyer constamment le filtre et delaisser longtemps le cidre exposé à l'air. Le cidre, par conséquent,devenait plat et ne ressemblait en rien à celui des fûts témoins. Essais de 1893. J'attribuai ce mauvais résultat à la perte d'alcool et de parfum que le cidre devait forcément subir au contact de l'air. Pourobvier à cet inconvénient, sachant que le cidre au sortir du pressoirne possède ni alcool, puisque le sucre n'est pas encore transformé enalcool et en acide carbonique, ni parfum, puisqu'il est un produit dela réaction des acides sur les alcools, j'en conclus naturellementqu'il ne pouvait perdre ce qu'il ne possédait pas encore et j'opérai lafiltration au sortir même des tamis. Le résultat comme qualité futparfait, mais les filtres étaient engorgés de suite par les matièresmucilagineuses et, après quarante ou cinquante litres, il fallait denouveau recommencer à démonter et à nettoyer les filtres, d'où grandeperte de temps. Le résultat du filtrage avant toute fermentationme donnait des résultats excellents comme qualité, mais malheureusementil fallait un instrument pratique pour faire ce filtrage. Essais de 1894. J'eus connaissance, au commencement de 1894, d'un filtre en amiante où la filtration se fait par capillarité. Mespremiers essais avec un tout petit appareil de poche me donnèrent uncertain résultat et je fis l'acquisition de plusieurs grands filtrespour continuer mes essais de fabrication et de conservation du cidrepar la filtration avant toute fermentation. Avant dedonner les résultats de mes expériences de 1894 et de 1895, je doisfaire connaître en quelques lignes comment je fais faire la fabricationdu cidre. FABRICATION DU CIDRE Pourobtenir un bon cidre, la première question est de connaître les pommesqui ont le plus de qualités comme sucre, tannin, mucilage, solidité etparfum. Je citerai seulement les espèces que je recommande avec l'analyse moyenne de chaque variété, dont ci-contre le tableau : Unpropriétaire, un fermier arrivant dans une ferme peut être embarrassépour acheter des pommes ou pour connaître la valeur des fruits. Il estdonc nécessaire, sans avoir besoin de recourir à l'analyse longue etcoûteuse, de se faire une idée approximative très suffisante. Deux moyens très simples peuvent être employés : 1° L'aspect général du fruit ; 2° Le poids spécifique du moût, c'est-à-dire le rapport du poids d'unlitre de cidre non fermenté au poids d'un litre d'eau à 4° centigrades. Choix des pommes par l'aspect des fruits. La couleur de l'épiderme de la pomme donne un renseignement presque certain sur l'ensemble des pommes. Toutesles pommes dont la peau est brillante sont en général peu riches ensucre, tandis que les fruits à peau rugueuse, tachée, sont presquetoutes à très bonne densité. Les pommes grises, marquéesde différentes taches, sont en général très riches en alcool. Lesjaunes sont moins riches en sucre, et les rouges enfin sontordinairement pauvres en sucre, mais donnent un cidre très fin de goût. Les variétés à peau verte transparente sont souvent acides et peu recommandables. Choix des pommes par le densimètre. Ilexiste un second moyen très rapide de se rendre compte de la valeurd'une variété de pommes, c'est de calculer à l'aide d'un petitinstrument appelé densimètre le rapport du poids du jus de la pomme àl'eau. Les substances du cidre à rechercher sont en première ligne lesucre, puisqu'il est la source de l'alcool et de l'acide carbonique, etque sans lui, aucun cidre ne peut avoir des qualités et deconservation. Les autres substances comme le tannin, acidité, mucilage,parfum, sont certainement utiles, mais beaucoup moins que le sucre. Pourreconnaître d'une manière rapide, toutefois avec une certaineapproximation, la valeur de la pomme à employer, c'est-à-dire laquantité de sucre et d'alcool par conséquent, il suffit de broyer unedizaine de pommes, de passer le jus dans un filtré de coton pouréliminer toutes les matières solides et de peser avec un densimètre ouaréomètre, la pesanteur spécifique du liquide, de suite après le pressurage et avant toute fermentation. Plus un moût aura une haute densité et plus la quantité de sucre et par conséquent d'alcool, sera élevée. Pourse rendre compte sans consulter les tables de calcul tout faits deslivres spéciaux, de la valeur du cidre d'une manière approximative parle densimètre, il existe certains moyens très rapides et d'uneexactitude suffisante pour la généralité de la fabrication des cidres. Calcul du sucre. Il suffit de prendre les deux derniers chiffres à droite du densimètre ; De les doubler, en forçant de 10% le chiffre trouvé pour obtenir à peu près le sucre total : Premier exemple : 1,040 de densité nous donnera 40 X 2 = 80 gr. de sucre + 8 = 88. Deuxième exemple : 1,075 de densité donnera 75 x 2 = 150 + 15 = 165 gr. de sucre. Calcul de l'alcool par la densité. Pourconnaître de suite le degré d'alcool absolu d'une densité, il suffit deprendre les deux derniers chiffres du densimètre et de les diviser par8, puis ensuite d'augmenter d'un 1/2 degré environ. Premier exemple : 1,040 = 5°+ ½ = 5 degrés 1/2 8 Deuxième exemple : 1,061 = 8° + 1/2 = 80 1/2. 8 Jedonne ci-dessous un petit tableau simplifié des qualités de pommes avecdensité, poids du sucre, alcool pur par litre et alcool à 60 degrés parbarrique de 225 litres « après fermentation complète. » Rapport de la densité du sucre et de l'alcool. 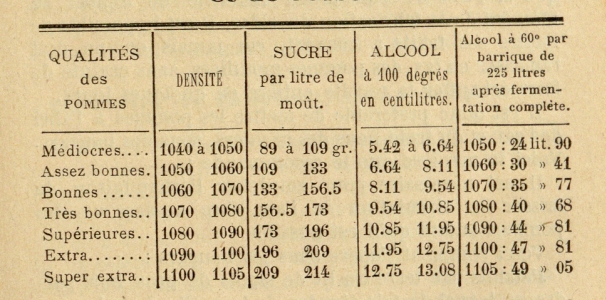 Lesfruits doivent toujours être cueillis le plus tard possible, lorsqu'unebonne partie des fruits sont déjà tombés de l'arbre, mais on devratoujours ramasser de suite les pommes qui tombent à la fin de l'été,avant maturité, car elles ne se conserveraient pas et doivent êtrebroyées de bonne heure. Ce cidre devra également être bu le premier ou passé à l'alambic. En opérant ainsi, on évite de casser en grande partie les boutons à fruits, espérance de la récolte prochaine. Conservation des pommes. Lespommes doivent être conservées sous des hangars, à l'abri de la pluie,jusqu'au moment où la maturité sera jugée suffisante pour donner lemaximum de l'alcool. Dans certains pays, il est d'usage delaisser les pommes exposées à la pluie ; elles rendront beaucoup dejus, diront les amateurs des anciennes routines. Je préfère pour mapart, si je crois nécessaire de mettre de l'eau dans le cidre, lamettre en quantité voulue et la prendre dans mon puits ; on évite ainsila pourriture des pommes et on est sûr de la qualité du cidre. En touscas, il est facile d'en mettre plus ou moins, tandis que si l'eau duciel prend fantaisie de tomber au moment de la fabrication du cidre, ilest impossible de mettre ses fruits à couvert, car jamais on ne doitramasser en tas, des pommes mouillées, sans crainte de faire échaufferla récolte entière en quelques jours. Il est doncpréférable de mettre les pommes à l'abri de l'eau et du froid dans desgreniers, sous des hangars. Voici la manière que je recommande : Ilest nécessaire pour empêcher l'échauffaison de laisser la circulationde l'air libre au-dessous des pommes autant qu'il est possible. Voici comment j'opère sous les hangars J'établispar terre un lit de fagots de gros bois pardessus lequel je faisétendre de la paille dans le sens contraire à la direction des fagots.Les pommes peuvent être ainsi déposées jusqu'à soixante centimètres dehauteur sans crainte d'échauffaison. L'air circule entre les bois et peut pénétrer ainsi partout dans la couche des pommes. Dansle cas de tas très étendus, il est utile de mettre tous les 3 ou 4mètres un fagot de gros bois debout sur la couche de bois du fond, pourservir ainsi de cheminée d'appel et attirer l'air. Ce bois n'est aucunement perdu et conserve toutes ses qualités en assurant la conservation des pommes. L'époquepropre à la fabrication du cidre est indiquée par la maturité du fruit,lorsque le parfum commence à se faire sentir et qu'une partie légèredes pommes commence à être atteinte du blossissement ou pourritureblonde. A ce degré, la qualité de la pomme est au maximum de quantitéde sucre, ainsi que la plus grande partie des fruits qui ne sont pasencore blets. Toutes les expériences que j'ai faites mepermettent d'affirmer que les fruits atteints de commencement deblossissement sont à leur maximum de qualité comme sucre, mais perdentlégèrement de tannin et ont une légère augmentation d'acidité. Parcontre, dès que la pourriture noire a envahi un fruit, il faut lerejeter. Les premiers fruits à la fin de l'été doivent être broyés de suite, comme je l'ai dit plus haut. Matériel de fabrication et propreté. Je dois faire connaître les appareils que j'ai reconnus comme donnant les meilleurs résultats pour la fabrication du cidre. Cettequestion au point de vue pratique et économique a une grandeimportance, mais néanmoins je ne la considère que comme une question dedeuxième ordre pour obtenir des cidres parfaits et de très longueconservation. La question essentielle à mon avis est que lesinstruments en général servant à la fabrication soient d'une propretéirréprochable, je dirai même méticuleuse. Il est donc d'uneextrême importance de laver à grande eau, très souvent, tous lesinstruments servant à la fabrication, comme broyeur, pressoir, pompe,seaux à entonner. Un excellent moyen de nettoyer lesappareils de cave est d'employer le bisulfite de chaux étendu de cinqfois son volume d'eau. Ce produit très peu cher se trouve cher tous lesdroguistes et détruit parfaitement les microbes. Après son emploi, ilest nécessaire de laver à grande eau, afin d'enlever toute trace de ceproduit. Les plus grands soins doivent être apportés aunettoyage des filtres, car après quelques jours de service, il est àcraindre que ces filtres ne deviennent de véritables nids de microbesqui peuvent passer dans le liquide à l'état de spores ; le bisulfite dechaux est tout indiqué pour le nettoyage des filtres. Noussavons que nous n'empêcherons les mauvais ferments d'envahir notrecidre que par la filtration chargée d'éliminer toutes les impuretés ;nous aiderons donc considérablement cette opération en ne faisantpasser nos moûts que dans des appareils très propres. Le meilleur moyenest de nettoyer à fond tous les appareils en versant de l'eaubouillante de préférence à différentes reprises avant le commencementdu brassage et de répéter cette opération une ou deux fois par semainependant la fabrication. La filtration du moût, à mon avis,doit être suffisante pour enlever les impuretés en suspension dans lemoût et notamment tous les déchets organiques et inorganiques quiforment la mauvaise nourriture des mauvais ferments et ainsi donnertoute facilité aux saccharomicès ou ferments utiles de faire leur œuvrede transformation du sucre en alcool et en acide carbonique. Jen'entends pas par filtration, l'action de clarification faite aprèsfermentation par tel ou tel appareil. J'entends dire filtration ou toutautre moyen mécanique ou chimique de débarrasser le moût de toutesimpuretés avant le commencement de toute fermentation. En unmot, je suis partisan de la filtration de propreté qui consiste àenlever toutes les impuretés du moût, nourriture des mauvais fermentset non de la filtration de clarification qui n'a pour but que de donnerun liquide parfaitement limpide et très agréable à la vue, mais qui enenlève une certaine proportion de matières pectiques nécessaires pourdonner du moelleux au cidre. Cuves et cuvage, petits cidres. Ilest nécessaire d'avoir un certain nombre de cuves ou barriques coupéespar la moitié pour aider à la macération du deuxième et troisième cidre. Onrecommande souvent, pour donner de la couleur au cidre, de laissermacérer les pommes après le pilage, pendant vingt-quatre àquarante-huit heures. J'étais si persuadé que ce conseil était parfaitque pendant de longues années, je l'ai suivi ; mais à la suited'expériences répétées, j'ai conclu au contraire de toutes les théoriesfaites jusqu'ici, que dès que les pommes ont été broyées pour faire lepur jus, il faut les presser immédiatement ; vous obtiendrez ainsi unjus beaucoup plus coloré, contrairement aux anciennes théories, et vousempêcherez dans votre moût l'introduction forcée de mauvais fermentspendant un long cuvage ; donc tout avantage : économie de temps etéconomie de cuves. Les pommes ayant servi à donner lepremier cidre doivent être broyées à nouveau et mises en cuves pendantquatre à cinq heures seulement et être arrosées sitôt après broyage,avec le jus du troisième cidre. Les fruits venant dedonner le troisième cidre devront être remis en cuves après avoir étébien émiettés à la main, et il est nécessaire de jeter sur eux quaranteà soixante litres d'eau par pressoir d'une barrique environ, en leslaissant macérer pendant douze heures ou vingt-quatre au plus, carautrement ils s'échaufferaient. Ce troisième cidre devra donner environ une boisson de 2 à 2 degrés 1/2. L'eauqui servira pour le troisième cidre devra être parfaitement propre, etdans le cas contraire il serait utile de la filtrer. Onobtiendra donc un second cidre ayant subi la macération avec letroisième de la presse précédente donnant 1,040 à 1,045 environ dedensité, soit environ 5% d'alcool d'après la fermentation complète. Cecidre aura donc une conservation presque aussi bonne que le pur jus parsuite même du titre alcoolique. Il est toujours facile de l'obtenirplus faible en augmentant la quantité d'eau, mais lorsqu'on désireajouter de l'eau au cidre, il est indispensable de la mettre avant lafermentation et non après, ou alors, dans ce cas, au moment même de leservir sur la table. Le matériel de fabrication doit être le plus simple possible, et par conséquent le moins coûteux et le plus facile à réparer. Lesbroyeurs ou pile-pommes doivent être recherchés broyant très fin, sanscependant mettre les pommes en bouillie. Il est d'une grande utilitéd'avoir un réglage pratique et facile à manœuvrer même en marche pouraugmenter ou diminuer la finesse du concassage suivant les pommes. Matériel de fabrication, broyeurs. Lesfruits doivent être broyés à la lumière du jour et non dans une cave,car le moût prend une teinte d'autant plus colorée que les pommesauront été exposées à la lumière solaire seulement quelques minutesaprès leur broyage. Le cuvage est inutile pour le pur jus et ne donnepas les mêmes résultats que ce procédé simple. Les mêmespommes donneront en général un cidre bien ou peu coloré, selon qu'ellesauront été broyées à la lumière du jour ou dans un appartement obscur.Nous nous servons avec toute satisfaction d'un broyeur à manège,système Simon. Pressoirs. Les pressoirs à encliquetage différentiel donnent des résultats parfaits et doivent être préférés à tous. Tamis. Lapropreté, avons-nous dit, est la première qualité exigée dans lafabrication du cidre. Actuellement, à de très rares exceptions près, onentonne le cidre tel qu'il sort du pressoir, avec toutes ses impuretés,déchets de pommes, de paille, fiente de volailles, etc. Lescultivateurs les plus soigneux se contentent de mettre devant l'anchedu pressoir un panier rempli de paille (qui ne sera jamais remplacée del'année) pour empêcher les déchets de pommes les plus gros d'entrerdans la barrique. Ils obtiendraient un bien meilleur résultat en employant des tamis de crins très serrés. Filtrage. Pourobtenir les cidres les plus fins, les plus délicats et de la pluslongue conservation, je conseille d'employer la filtration immédiatement au sortir du tamis, par conséquent avant toute fermentation. J'emploieà cet effet des filtres en amiante, système Maignen, qui sont montéssur une pompe aspirante et foulante. Le filtre est placé sur le tuyaud'aspiration et fait alors une véritable crépine filtrante empêchantl'introduction de la plus grande partie des matières étrangères aucidre et des impuretés : le jus tombe directement dans la barriqueaprès un seul filtrage. Si je désire faire un cidre encore plus soigné, je puis le filtrer une seconde fois. Le grand avantage de ce filtrage est de mettre le moût avant toute fermentation à l'abri des mauvais ferments. Jesuis partisan de ne faire qu'un seul filtrage ou deux au plus, afin dene pas enlever une trop grande quantité de ferments et d'arriver parune suite de filtrages à une stérilisation presque complète. Lafiltration de propreté suffit parfaitement et me semble préférable à lafiltration de clarification qui peut dénaturer le goût du cidre enenlevant des matières pectiques. Les jus de pommes, en passantpar les tamis de crins très fins et par les filtres, subit une aérationqui favorise une fermentation beaucoup plus rapide et plus régulière;c'est un des avantages principaux de ce procédé comme régularisateur dela fermentation et, par conséquent, comme conservation du cidre. Ensemencement. Nousavons empêché jusqu'ici les mauvais ferments de prendre possession denotre moût, par un tamisage d'abord et par un filtrage énergique. Ilnous reste à prendre une précaution parfaite, sinon nécessaire, endonnant aux ferments utiles la possibilité de se multiplier avant queles colonies de mauvais ferments n'aient pu se former si, malgré toutesnos précautions, il était arrivé que quelques-uns de ces microbesnuisibles aient pu pénétrer dans le moût. L'ensemencement dumoût se fait soit par des levures de cidre cultivées, soit en ajoutantun litre par barrique de lie de cidre filtré d'une opérationprécédente. Ces levures, quelle que soit leur provenance, doivent êtremélangées au moût au sortir du filtre, afin que la multiplication desferments utiles puisse se faire aussitôt. Les levures sélectionnées sont préférables pour l'ensemencement du moût aux lies, car elles donnent plus de sécurité. Depuisplusieurs années, j'ai fait de nombreuses expériences sur les levuressélectionnées de l'Institut La Claire et je reconnais une augmentationd'alcool et de parfum. La conservation du cidre est rendue plus facilepar leur emploi, puisque la fermentation est très régulière. M.Jacquemin, directeur de l'Institut La Claire, à Malzeville, près Nancy,se fera un plaisir d'envoyer à toute demande une brochure sur l'emploide ces levures et de répondre à tous renseignements. Entonnement dans les fûts. Tout le système de la fabrication du cidre que je préconise se base absolument sur la propreté la plus absolue. Ilest donc nécessaire de mettre, après le filtrage ou toute autreopération destinée à enlever les impuretés du moût, ce dernier à l'abrides causes amenant les mauvais ferments. Le moût doit donc êtreimmédiatement entonné. On doit avoir grand soin d'éviter les entonnoirsde métal qui, toujours, noircissent le cidre, quelle que soit leurpropreté. L'entonnoir le plus pratique, le plus solide et lemoins coûteux, est celui de bois, fait par le premier tonnelier venu ;il a l'avantage de tenir facilement sur la barrique et de ne pas nuireau cidre. L'entonnoir doit forcément avoir une douille assez petitepour que l'air intérieur de la barrique puisse sortir sans être obligéde remonter au travers du liquide qu'on fait entrer par cet appareil. Lesfûts doivent être très proprement lavés et au besoin désinfectés s'ilsavaient contenu des cidres malades ou s'ils sentaient le goût de fût oude moisi. Depuis trois ans j'emploie le désinfectant Moity. Pourquelques centimes par barrique, les fûts sont nettoyés et sont aussibons que neufs. (M. MOITY, père, Fourmies, Nord.) On nedoit remplir le fût, en commençant, que jusqu'à 5 à 10 centimètres dela bonde pour obtenir ce qui s'appelle la fermentation sous douelle. Cesystème a l'avantage immense de ne pas répandre dans la cave desquantités de mauvais ferments rejetés ordinairement hors des barriques,lorsque l'on fait bouillir à fût plein. Ces mauvais sacchromycès,existant partout dans la cave, peuvent compromettre toute unefabrication. Il est recommandable également, pour ne pastuer le cidre, de mettre à la douille de l'entonnoir un tuyau decaoutchouc qui descendra jusqu'à 5 centimètres du fond de la barrique. Soins pendant la fermentation tumultueuse. Quelquesjours après l'entonnage, la fermentation tumultueuse s'établit. Suivantla température extérieure de la cave, le cidre, les levures, cetteopération commence plus ou moins tôt. En général, du cinquième auquinzième jour, rarement plus, la fermentation est facile à reconnaîtrepar le bouillonnement du liquide. Si elle tarde, deux moyens sont trèssimples : 1° Soutirer le quart de la barrique et remettre cinq minutes après ce moût dans le fût ; 2°Introduire par la bonde un brin flexible de chêne dépouillé de sonécorce et fendu en deux ou quatre parties, et agiter violemment leliquide pendant cinq minutes. Il est rare du reste,avec le procédé que j'indique, que le fermentation ne se fasse pasrégulièrement, car il faut bien le dire : toute mauvaise fermentation apour cause une mauvaise fabrication, un défaut de propreté. Soutirage. Dès que la fermentation tumultueuse est un peu calmée, il est utile de procéder de suite à un premier soutirage. Amon avis, le meilleur appareil à soutirer, le plus simple et le moinscher, est un tuyau de caoutchouc dont vous faites siphon. Jamais deréparation, pas de métal en contact avec le cidre, facilité d'emploi,économie de temps, tels sont ses principaux avantages. Lecidre doit rester le moins possible en contact avec l'air, et ne jamaisêtre soutiré que dans un baquet très propre ou dans la barrique qui luiest destinée de préférence. La barrique, où le cidresoutiré doit être entonné, est soufrée très fortement au moyen demèches préparées. Pour une barrique, un tiers de mèche suffit, unemèche pour un demi-muid. Il faut avoir soin de laisser la barrique bienbondée jusqu'au moment où le cidre est introduit dans le fût par unentonnoir muni d'un tuyau de caoutchouc pour aller jusqu'au fond, commenous l'avons dit plus haut. A ce moment, le fût doit être remplicomplètement, mais la bonde doit être posée très légèrement, carsouvent une deuxième fermentation très vive existe pendant un ou deuxjours. Il faut toujours surveiller son cellier dans lespremiers jours après le soutirage, et faire remplir tous les fûts,chaque semaine, sans exception, à moins de se servir de purificateursd'air, système Noël, que je recommande vivement pour la fermentation,pour la conservation du cidre et pour le tirage au robinet. Cetingénieux appareil, en conservant une couche d'acide carbonique sur leliquide, le préserve de tous mauvais ferments pendant la fermentationet, d'un autre côté, purifie l'air de tout germe infectieux lorsque labarrique est en vidange. Deuxième soutirage. Quinzejours ou trois semaines après le premier soutirage, il est bon, pourles cidres de choix ou de garde, de procéder à un second soutirage quise fait absolument comme le premier. Troisième soutirage. Pour les cidres de bouteilles, il est utile de procéder à un troisième soutirage, dans les mêmes conditions. Beaucoupde fermiers prétendent que le cidre perd de sa force par les soutirageset que le goût en est changé. Rien n'est plus inexact, ainsi que denombreuses expériences nous l'ont prouvé. Lies à faire brûler. Leslies destinées à être passées à l'alambic doivent être conservées avecle même soin que le cidre, car jamais une lie acidifiée, une lie quiaura été dans une barrique défoncée, ou à moitié pleine, ne donneraautre chose qu'un alcool exécrable. Les barriques devrontêtre remplies huit à dix jours après le soutirage parce qu'une nouvellefermentation s'établit dans ce liquide après le premier soutirage, et,à partir de ce moment, les fûts devront être tenus toujoursparfaitement pleins et à l'abri de l'air. La valeur de l'eau-de-vievient en grande partie des qualités de la lie. En conservant ainsi leslies, on obtiendra une eau-de-vie sensiblement aussi bonne que leproduit du cidre pur. Cidres en bouteilles. Pouravoir de très bons cidres de bouteilles, soit mousseux, soit secs, onne peut prendre le premier cidre venu. Il faut que ce cidre soit trèsbien fermenté jusqu'à un degré densimétrique de 1012 à 1018 environ,selon la nature du cidre et le goût de chacun ; que ce cidre renfermesuffisamment d'alcool pour se conserver et enfin qu'il ait un bouquetparfait et une clarification excellente. Cette dernièrequalité, la clarification, existe toujours dans les cidres filtrés telsque je recommande de les fabriquer ; le bouquet, dû en général à lanature même des pommes, est beaucoup plus fin dans un cidre filtré quedans celui non filtré ; l'alcool est également en quantité supérieure,puisque la fermentation se fait d'une manière régulière, sans craindreles effets de mauvais ferments. Cidre mousseux. Laquantité densimétrique varie suivant le cidre lui-même et aussi suivantque l'on désire un cidre mousseux ou non mousseux. La mousse s'obtientdans les cidres, naturellement d'après la quantité de sucre existantencore dans le moût au moment de la mise en bouteilles. Il est doncfacile de savoir, à l'aide du densimètre, la quantité approximative desucre existant dans le moût à tel ou tel degré. Un cidre donnant 1010 de densité donnera un cidre très légèrement pétillant. La densité de 1012 donnera un cidre pétillant. La densité de 1015 donnera un cidre légèrement mousseux. La densité de 1018 à 1020 donnera un cidre mousseux. Au-dessus de 1020, le bris de bouteilles champenoises est à craindre. Pourdonner à un cidre le maximum de qualité, il faut opérer sur celui-cicomme sur les vins de Champagne, c'est-à-dire mise en bouteilles surpupitre et sur pointe, pour les dégager des produits de fermentation,remplissage des bouteilles d'alcool et de sirop de sucre candi. Cesprocédés sont trop longs, trop dispendieux pour être employés sur uneboisson d'un prix si minime. Je préfère donc le cidre mousseux naturel,tel qu'il est fait en Anjou, sans adjonction de sucre et d'alcool ;c'est, en un mot, un cidre naturel et non un cidre champagnisé. Cidre sec. Pourobtenir le maximum de qualité du cidre sec, il faut le mettre enbouteilles en mai au plus tard, lorsque la densité sera de 1005 à 1008environ. Ce cidre pourra acquérir une très grande qualité enbouteilles, pour les personnes préférant les cidres secs et il seconservera de longues années. Conservation des cidres en fût. La conservation du cidre en fût est facile avec un peu d'attention et un peu de surveillance de la part du propriétaire. Lescauses de mauvaise fermentation sont supprimées par l'emploi du filtreou de tout autre moyen analogue ; il n'y a plus à craindre quel'acidification qui peut se faire par la bonde, lorsque le liquide neremplit pas suffisamment le fût après la fin de la fermentation ; nousavons donc deux cas parfaitement distincts : 1° Cidres pouvant se perdre pendant la fermentation ; 2° Cidres pouvant se perdre après la fermentation. 1°Pendant la seconde fermentation, la fermentation tumultueuse étantterminée, il me semble difficile que le cidre puisse être atteint d'unemaladie cryptogamique parce que le sucre, par sa transformation,produit une couche d'acide carbonique qui, plus lourd que l'air, resteà la surface du liquide et, par suite, empêche la multiplication depresque tous les mauvais ferments, tandis que les bons ferments peuventse répandre à l'abri de l'air. Un fermant nuisible trèsrépandu dans l'air, près des étables et dans l'eau des mares, leferment butyrique, vit sans air et produit le durcissement etl'aigrissement du cidre. Ce ferment se produit dans les fermentationsmalpropres, et quand il s'est implanté dans les ustensiles, il fautd'énergiques nettoyages au bisulfate pour s'en débarrasser. Les soinsde propreté, la filtration avec un filtre bien entretenu et lafermentation par levure sélectionnée supprimeront la crainted'envahissement du cidre par ce ferment. L'usage du purificateur d'air Noël est absolument recommandé pendant la fermentation. 2°Le cidre a beaucoup plus de facilité pour être accessible à toutes lesmaladies lorsque toute la fermentation est terminée, mais se conservenéanmoins pendant de longues années, lorsqu'il est fait tel que jel'indique, après tamisage et filtrage, puisque les causes mêmes demaladies sont supprimées. Il sera utile, en tous cas, detoujours remplir les fûts tous les huit ou dix jours, jusqu'à la bonde,et d'empêcher toute communication avec l'air, soit par une légèrecouche d'huile, un purificateur d'air, ou enfin en suiffantparfaitement les fûts et les bondes. On peut conserver unfût de cidre très doux en ajoutant toutes les six semaines 100 grammesde sirop de sucre par hectolitre et en fermant ensuite hermétiquementles fûts. L'emploi de l'acide sulfureux peut servirégalement à conserver les cidres, mais l'usage de ce produit n'étantpas toujours à la portée de tous, et produisant de mauvais effetslorsque l'emploi en est mal fait, je ne l'indiquerai pas. Uncidre bien fait, proprement travaillé, bien fermenté, contenu dans destonneaux très propres, aura toujours une très longue conservation s'ilest bien entretenu et si la surveillance du maître est régulière. Uneexcellente bonde, pour boucher hermétiquement les barriques après lapremière fermentation, vient d'être inventée par M. Noël ; j'en reçusle 24 décembre le premier échantillon ; son prix, très minime, sera àla portée de tous. Pour éviter que la reprise éventuellede la fermentation ne fasse éclater les fûts, une soupape de sûretéexiste. En plus, par son démontage instantané (une seule vis), elle estfacile à nettoyer et remplit parfaitement son but, aussi bien pour letransport que pour l'emploi à la cave. Comme on a pu leconstater dans ces quelques lignes, j'emploie pour la fabrication ducidre un seul système : la propreté partout, que j'applique à la pommedepuis sa cueillette jusqu'au moment où le délicieux liquide qu'elleproduit paraît sur nos tables. RÉSULTATS OBTENUS PAR LE FILTRAGE 1°La fermentation était beaucoup plus prompte, plus active et plusrégulière que dans les fûts témoins, par suite de l'excellentefermentation opérée par les bons saccharomycès non troublés par lesmauvais. Je constate une augmentation sensible d'alcool. 2°La lie est d'une nature parfaite, ne s'acidifie pas comme la lieordinaire, elle est presque nulle dans les fûts soumis à deux filtrageset dans ceux passés à une seule opération, est de très bon goût et enquantité beaucoup plus petite que dans les fûts témoins. Cettelie tombe très facilement dans les cidres filtrés et la clarificationest parfaite quelques jours après la première fermentation. Les fûtstémoins non filtrés avaient peine à s'éclaircir et possédaient une liebeaucoup plus forte et de mauvais goût. 3° Comme finessede goût, la comparaison n'est pas possible entre les cidres filtrés etles cidres non filtrés, l'avantage étant très grand pour les cidresfiltrés. 4° Les premiers essais faits sur une grande quantité,en 1894, me permettent d'assurer que la conservation des cidres filtrésest beaucoup plus facile et peut durer plusieurs années. CONCLUSIONS Le système de fabrication et de conservation du cidre que je préconise est absolument rationnel : la PROPRETÉ. 1° Avant la fabrication les fruits doivent être récoltés et conservés avec propreté. 2° Pendant la fabrication,les instruments doivent être nettoyés souvent pour éviter les mauvaisferments. Le moût lui-même doit être filtré pour empêcher tousmauvais saccharomycès de se multiplier : utilité des tamis, filtres,etc. 3° Après la fabrication le moût doit être conservé à l'abri des mauvais ferments par les soutirages, purificateurs d'air, etc. En résumé, propreté dans toute la FABRICATION du cidre. Ona prétendu que la fabrication des cidres leur enlevait toute qualité ;je citerai comme preuve les différents concours de 1895 où ces cidresprirent part avant que ce procédé ne fût indiqué par moi. A ANGERS. — Concours régional : Médaille d'or. A LAVAL. — Concours de l'Association pomologique : Médaille d'or. A SAINT -BRIEUC. — Concours du Syndicat pomologique : Première récompense, c'est-à-dire toutes les premières récompenses. Cesdeux derniers concours étaient excessivement sérieux puisque lesprincipaux cidriers de Normandie et de Bretagne exposaient enconcurrence de nos cidres d'Anjou. En plus des prixdécernés pour le cidre, la première récompense des eaux-de-vienouvelles fut accordée à Saint-Brieuc, à une eau-de-vie de LIE FILTRÉE,alors que tous les concurrents avaient exposé des eaux-de-vie de cidreet non de lie. Puisse ce procédé si simple, si rationnel,si peu dispendieux en perfectionnant la fabrication du cidre et enassurant sa conservation, rendre service à la classe si intéressante del'agriculteur et de l'ouvrier. 28 décembre 1895. ROGER DE LA BORDE. _________________________________________________ TABLE DES MATIÈRES PRÉFACE. Calendriers. Tableau des plus grandes marées de l'année 1898. PREMIÈRE PARTIE : LE POMMIER. Nécessitéde cultiver le pommier. Rapport du pommier. Sélection du pommier. Densité. LE PLANT DEPOMMIERS. Pépinières à la ferme. Achat chez les pépiniéristes. Greffage en pépinière. Modes degreffage. PLANTATION. Commentdisposer la plantation. Choix du terrain. Distance. Nécessité de planterensemble les variétés mûrissant à la même époque. Plantation. Trous. Époque. Mise en terre. SOINS A DONNER AUX ARBRES. Entourages. Paillage. Cobéchage. Taille. Incision. Engrais des arbres. Note sur lapoudre d'os Pilon. Maladies. Nettoyage du pommier. LACIDRERIE. Le bâtiment. Matérielde fabrication. Pressoirs. Filtres. Pompes. Cuves. Matériel decave. Cuves de fermentation. Mode de fabrication du cidre. APICULTURE. Utilité de l'apiculture pour la fructification des fruits. Conclusion. Prime à nos lecteurs.La Diffusion. DEUXIÈMEPARTIE : LE CIDRE. Sa fabrication et sa conservation. PRÉFACE.Fabrication et conservation du cidre. Fermentation du cidre.Ferments nuisibles. Bons ferments. Nécessité d'empêcher les mauvaisferments. Essais de 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894. FABRICATION DUCIDRE. Tableau des variétés de pommes. Choix des pommes par l'aspectdes fruits. Choix des pommes par le densimètre. Calcul du sucre. Calculde l'alcool par la densité. Rapport de la densité du sucre et del'alcool. Conservation des pommes. Matériel de fabrication et propreté.Cuves et cuvage, petits cidres. Matériel de fabrication, broyeurs.Pressoirs. Tamis. Filtrage. Ensemencement. Entonnement dans lesfûts. Soins pendant la fermentation tumultueuse. Soutirage. Deuxièmesoutirage. Troisième soutirage. Lies à faire brûler. Cidres enbouteilles. Cidre mousseux. Cidre sec. Conservation des cidres en fût.RÉSULTATS OBTENUS PAR LE FILTRAGE. CONCLUSIONS. * * * [Pages 117 à 143 : Cahier publicitaire non reproduit] 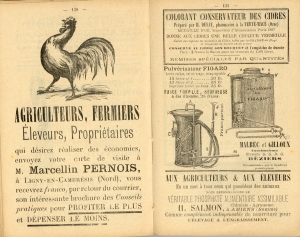 |