La Vie Rurale
Et la Production Agricole
Au Pays Normand
(Sixième article de lasérie.)
IV
IMPORTANCE DE L'ÉLEVAGE BOVIN DANS L'ÉCONOMIE RURALE DU CALVADOS. — LESHERBAGES DE LA VALLÉE D'AUGE. — LE COMMERCE DU BÉTAIL : VACHESAMOUILLANTES, BŒUFS ET VEAUX GRAS, VACHES LAITIÈRES. — L'ENGRAISSEMENTDES BŒUFS ; SON AVENIR. — LE LAIT ET LES PRODUITS DE L'INDUSTRIELAITIÈRE. — LES BEURRES D'ISIGNY. — L'EXPLOITATION DE L'ESPÈCE OVINE :MOUTONS CAENNAIS, TRUNNOIS ET CAUCHOIS. — L'ÉLEVAGE OVIN DANS L'EURE :PRODUCTION DE LA VIANDE ET DE LA LAINE. Dans l'article précédent, nous avons mis en relief les qualités denotre belle race bovine normande, et les mérites des éleveurs qui, parune sélection persévérante, ont amené cette race à un très haut degréd'amélioration, et l'ont rendue apte à satisfaire merveilleusement auxfonctions économiques (production du lait, du beurre, de la viande) quifont l'objet de son exploitation et constituent de multiples sources derichesse pour notre belle contrée.
Nous n'avons pas encore quitté le Calvados, l'étude de ses productionsagricoles exigeant un développement en rapport avec leur importancemême. Aussi bien, nous estimons que si pour chacune de nos provincesfrançaises, on s'appliquait à faire ressortir la variété et la valeurdes éléments appelés à jouer un rôle dans l'œuvre économique visant àl'accroissement de la richesse et à la prospérité du pays, ce serait làun moyen de faire progresser vigoureusement la campagne devenue plusque jamais nécessaire en faveur du régionalisme.
En Normandie, l'exploitation animale est, à tous les points de vueauxquels on se place, la forme la plus intéressante — comme aussi laplus ancienne — de la mise en valeur du sol. L'Economie du bétail,surtout en ce qui concerne le bétail bovin, est le premier et le plusimportant facteur sur lequel s'appuie l'Economie rurale. De quelquefaçon qu'on l'envisage, fût-ce même dans les manifestations de l'artqui s'inspirent de la beauté du paysage normand, l'élevageapparaît comme la caractéristique de notre petitePatrie. Les chefs-d'œuvre de Troyon, notamment son magnifiquetableau
La vallée d'Auge, nous montrent, à travers les fertilesherbages, des riantes vallées de la Touques, de la Dives et de la Vie,qui, elles-mêmes, se subdivisent en plusieurs vallées secondaires etsont séparées les unes des autres par des collines ou des plateaux —telles les vallées de Vimoutiers, de Livarot, de Saint-Julien, deCrèvecœur, de Lisieux, de Corbon et de Pont-l'Evêque — les grands bœufsnormands plongés dans l'herbe épaisse et attendant, après le coucher dusoleil, les salutaires effets de leur paisible rumination.
C'est sur ce magnifique tapis de verdure, strié de limpides cours d'eauaux rives verdoyantes, et agrémenté de collines aux pentes doucescomplantées de haies vives et de pommiers innombrables, d'ormeauxgéants à proximité de rustiques cottages aux façades roses, garniesd'espaliers ; c'est dans ce silencieux décor, au milieu de cesplantureux herbages, dans ce cadre, doux et humide, frais etpittoresque, à hivers peu rigoureux, et à étés tempérés, ques'élaborent les richesses de l'élevage bovin. Le Pays normand — leCalvados notamment — se distingue par la prédominance du régimeherbager sur la culture arable ; cette dernière, n'occupant qu'unesurface relativement réduite, cède le pas aux pâturages, consacrés à lapratique de l'élevage, de l'engraissement et de la production du laitqui forment la base de la richesse du pays. Le régime habituel dubétail est l'herbage et non la stabulation, sauf pour les jeunesanimaux, pendant quelques mois. C'est à ce régime que l'on doit lesuccès des entreprises zootechniques, dans l'exploitation des diversesfonctions économiques des bovidés.
***
Voyons comment s'exercent, dans le Calvados, les diverses formes del'élevage bovin, quels résultats on en obtient et ce qu'en peuventretirer l'agriculture et le commerce de ce département, de même que, àcertains points de vue, l'agriculture et le commerce des autresdépartements normands. Dans l'arrondissement de Caen, un centred'élevage réputé est le canton de Villers-Bocage ; à quatre lieues à laronde de ce chef-lieu de canton, qui est un marché très important,notamment pour les vaches amouillantes, on élève de nombreux sujets quise vendent toujours facilement et à des prix rémunérateurs, et vontpeupler les étables de Seine-et-Marne, Seine, Seine-Inférieure,Seine-et-Oise et de l'Yonne. Suivant les habitudes locales, lesacheteurs préfèrent tantôt les animaux à pelage bringé, tantôt ceux àpelage caille. Villers-Bocage partage avec Vire, Carentan, Litry,Isigny et Bayeux, ce fructueux commerce dans les départements précités.Les bœufs gras se vendent surtout à Caen, après avoir été achetésmaigres dans le département de la Manche, à Avranches, La Haye-Pesnelet Montebourg.
Cette prospérité de l'élevage, particulièrement de la production devaches laitières ayant de grandes qualités, a contribué à développerlargement, en temps ordinaire, dans l'arrondissement de Caen, lecommerce du lait et des produits laitiers. On obtient le kilogramme debeurre avec 22 litres de lait, en moyenne, et la fabrication du beurreavec les appareils centrifuges s'est répandue dans cette région.
Les bœufs engraissés dans les riches pâturages de l'arrondissement dePont-l'Evêque viennent, en grande partie, de la Manche, de l’Orne, dela Mayenne, de Maine-et-Loire, et de la Sarthe. La Bretagne et leNivernais fournissent aussi un certain contingent de bœufs maigres.
Nos herbagers ou engraisseurs se plaignaient — il y a de cela quelquesannées — de ne pas trouver dans leurs opérations tout le profit qu'ilsen devraient retirer, et ils en attribuaient la cause à l'écart troprestreint existant entre le prix d'achat (cours maigre) et le prix devente à la boucherie (cours gras). Mais la guerre, qui a siprofondément modifié les conditions du marché de la viande, ne peut querendre à la pratique de l'engraissement l'intérêt qu'elle présentaitjadis, ne serait-ce que par les besoins toujours plus grands de laconsommation et l'élévation considérable des cours de la viande, qui nes'atténuera pas après la cessation des hostilités. Que l'on songe aussià l'intensité des réquisitions de bétail depuis le début de la guerre,et on concevra aisément que les producteurs de viande ont toute raisond'escompter, pour l'avenir, le retour à une situation meilleure, mêmeen tenant compte des transformations qui se produisent dansl'exploitation des terres (mise en herbe des terres labourables) et del'extension de l'engraissement des bovidés dans les pays betteraviers.
D'autre part, il y aurait un réel intérêt à développer l'élevage etl'industrie laitière, encore trop négligés dans cet arrondissement. Unevache d'aptitudes moyennes donne, pendant trois mois, une moyenne de 16litres de lait par jour, pendant trois autres mois, 12 litres, etpendant quatre mois, 6 litres, c'est-à-dire qu'une vache de qualitémoyenne donne, par an, environ 3.300 litres de lait. C'est un sérieuxappoint à assurer aux exploitations qui, actuellement, ne se consacrentpas encore à la production laitière.
Et puis, nos cultivateurs auraient de même avantage à se grouper enassociations pour la vente du lait à un prix déterminé aux fromageriesimportantes, et à exploiter en commun des beurreries de façon àmaintenir le prix du lait vendu à la fromagerie et à faire du beurreavec tout le lait produit, quand la saison n'est pas favorable à lafabrication du fromage. Le petit-lait résiduel servirait à nourrir desporcs, d'où un nouveau bénéfice ajouté à ceux de la productionlaitière, beurrière et fromagère. Il n'est pas excessif de dire qu'entemps normal, une exploitation entretenant douze vaches laitières peutréaliser sur l'engraissement des porcs, un bénéfice annuel de 800 à1.000 francs.
Dans l'arrondissement de Lisieux, nous voyons prédominer la variétéaugeronne du bovin normand ; mais on se procure aussi des taureaux dansle Cotentin. On élève les génisses et on livre les mâles à laboucherie, vers l'âge d'un mois et demi. Bon nombre de ces veaux grassont consommés dans le pays ; les autres sont vendus sur le marché deCaen et sur celui de La Villette.
On aurait de meilleurs veaux en ne supprimant pas l'alimentation aulait pur, pour substituer à ce dernier du lait écrémé et des farines,régime qui est tout à fait insuffisant, défectueux.
Les contrées voisines de la Normandie fournissent aux éleveurs de larégion lexovienne, les bœufs à engraisser. Les principaux centresd'engraissement sont : Lisieux, Fervaques (vallée de la Touques),Méry-Corbon (vallées de la Dives et de la Vie), Mesnil-Mauger,Saint-Julien-le-Faucon (vallées de la Vie et de la Viette). Les bœufsengraissés donnent lieu à d'importantes transactions sur le marché dela Villette ; quelques-uns sont expédiés sur les marchés de Caen et deRouen.
Le lait produit dans cet arrondissement est utilisé à la fabricationdes fromages Camembert et Pont-l'Evêque ; en été, on en fait du beurre.Les produits sont vendus à Paris et en Angleterre. Les fromages faits àla ferme sont vendus à des « caveurs » qui les affinent et les livrentensuite à la consommation.
***
L'arrondissement de Falaise est remarquablement favorisé au point devue du commerce des vaches. Chaque commune vend le lait de ses vachesaux nombreuses fromageries qui existent dans la contrée. Quant auxbœufs gras, on en trouve principalement à la fameuse foire de Guibray.Cet arrondissement produit environ les deux tiers des animaux gras quis'y trouvent. Il faut observer que la Société d'agriculture de Falaisea contribué pour beaucoup, par ses concours, ses encouragements à lasélection, à améliorer le bétail bovin. C'est un exemple que devraientsuivre toutes nos sociétés locales ayant à se consacrer audéveloppement de l'élevage et des industries qui en dérivent.
La région de Bayeux a, elle aussi, des éléments d'exploitation del'espèce bovine qui tiennent une grande place dans l'Economie rurale dupays. On y engraisse des bœufs provenant de cet arrondissement oud'autres régions du Calvados, de la Manche, du Morvan et de laBretagne. C'est dire qu'on importe des sujets d'autres races que larace normande (croisement Durham). L'élevage des veaux ne se pratiqueque rarement, mais on les engraisse, à l'âge de 3 ou 4 mois, pour lesvendre à la boucherie. La nourriture qu'on leur distribue consistesurtout en petit-lait auquel on mélange des farines de blé, de sarrazinet de la fécule de pomme de terre ; à la dernière quinzaine del'engraissement, on ajoute à la ration de chaque veau et par jour, 3 à4 litres de lait doux. Dans quelques cantons, principalement ceux deBalleroy, Caumont et Rye, on élève des génisses pour renouveler lecontingent des vacheries.
Le commerce des vaches amouillantes et des vaches laitières est trèsimportant sur les marchés de Bayeux, Isigny et Le Molay. Presque toutesces vaches sont revendues aux nourrisseurs-laitiers parisiens et auxcultivateurs de la grande banlieue de Paris.
Les beurres produits dans l'arrondissement de Bayeux se vendent auxHalles centrales de Paris, sur les marchés de la région et auxexportateurs de Coutances, Valognes et Vire. Les principaux marchés oùse vendent les beurres sont ceux de Balleroy, Bayeux, Isigny, Caumontet Trévières.
Le climat, la qualité des herbages, les aptitudes de la race et enfinla bonne méthode de fabrication sont les facteurs essentiels quidonnent aux beurres du canton d'Isigny leurs incomparables qualités etjustifient leur universelle renommée. Il faut ajouter que de grandsprogrès ont été réalisés dans l'industrie beurrière, notamment parl'emploi de l'écrémage centrifuge avec pasteurisation des crèmes etensemencement par les ferments naturels du pays. C'est grâce à cesaméliorations suivant des principes scientifiques rationnellementinterprétés et appliqués, que la qualité des beurres d'Isigny a trouvésa consécration dans la haute valeur acquise par ces beurres sur lemarché de Paris, comme sur ceux du monde entier.
Les animaux de l'espèce bovine entretenus dans l'arrondissement deVire, pays d'herbe, très favorable à l'élevage, appartiennent tous à larace normande ; ces animaux sont de petite ou de moyenne taille,généralement assez bien conformés ; leur squelette réduit est le refletde la nature granitique ou schisteuse du sol. Si les vaches que l'onentretient dans la région de Vire ne donnent pas autant de lait que lespuissantes vaches, du Cotentin — surnommées « alambics » ou « fontaines» à lait — par contre, leur période de lactation est de longue durée,et leur rusticité est bien connue. On apporte une attentionparticulière à la sélection des reproducteurs et, chaque année, on varecruter, dans la Manche, notamment dans le canton de Percy, quelquesbons taureaux qui fournissent de belles lignées et impriment à lapopulation bovine de cette partie du Calvados des qualités infinimentprécieuses et fort appréciées.
On engraisse les bœufs dans le pays même, et le commercedes vaches amouillantes, en temps normal, présente une grandeimportance sur les marchés de Vire et de Condé-sur-Noireau. Ce dernierreçoit, en certaines années, plus de 5.000 bœufs, vaches et veaux.
La production laitière et beurrière est importante. La vente du lait ennature est réservée aux grands centres. Le beurre, produit en grandesquantités, se vend en mottes, sur les marchés ; il présente une pâtemoins onctueuse, plus courte et plus sèche que celle des beurresd'Isigny. Les beurres du Bocage normand réussissent surtout commebeurres salés, pour l'exportation.
***
Les animaux de l'espèce ovine sont très inégalement disséminés sur leterritoire des cinq départements normands : l'Eure est de beaucoup leplus peuplé ; avant la guerre, on y comptait 250.000 têtes ; leCalvados est le plus pauvre, la statistique de 1914 indiquant 15.000têtes, tandis que l'Orne s'inscrivait avec 56.000, la Seine-Inférieureavec 128.000 et la Manche avec 178.000.
Le nouveau système de culture et le manque de bergers paraissent êtreles causes dominantes de la diminution du nombre des troupeaux ovins.Dans la région lexovienne, on engraisse surtout les moutons élevés danscette région, mais ce genre de spéculation n'a que peu d'importance,aussi la production ne suffit-elle pas aux besoins locaux. Dansl'arrondissement de Vire, le climat, la nature du sol, le système deculture se prêtent peu à l'élevage du mouton. Les troupeaux sont deraces très mélangées : race locale, croisée avec la race de Dishley ouavec d'autres types plus ou moins bien définis.
Dans l'Orne et le Calvados, les bergeries sont formées de moutonscaennais ou trunnois (nom tiré de Trun, chef-lieu de canton de l'Orne),qui se reconnaissent à la coloration rousse ou dorée des poils de laface et des pattes, et à la saveur délicate de leur chair.
Sur le littoral de la Manche, on élève la race originaire des comtésméridionaux d'Angleterre, race habituée à la brume, aimant le pacage enliberté et ne craignant pas l'humidité du sol.
Sur les grands plateaux découverts du pays de Caux, si souvent balayéspar les vents violents du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest, onexploite la race cauchoise qui dérive des races picarde et artésienne.Ce sont des moutons à hautes jambes, taillés pour le parcours, etd'aspect assez fruste, mais très rustiques. Ce type de mouton neprésente pas, dans sa conformation générale, ce cubisme corporel quiest l'idéal poursuivi par les éleveurs, dans les autres provinces. Parla sélection constante et minutieuse, on arriverait à améliorer cetteconformation du mouton cauchois.
Dans le département de l'Eure, l'élevage ovin est bien plus important.Ainsi que nous le faisions remarquer dans notre précédent article,c'est Henri de Tilly, châtelain de Tilly et seigneur de Fontaines qui,au moyen âge, introduisit en Normandie des brebis venant de Séville. En1811, Napoléon Ier fit instituer dans l'Eure, des dépôts peuplés debéliers mérinos choisis en Espagne par Gilbert. En 1816, on commença àcroiser le mérinos avec les races cauchoise et trunnoise ; en 1828, letype anglais new-leicester avec des brebis mérinos. De nos jours, letype ovin exploité dans les plaines sèches de l'Eure : Vexin normand,Plaine de Saint-André, Plateau du Neubourg, est le Dishley-mérinos,type mixte, producteur de viande et de bonne laine fine, ayant le friséde la laine du mérinos du Soissonnais. Notre bon ami, M. A. Bourgne,directeur des Services agricoles de l'Eure, qui, depuis tant d'années,prodigue aux éleveurs de ce département ses sages conseils, les fruitsde son savoir et de sa grande expérience en matière d'élevage, et qui aainsi largement contribué aux améliorations réalisées, nous citait destroupeaux justement réputés : celui de M. Henri Doré, à Gamaches, danslequel des acheteurs argentins et australiens viennent faire parfoisdes acquisitions ; le troupeau des bergeries de M. M. Bouchon, àNassandres, véritable fabrique de viande, exploitant les produits ducroisement de béliers southdown (race anglaise des Dunes), avec nosbrebis berrichonnes. Les agneaux, vendus à l'âge de cinq mois ou cinqmois et demi, fournissent 35 à 38 livres de viande. On engraisse lesmoutons avec des pulpes de sucrerie ou de distillerie.
***
Par ce rapide aperçu de l'élevage et de l'exploitation de l'espècebovine, dans le Calvados, et de l'espèce ovine, dans l'Eure, on peutdéjà apprécier l'importance de la part contributive que cette région dela Normandie doit apporter à la production de la viande et du lait,denrées de première nécessité dans notre alimentation. Nous aurons àétudier, dans des articles ultérieurs, d'autres sources de productionde l'agriculture normande.
Henri BLIN,
Lauréat de l'Académie d'Agriculture de France.
*
* *
RICHESSES MINIÈRES
de Normandie
Au mois d'avril dernier, dans mon article sur les Richesses minières deNormandie, j'indiquais que lors de leur visite à Caen, en novembre1916, les ministres avaient annoncé que le gouvernement demanderait auxChambres un crédit de deux millions pour assurer la prospection dubassin houiller de Littry, dans l'arrondissement de Bayeux.
Un premier pas vient d'être fait. M. Desplas, ministre des travauxpublics, a résolu d'assurer la prospection immédiate de ce bassin ;deux sondages vont être pratiqués aux environs deSaint-Martin-de-Blangy, sous la direction de M. Bigot, doyen de laFaculté des sciences de Caen et par les soins du service de la cartegéologique de France.
D'autre part, les Etablissements Schneider et Cie viennent d'êtreautorisés à entreprendre une campagne de sondages à l'est de laconcession du Plessis et à l'ouest de l'ancienne concession de Littry.Un sondage doit être fait près de Saint-Froment, sur le prolongementprésumé, vers l'ouest, du bassin de Littry, que l'on croit devoir êtrefort riche en charbon de bonne qualité.
Cette décision vient à l'appui de la conviction qu'avaient lesingénieurs Vieillard et Hérault, de la continuité du terrain houillerentre les mines de Littry et du Plessis.
Les efforts du dévoué Président du Conseil général du Calvados, M.Henri Chéron, sénateur, ont été pour beaucoup dans ce premier pas versla solution de la question houillère en Normandie.
Une autre bonne nouvelle, toujours au sujet du combustible :
Un industriel, à la suite de l'autorisation qui lui a été accordée, le16 juin dernier par le Préfet du Calvados, vient de commencerl'exploitation de la tourbe à Chicheboville.
Une autre demande d'exploitation est en instance, en ce moment, à laPréfecture du Calvados, et recevra très probablement une solutionfavorable.
On me signale également une très importante exploitation de tourbière àHeurteauville, en face Jumièges (Seine-Inférieure)- Le chantier ouvertdepuis le mois d'avril dernier compte 80 ouvriers environ.
En outre, le gisement de Vierville, Saint-Laurent et Colleville a étéconcédé à M. Basly, à Isigny, qui espère extraire 60 tonnes par jour,au moyen de la main-d'œuvre de prisonniers allemands mis à sadisposition.
Espérons que ces bons exemples seront suivis, car il existe enNormandie, d'autres tourbières exploitées autrefois.
A. M.
*
* *
L'Hôtellerie des Plages Normandes
Un de nos abonnés appelle mon attention sur un article, paru le 12
août dernier, dans l'Action Française
, sous la signature de M. PierreChastel, qui écrit :
……… Il faut avouer que la masse des consommateurs se plient d'une façonbeaucoup trop sensible aux exigences des fournisseurs. Les prétentionsde ceux-ci sont en raison directe de la docilité de ceux-là ? Enveut-on la preuve ? La voici : le prix moyen de la pension, qui est de12 francs par jour sur les plages bretonnes s'élève à 22 francs parjour dans le plus misérable hôtel des côtes normandes. Pourquoi ? Parceque la clientèle des plages normandes est plus facile à déplumer quecelle des plages bretonnes. Elle est plus riche.
……… Et n'importe qui peut aller le constater lui-même, que lanourriture des hôtels bretons est actuellement de beaucoup supérieurecomme qualité et comme quantité à celle des hôtels normands malgré ladifférence sensible des prix. Pour 3 francs vous faites un excellentdéjeuner à Roscoff, tandis que vous courez le risque de mourir de faimà Houlgate ou à Villers-sur-Mer. Et pourtant le ravitaillement n'estpas plus difficile dans ces deux derniers endroits, au contraire.
Où notre confrère, a-t-il puisé ses renseignements en ce qui concernela Normandie ? Est-ce à Houlgate, ou à Villers sur Mer qu'il cite dansson article ? Je doute fort que les hôteliers de ces deux stations balnéaireslaissent passer sans protestation, cette réclame d'un nouveau genre, sielle parvient à leur connaissance. Et M. Pierre Chastel me permettra de prendre la défense des hôteliersnormands en général, qui, pas plus que leurs confrères bretons, n'ontl'habitude d'écorcher toute vive leur clientèle. Le prix de 22
francs par jour qu'il indique, a dû lui être demandé,je suppose, dans un de ces palaces que l'on rencontre aujourd'hui dansles principales stations balnéaires et que, pour les besoins de lacause, il qualifie du plus misérable hôtel des côtes normandes !!!
Il ne manque pas, sur toute l'étendue des côtes normandes, de bonshôtels de deuxième ordre, où le prix de la journée varie de 8
à 12
francs, et comprend : la chambre, trois repas avec boisson, le service,la lumière, etc., et, n'en déplaise à M. Chastel, on n'y meurt pas defaim. Lorsqu'il le désirera, je me ferai un plaisir de lui indiquer,sur la côte normande, des hôtels où il trouvera bon gite et bonne tableà des conditions raisonnables. M. Pierre Chastel me permettra encore de lui signaler, qu'en publiantun article de ce genre, sans s'être suffisamment documenté, il porte leplus grand préjudice à une classe d'honnêtes commerçants. Si vraimentil a été écorché, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il le dise, àce qu'il cite même l'écorcheur ; les hôteliers auront vite fait de sedésolidariser d'avec un pareil confrère ; mais de là à généraliser et àjeter la suspicion sur toute une corporation, il y a loin. Dans le numéro d'août de Normandie
, j'appelais l'attention deshôteliers normands sur la constitution de la Chambre Nationale del'Hôtellerie française
, toute désignée pour prendre en mains la causedes hôteliers dont les intérêts pourraient être lésés par une semblablepublication, et je suis persuadé que les membres normands du Conseild'administration, MM. Lebrun et Ducoudert, se feront un devoird'appeler son attention sur ce fait.
***
Qu'ont donc bien pu faire les Normands à M. Pierre Chastel ? Dans uneautre partie de son article, il écrit encore:
……… La vérité m'oblige à dire, d'ailleurs, et tout de suite, que lesprix des denrées comestibles varient dans des proportions considérablesavec les régions. Un poulet, par exemple, coûte en Bretagne moitiémoins cher que dans les Pyrénées, et deux fois moins cher qu'enNormandie. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Bretons sont moinsâpres au gain que les autres. La production et le prix de revient desvolailles sont à peu près équivalents dans ces trois régions.
Je n'ai aucun renseignement sur le prix de revient de l'élevage desvolailles, mais ce facteur n'est pas le seul qui influe sur les prix devente. Il faut aussi, et pour une large part, y faire entrer la loi de l'offreet de la demande, ainsi que les conditions économiques dans lesquellesse trouve la contrée où se font les achats. Sous ce rapport, laNormandie voit non seulement affluer des ordres d'achat venant de lacapitale, mais encore, sur son territoire, sont installés de nombreuxcamps anglais, et l’on sait que nos alliés sont aussi prodigues deleurs livres sterling que de leur sang. L'âpreté au gain n'a donc rien à voir dans cela. A. MACHÉ.
*
* *
FIGURES NORMANDES
Albert Boissiere
L’Extravagant Teddy, de la Croix-Rouge anglaise (1), tel est le titredu dernier roman qu'Albert Boissière, le grand écrivain normand dédieau grand poète normand Paul Labbé.
Je viens de recevoir ce livre, soigneusement édité par Pierre Lafitte.Si vous connaissez l'œuvre d'Albert Boissière, je vous engage à lelire, car jamais cet auteur n'écrivit quelque chose de mieux construit,d'aussi ingénieux, d'autant audacieux, de plus attachant. Et si vousl'ignorez, je vous engagerai plus vivement encore à acquérir ce bouquin: l'
Extravagant Teddy de la Croix-Rouge anglaise, en effet,synthétise aussi complètement que possible le talent très particulierd'Albert Boissière, homme exceptionnel en toutes choses.
Cache ta vie, montre tes œuvres : voilà sa devise. Elle est sage. Cen'est pas une raison pour que je ne soulève pas, à votre intention, unpetit coin du voile — car la vie de notre célèbre compatriote est aussipittoresque que le meilleur de ses romans.
Sans entrer dans des détails dépassant à la fois les limites du permiset celles d'un portrait à la plume, sachez donc qu'Albert Boissière, néle 26 janvier 1866, à Thiberville (Eure), passa la première moitié deson existence à restituer joyeusement à la collectivité la confortablefortune qu'il tenait de son père. Beaumont-le-Roger, Bernay et autreslieux se souviennent encore de ce joyeux, généreux, solide et beaugarçon, observateur scrupuleux des préceptes de ses vieux compatriotes,Olivier Basselin, Le Houx, et Saint-Amand. En particulier, certainmagistrat bernayen n'oubliera jamais la nuit paisible au cours delaquelle, grâce à la... sollicitude d'Albert Boissière, il fut arrêtépar les gendarmes et coffré sans hésitation pour attentat à la pudeur.Cette insouciante existence dura tant que l'auteur de l'
ExtravagantTeddy n'eut pas de doutes sur la solidité de son crédit. Elle cessalorsqu'il ne lui resta en toute propriété qu'une rente insuffisantepour lui permettre de vivre pendant un mois entier.
Que faire ? Refaire fortune, parbleu !... Mais en vendant quoi ?...Tout simplement de la littérature — le seul métier ou le seul Artauquel Albert Boissière n'avait jamais songé I Et, sacrifiant àl'usage, pour une fois mais bien à sa manière, il débute par un volumede vers : l'
Illusoire Aventure (2) (Edition de
La Plume, 1897).
Paris ne l'intéressa pas longtemps. Il y fonda pourtant une éphémère etrarissime revue qu'il intitula :
D'Art, titre original et bref,suffisant presque à caractériser déjà son inventeur. Cet infortunéprovisoire y fit la charité, mais il sut choisir ses pauvres, et l'onput lire à ses sommaires des noms consacrés depuis (ou à la veille del'être) : Jean Viollis, Yvanohé Rambosson, André Magre, auteur des
Poèmes de la Solitude, en attendant d'être un héroïque sous-préfet,son frère Maurice Magre, qui écrivait alors la
Chanson des Hommes,Paul Vérola, Edmond Pilon, etc.
Enfin, d'une de ses innombrables et successives résidences de province,il envoya les
Magloire, roman rustique aussi différent que possiblede l'
Illusoire Aventure, à Eugène Fasquelle, qu'il ne connaissaitpoint.
Fasquelle, continuant les traditions de Charpentier, est un desrarissimes éditeurs qui lisent et qui traitent en amis les auteurs deleur goût. Il édita les
Magloire, « inventant » ainsi AlbertBoissière, écrivain à peu près inédit — comme il nous « inventa » peuaprès, M.-C. Poinsot et moi, en publiant notre premier roman,l'
Echelle, sans nous avoir jamais vus et sans rien savoir de nous. Ducoup, Albert Boissière fit tomber les longs et fins cheveux encadrantle front du bel auteur de l’
Illusoire Aventure — à la stupéfaction dela Rive-Gauche éperdue... Au point qu'Henri Mazel, portraicturantl'étonnant écrivain dans la
Plume de Léon Deschamps (3), pouvaitécrire : « Au physique, Albert Boissière est un homme d'environtrente-cinq ans, d'allure robuste, de physionomie franche, de regardaffectueux ; jadis il se nimbait d'une auréole crespelée et noire,aujourd'hui il se profile en crâne de centurion sur camaïeu chauve.Lebègue a représenté les deux Boissière, la main dans la a main, lechevelu tenant l'
Illusoire Aventure, le dénudé ostentant les
Magloire ; ces deux « Siamois semblent frères. »
Or, jouer les frères Siamois ne suffit bientôt plus ni àBoissière, ni même aux héros de ses romans (l’
Extravagant Teddy etplusieurs de ses aînés vous le montreront) : il joua les Protée.
Poète en quatre genres, fort différents avec la
Gloire de l'Epée,œuvre de la noble école hérédienne,
Culs de Lampe, « bouquet deciselures martelées par un chef ouvrier désireux de se prouver àlui-même sa maîtrise en tous les styles (4) », L’
Illusoire Aventure,influencée à la fois par Baudelaire et par Mallarmé, et Aquarellesd'Ames (Ed. de « la Maison d'Art », 1901) où la sensibilité exaspéréedes précédents recueils montre plus de profondeur intime, moins de goûtpour l'allégorie et le décor et où il se soucie plus « de revêtirl'idée avec netteté et de traduire son caractère que de collaborer à untissu harmonieux de nuances égales (5) », romancier néo-naturalisteavec les
Magloire, grande étude terrienne, toute parfumée de la bonneodeur des pommes normandes, « fresque de mœurs rustiques se rattachantà tous les grands peintres de la vie rurale, à Zola par l'intensité dela vision ; à Guy de Maupassant, par la fidélité de l'observation ; àl'Huysmans d'
En rade, par la particularité artistique de l'expression(6)» et avec
Une garce (Fasquelle, 1900), il revient immédiatement àl'écriture artiste et compose un roman symboliste :
Les trois fleuronsde la couronne (Fasquelle, 1900), puis des romans humoristiques, où,constate Pierre Véber, il obtient « un comique particulier par uneobservation minutieuse des petits gestes et des petites pensées », puisdes pages de critique d'art telles que
Le Peintre J. L. Rame (chezGentil) ; puis des contes et des nouvelles à l'
Echo de Paris, au
Journal, au
Matin, etc. ; puis des essais de feuilletons de tousordres annonciateurs de ses grands succès du
Petit Journal et du
Petit Parisien ; puis d'aimables et gaies reconstitutions historiques:
Jolie, d'abord publié par l'
Echo de Paris et la
Crinolineenchantée, offerte en inédit aux lecteurs du
Figaro ; puis d'alertescritiques littéraires au
Nouveau Précurseur d'Anvers ; puis desromans policiers et de grands ouvrages populaires en France et àl'étranger :
Le scandale de la rue Boissière ;
Un Crime a étécommis ; l'
Homme sans figure ;
Z, le tueur à la corde ;
Le PetitMécano,
Le Clown rouge ;
Les Deux Milliardaires, etc.. Et je n'aicité ni la
Tragique Aventure du Mime Properce, ni
La Vie malheureusede l'heureux Stevenson, ni les
Chiens de Faïence, ni les
Tributaires, ni
Joies conjugales, ni
Clara Bill, danseuse, ni le
Jeu de Flèches, ni même
M. Duplessis, veuf, son premier feuilleton: « le cœur m'en bat encore à quinze ans de distance !... »,m'écrivait-il en 1915.
Tout cela fut édité par Fasquelle ou Pierre Laffitte, publié en inéditpar le
Temps, le
Journal, le
Figaro, le
Petit Journal, le
Matin ou le
Petit Parisien, reproduit en province, en Angleterre,en Belgique, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, puis en Serbie, enRoumanie, en Espagne, en Suède, voire en Autriche et en Allemagne même!...
Les écrivains les plus féconds restent confondus devant une productionaussi rapide, aussi parfaite — et d'une, variété sans seconde.
Quant à Albert Boissière, il semble que son talent se complète etgrandisse sans arrêt d'un volume à l'autre.
Jamais il n'a mieux jonglé avec les difficultés effrayantes qu'ilsemble accumuler à plaisir, que dans L’
Extravagant Teddy de laCroix-Rouge anglaise ; jamais il n'a échafaudé une intrigue plussaisissante, plus serrée, plus étrange (J.-H. Rosny aîné seul, grâce àson admirable génie, a pu le dépasser dans l'
Enigme de Givreuse),jamais il n'a plus dédaigné les effets, le style et le morceaud'anthologie ; jamais non plus il n'a écrit une langue plus directe,plus sobre, plus correcte (en dépit d'
un rien, très voulu, de raideuranglaise), plus complètement exempte de bavures.
Pourtant, la littérature semble n'être plus pour lui — revenu de tantde choses, de tant de lieux et de tant de gens ! — qu'un passe-tempsassez dénué d'agrément.
La guerre l'a surpris dans les Pyrénées qui lui ont rendu la santé,qu'il ne quitte plus et où il stupéfie les foules. Ne faisant qu'unavec son auto, il file à toute vitesse « pour les virages à la corde etgrimpe toutes les côtes en prise directe ». Il se lance comme unprojectile « sur les routes ondulées qui, de Biarritz à Luchon, sedéroulent dans les sites les plus variés, tour à tour plaisants ettragiques ... » Il n'ébouriffe plus les pensionnaires du
Soleil d'Or,il ne fait plus coffrer les magistrats de Bernay pendant les bellesnuits silencieuses où son rire annulait le frisselis de la Charentonne,mais du Pic du Midi d'Ossau au Pic du Midi de Bigorre, il se conduitcomme un wiking foulant un rivage inconnu. Dans ses ruées affolantes,il a écrasé sans remords des chiens, des oies, des canards et descochons considérables, mais les contraventions pour excès de vitessen'ont pu mettre fin à ses exploits de Tarbes à Pau, de Saint-Christau àBagnères, ou de Biarritz à Luchon, — que Jean Lorrain éberlua naguèred'autre façon.
Excès de vigueur, amour héréditaire du changement, de l'aventure et dudanger, procédé de travail, moyen de surexciter l'imagination (lentechez nous tant qu'elle n'a pas un point d'appui,) fuite ou dédain desréalités toujours décevantes, ou culture physique intensive ?... Quenous importe !...
Depuis qu'Henri Mazel saluait ce « Normand de pure Normandie » à sesdébuts, signalait sa « carrure semi-trapue », sa « forte moustachearquant le milieu du visage » et proclamait qu'il rappelait Flaubert,Albert Boissière bon vivant très vivant, a créé, comme en se jouant,une œuvre solide, neuve, bien à lui, encore plus vivante que lui.
C'est à merveille. Tout le reste n'est rien.
Georges NORMANDY.
(1) 1 vol. sous couverture ill. (Ed. Pierre Laffitte, 90, av. desChamps-Elysés, Paris), 3 fr. 50.
(2) Je passe sous silence deux minces plaquettes : La Gloire del'Epée et Culs de Lampe.
(3) 1er mars 1899, p. 146 et suiv.
(4 Henri MAZEL, passim.
(5)(6) Gustave Kahn. *
* *
Colombine sauvée
ballet-pantomime en un acte et quatre tableaux
par
Jean Lorrain
TROISIÈME TABLEAU
Un cimetière de village, très gai, très ensoleillé, bordé, au fond,vers la droite, par le chevet de l'église dont les contreforts viennentmourir dans l'herbe. Le fond de la scène est occupé par le mur ducimetière, - dont une partie, écroulée, laisse voir la campagne etd'immenses champs de blé, - mur fuyant à perte de vue, sur le cielbleu. A gauche, entre deux piliers rongés de mousse, la grille ducimetière. Sur une des tombes, déjà envahie par les herbes et occupantle milieu de là scène, on peut lire : « Ci-gît PIERROT. » Au lever du rideau la scène est vide. Une femme en haillons,encapuchonnée d'une mante et qui semble se traîner avec peine, paraîtdans la brèche du cimetière. Elle passe et disparaît.
Une minute après, elle reparaît à la grille, entre et se dirige enchancelant parmi les tombes : c'est C
OLOMBINE. Elle se laisse tomber,assise, les mains jointes, sur l'une d'elles ; elle songe, puis, avecun geste de désespoir, elle se lève et va rôdant par le cimetière commesi elle cherchait à lire une inscription.
Elle arrive devant celle de P
IERROT, recule comme épouvantée, puisdemeure stupide, les mains jointes sous sa mante et la tête baissée.
Le gardien du cimetière, depuis un moment, vaque à travers les tombes,un arrosoir à la main, et passe auprès d'elle sans lavoir. C
OLOMBINE l'entend, tressaille et allant vers lui, lui demandequi est enterré là. Le jardinier lui explique par signes que c'est unfou qui aimait une dévergondée, une jeune fille perdue, qui a quitté lepays et qui, pour elle, a reçu un coup d'épée là (au coeur), et il s'enva en haussant les épaules.
C
OLOMBINE s'accroupit, atterrée, sur la tombe de P
IERROT ; elle demeurelà, quelques moments, immobile, muette, affaissée dans ses haillons.Est-elle donc si changée que le vieux fossoyeur ne l'ait pas reconnue ?
Musique joyeuse. Ce sont les filles et les gars du village quireviennent de la moisson et passent le long du mur du cimetière enchantant et en dansant presque. Les uns portant des gerbes, les autrescouronnées de coquelicots, de nielles, de bluets, ils apparaissentd'abord en buste dans la brèche, puis tout entiers derrière la grille.
C
OLOMBINE les entend, se soulève et se dirigeant vers le mur du fond,s'appuie contre la brèche. Elle les regarde tristement passer.
Les chants s'éteignent au loin. La campagne demeure vide.
C
OLOMBINE reste immobile à la même place. Aucun de ceux-là non plus nel'a reconnue !
Pendant qu'elle songe, les yeux perdus dans la campagne, C
ASSANDRE etsa femme sortent lentement de l'église. Ils sont vieux, cassés, tousles deux en grand deuil ; ils avancent péniblement. Bras dessus, brasdessous, s'appuyant chacun sur une canne, ils traversent lentement lecimetière.
C
OLOMBINE, la bouche grande ouverte et les mains jointes, les regardestupidement passer entre les tombes. Arrivée devant celle de P
IERROT,Mme C
ASSANDRE s'arrête et se baisse pour cueillir une fleur ; dans cemouvement, son livre de messe lui échappe et c'est C
ASSANDRE qui le luiramasse. Il la gronde cependant en brandissant sa canne. Mme C
ASSANDREporte alors son mouchoir à ses yeux, et le bonhomme s'excuse et laconsole ; lui-même écrase avec son doigt une grosse larme qu'il a dansl'oeil.
C
OLOMBINE, qui a suivi toute cette scène avec un regard d'angoisse,fait un crochet à travers les tombes et les suivant presque pas à pas,les dépasse enfin et vient, en rabattant sa mante sur sa tête, seposter devant eux, à la porte du cimetière, dans l'attitude d'unemendiante.
Arrivé devant elle, C
ASSANDRE, d'un geste machinal, retire quelquemonnaie de son gousset et lui fait l'aumône. Puis il passe. C
OLOMBINEreste seule.
Eux non plus ne l'ont pas reconnue !
C
OLOMBINE porte la main à son front avec un grand geste de désespoir,et, trébuchant à travers les tombes et les hautes herbes, vients'abattre à plat ventre sur la tombe de P
IERROT. On voit son doshaleter, secoué par les sanglots.
A ce moment, les deux Arlequins du premier tableau apparaissent sur lacrête du mur, tous deux masqués de noir, leur guitare en sautoir etdans l'attitude de leur première apparition : l'un, assis, les jambespendantes dans l'intérieur du cimetière, l'autre, à mi-corps sur uneéchelle, ils grattent, sur leur guitare, le motif de leur aubade...mais devenu singulièrement strident et moqueur.
A cette musique, C
OLOMBINE relève lentement la tête, comme folle, puis,se retournant, elle aperçoit les Arlequins. Elle se lève toute droite.Leur faisant face, le dos tourné au public, elle les regarde avecépouvante. Les Arlequins ôtent leurs masques et sous leurs bicornesricanent deux têtes grimaçantes. Ils disparaissent derrière le mur,avec de grands éclats de rire.
C
OLOMBINE, elle, est tombée à la renverse en poussant un grand cri.
RIDEAU
(A suivre.)
*
* *
L’ÉCOLE DE FÉCAMP (1)
René Crevel
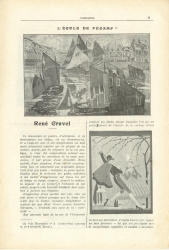 Ce descendant de potiers, d'architectes et de dessinateurs surétoffes, est un décorateur-né. Il a vingt-six ans et son tempéramentest déjà aussi fermement esquissé que la plupart de ses œuvres. Amené,par les exigences de la vie pratique, à créer des compositions suivantavec assiduité toutes les variations de la mode parisienne, il faitpreuve d'une fécondité, d'une facilité, d'une souplesse, d'une variétéexceptionnelles tout en conservant son originalité propre. Cela n'estpas facile ; toutefois, sa quasi spécialisation dans la recherche desgalbes mobiliers et des motifs d'impressions sur tissus lui fait detemps en temps exagérer, jusqu'à la raideur, la vigueur de sa factureet l'intensité de son coloris jusqu'à cette brutalité éclatante dontraffolent à présent nos élégantes. Exagération d'une qualité fort rare chez un vrai jeune et défautpassager que de longs tête-à-tête avec la Nature cauchoise tempérerontà souhait dès que René Crevel pourra travailler librement, — j'entendssans souci de la « matérielle ». Son amusant logis de la rue de l'Université contient des études devantlesquelles j'ai pu me porter garant de l'avenir de ce curieuxartiste en tant que décorateur. J'espère bien le voir signer un jourprochain — lui qui n'a pu signer tant de compositions exploitées etvantées « en exclusivité (2) » par le
Ce descendant de potiers, d'architectes et de dessinateurs surétoffes, est un décorateur-né. Il a vingt-six ans et son tempéramentest déjà aussi fermement esquissé que la plupart de ses œuvres. Amené,par les exigences de la vie pratique, à créer des compositions suivantavec assiduité toutes les variations de la mode parisienne, il faitpreuve d'une fécondité, d'une facilité, d'une souplesse, d'une variétéexceptionnelles tout en conservant son originalité propre. Cela n'estpas facile ; toutefois, sa quasi spécialisation dans la recherche desgalbes mobiliers et des motifs d'impressions sur tissus lui fait detemps en temps exagérer, jusqu'à la raideur, la vigueur de sa factureet l'intensité de son coloris jusqu'à cette brutalité éclatante dontraffolent à présent nos élégantes. Exagération d'une qualité fort rare chez un vrai jeune et défautpassager que de longs tête-à-tête avec la Nature cauchoise tempérerontà souhait dès que René Crevel pourra travailler librement, — j'entendssans souci de la « matérielle ». Son amusant logis de la rue de l'Université contient des études devantlesquelles j'ai pu me porter garant de l'avenir de ce curieuxartiste en tant que décorateur. J'espère bien le voir signer un jourprochain — lui qui n'a pu signer tant de compositions exploitées etvantées « en exclusivité (2) » par le Printemps
, les GaleriesLafayettes
ou Pygmalion
! — j'espère, dis-je, le voir signer un jourprochain, de belles affiches, des décors de théâtre et des meublesdisputés. Nous lui devrons des papiers peints à rendre jaloux les vieuxartisans de Rixheim, des images coloriées à désespérer Guy Arnoux, desameublements à affoler Iribe et André Groult, des illustrations à «épater » Carlègle et Delaw, des toiles peintes à éclipser les toiles deJouy d'antan, des reliures à stupéfier Marius Michel et André Mare etdes « intérieurs » à damner Poiret en personne... 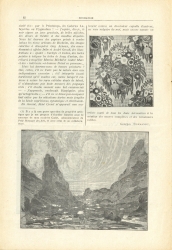 Mais lui devrons-nous de bonnes peintures ? Oui, certes, s'il ne traitepas la nature avec une indépendance excessive ; s'il interprète (aussihardiment qu'il voudra car, même lorsqu'il s'amuse à suivre les rarescubistes doués de talent, il n'abandonne pas toute mesure) des paysagesréels ; s'il étudie souvent sans but commercial
Mais lui devrons-nous de bonnes peintures ? Oui, certes, s'il ne traitepas la nature avec une indépendance excessive ; s'il interprète (aussihardiment qu'il voudra car, même lorsqu'il s'amuse à suivre les rarescubistes doués de talent, il n'abandonne pas toute mesure) des paysagesréels ; s'il étudie souvent sans but commercial — « J'apprends,confessait Harpignies plus qu'octogénaire » ; —
s'il ne se laisse pasaccaparer tout entier par les séductions dorées mais fragiles de laMode capricieuse, tyrannique et stérilisante.
En résumé, René Crevel m'apparaît non seulement comme un décorateurcapable d'arriver, au sens vulgaire du mot, mais encore comme unartiste nanti de tous les dons nécessaires à la création des œuvrescomplètes et des renommées solides. Georges NORMANDY.
(1)Voir Normandie n°2 (André-Paul LEROUX) et n°4 (Henri-E. BUREL).
(2) Il y a là une grave question de propriété artistique que je mepropose d'élucider bientôt avec le concours de mon confrère Cadot,administrateur du Petit Messager des Arts, et avec celui de sescollaborateurs. *
* *
Lorsque j'ai trop souffert, lorsque je me désole,
Je prends ton cher portrait pour lui parler tout bas.
Je sais bien, pauvre fou, qu'il ne répondra pas,
Mais ils parlent tes yeux ! et cela me console.
Pour mieux te regarder, du monde je m'isole :
Que ton sourire est doux, qu'ils sont doux tes appas !
Et de les contempler je ne suis jamais las,
O ma dernière amie, ô mon unique idole !
Pourtant je dois garder, tu me l'as dit souvent,
Mes plaintes pour moi seul : ma douleur t'importune
Ou te fait rire... Autant en emporte le vent !
Te voir, offrande en main, — dédaigner mes amours,
T'adorer sans espoir : telle est mon infortune...
Et ton portrait me raille en souriant toujours !
Vincent-Louis MARTIN
***
Crépuscule
Souvenir des marais de Carentan.
Le désert des joncs durs jusqu'aux coteaux lointains
Creuse mollement ses ondulations vertes.
Le marais est à sec, le bleu du ciel s'éteint,
Un brouillard monte épais des crevasses ouvertes...
C'est l'heure où naît le soir, où la fine dentelle
Des taillis élancés qui suivent l'horizon
Déchire le soleil, qui saigne et qui chancelle ;
L'heure où l'oiseau regagne sa frêle maison...
Rien ne respire plus... L'ombre approche sans rides
Le vent s'appesantit sur le brouillard ouaté...
C'est l'heure où les cieux clairs sont complètement vides
Et le marais s'endort dans son immensité...
Marcel FAUCHOIS.
***
L'Attente
Je m'accoude à ma vitre et reste sans bouger.
C'est le printemps. J'attends ma Muse, une hirondelle.
Trop épris pour oser me croire oublié d'elle.
Je tressaille et souris au son le plus léger.
Et, comme un pauvre amant que le soir fait songer,
Je soupire. Ce que je veux de l'infidèle,
Oh ! ce n'est pas un bruit de pas, mais un bruit d'aile ;
Aussi le monde est-il à ma peine étranger !
Pourtant, l'amant déçu, las de veiller sans trêve,
S'endort et voit deux yeux s'étoiler dans son rêve.
Du plus fervent amour le sommeil est vainqueur !
Mais moi, j'attends, ô Muse. Et quand, une par une
Chaque seconde bat au rythme de mon cœur,
J'ai l'air de chercher l'heure au cadran de la lune.
Paul VAUTIER.
***
Mauvais Passage (1)
Le sang des guerriers coule et se mêle aux fontaines :
La terre se détrempe en de rouges limons ;
Du creux de la vallée à la cime des monts,
La jeunesse agonise au choc des vieilles haines.
L'atmosphère trahit ; les mers sont inhumaines,
Et le ciel sert de lice aux tournois de démons.
Auprès de ces horreurs, qui serrent nos poumons,
Les neuf fléaux d'Egypte ont l'air d'infimes peines.
Nous paraissons descendre au fin fond de l'enfer,
Car sous nos pieds tremblants un abîme est ouvert
D'où monte, vénéneuse, une vapeur de soufre.
Et pour franchir le temps jusques à l'autre bord,
Nous allons sur la planche ondulante du sort,
Visé par le vertige aux aguets sur le gouffre.
Jean MIRVAL (Georges LEBAS).
(1) Ces poèmes font partie d'un recueil, intitulé
Eclats de Vers, quiparaîtra après la guerre.
*
* *
M. LIARD
Un Normand des plus éminents, M. Liard, vice-recteur de l'Académie deParis, vient de mourir à l'âge de 71 ans.
Originaire de Falaise, élève de l'Ecole Normale supérieure, agrégé dephilosophie et docteur ès lettres, il avait professé la philosophie àla Faculté de Bordeaux, en 1875, puis était devenu recteur à la Facultéde Caen. En 1884, il avait été appelé à remplir au ministère del'Instruction publique les fonctions de directeur de l'enseignementsupérieur et puis avait été nommé vice-recteur de l'Académie de Parisen 1902, en remplacement de M. Gréard.
Membre de l'Institut, grand'croix de la Légion d'honneur, M. Liard aécrit de nombreux ouvrages :
les Logiciens anglais contemporains,
laScience positive et la Métaphysique,
la Morale et l'Enseignement,
l’Enseignement supérieur en France,
Universités et Facultés, etc.
Très souffrant depuis quelque temps, il avait demandé sa mise à laretraite et devait être remplacé à la rentrée d'octobre, commevice-recteur de l'Académie de Paris, par M. Lucien Poincaré.
Le Conseil des Ministres a décidé qu'en raison des services rendus àl'Université et au pays, par M. Liard, ses obsèques auraient lieu auxfrais de l'Etat.
*
* *
La Réforme de l'Éducation nationale et le Régionalisme scolaire
Un ingénieur, M. Georges Hersent, dans un livre qui est appelé à fairesensation dans les milieux universitaires, trace pour l'après-guerre unplan de réforme de l'éducation nationale:
« La France de demain, dit-il, réclame impérieusement que chacun soitpréparé à une vie mieux en rapport avec ses facultés personnelles etsurtout avec sa destinée normale. Elle exige que l'éducation ne soitplus un plan purement idéal et uniforme, dont la poursuite ne mène àrien, tout en voulant mener à tout : mais qu'elle soit organisée en vuede faire des gens heureux dans leur situation, entraînés à laproduction intensive dont dépendra l'essor du pays. »
Et en homme d'action, M. Hersent ne s'est pas borné aux généralités ;tout de suite il a tracé un plan et fixé un programme de l'éducationmoderne telle qu'il la juge nécessaire pour l'après-guerre, en passantpar la culture physique, la formation du caractère, l'instruction,l'enseignement professionnel : élémentaire, moyen et supérieur, pourformer des contremaîtres, chefs de services, chefs de grandesentreprises, etc.
Au point de vue régionaliste, ce programme dit:
L'enseignement primaire doit être adapté aux divers milieuxéconomiques :
REGIONALISME SCOLAIRE.
Dans les campagnes les deux dernières années seraient remplacées pardes cours périodiques ou saisonniers.
Ce plan qui sera approuvé par tous les Français clairvoyants, réclame,en somme, un peu moins d'idéal et un peu plus de réalités, et il meparaît cadrer avec l'état d'esprit de ceux de nos poilus qui ontfréquenté les tranchées. Un officier, en effet, m'écrivait dernièrement:
« C'est que, voyez-vous, après 26 mois de tranchées, on doit savoir,pour peu qu'on ait observé et réfléchi, ce qu'il faudra à notre Francede demain : du Rêve, certes, et qui songerait à le nier, puisque c'estproprement le génie français, mais de l'action, de l'action immédiate. »
Je souhaite vivement que nos compatriotes, réfléchissant à ces paroles,n'attendent pas l'après-guerre pour les mettre en pratique, car cen'est que de l'énergie et de la coordination des efforts de tous quel'on peut attendre le développement de la prospérité régionale etnationale.
A. M.
*
* *
Les Régionalistes à la guerre.
Le capitaine Emile Lesueur vient d'être nommé chevalier de la Légiond'honneur à la suite de la citation que voici:
« Officier d'une haute valeur morale et d'un dévouement absolu. Bienque reconnu inapte à l'infanterie, a fait toute la campagne commecommandant de compagnie dans un régiment actif, jusqu'au 23 juin 1916,date à laquelle il a été blessé à Verdun. A demandé à être affecté à unétat-major sur le front, dans lequel il vient d'être à nouveau trèsgrièvement blessé, le 11 juillet 1917, au cours d'une reconnaissancesous un violent bombardement. Déjà cité à l'ordre. »
Le capitaine Emile Lesueur, (fils du chef de bataillon Benoni Lesueur,membre de l'Académie d'Arras, auteur d'une remarquable histoired'Etrun, fait prisonnier à Maubeuge et mort en captivité à Torgau) estl'avocat bien connu, le poète fort estimé de
Mais survint l'Amour...(Sansot éditeur) et le fondateur des
Rosati d'Artois, cetteflorissante société régionaliste qui organisa les fameuses fêtesd'Arras, Saint-Pol et Cambrai (1912-1913-1914) en l'honneur de PaulAdam, Sébastien, Charles Leconte et Auguste Dorchain.
Normandie offreses félicitations à ce régionaliste de marque et à cet héroïque soldat.
*
* *
Le Retour à la Terre
Le retour à la terre, qui a été traité à différentes reprises dans sesarticles, par notre collaborateur Henri Blin, est aussi l'objet despréoccupations de la Société des Agriculteurs de France. Elle pensequ'il faut retenir les cultivateurs à la terre, et en former denouveaux.
Le meilleur moyen d'y parvenir, croit-elle, est de placer les enfants,au moment où ils sortent de l'école primaire, dans un orphelinatagricole ou dans une ferme-école.
Leur préparation durant trois années, pendant lesquelles ils nerapportent rien, la Société des Agriculteurs de France vient de déciderla création, par voie de souscription, de bourses et de demi-bourses,d'une valeur de 500 francs par an.
*
* *
Notre collaborateur Paul Vautier, en ce moment au front, nous avaitannoncé un article :
Les Croix du champ de bataille de la Marne, quine nous est pas encore parvenu au moment de mettre sous presse. Nous lepublierons dans notre prochain numéro.
*
* *
Nouvelles Commerciales et Industrielles
— Les actionnaires des
Mines de Larchamp, dont le siège est à Flers(Orne), réunis en assemblée générale, ont voté l'augmentation ducapital à 5 millions de francs, par l'émission de 4.000 actions de 500francs. Cette augmentation est destinée à la reprise de l'exploitationet au remboursement d'avances.
— Le Conseil d'administration de la
Société Française des Mines defer (Calvados), a également décidé la reprise de l'exploitation ;pendant le premier semestre de 1917, il a été vendu 12.000 tonnes deminerai, alors que pendant toute l'année 1916, il n'en était sorti que1.000 tonnes.
—
La Compagnie Française des mines Powell-Duffryn, siège social, 24,quai Gaston-Boulet, à Rouen, va augmenter son capital de 5 millions à7.500.000 francs par la création de 5.000 nouvelles actions. Lapriorité de souscription est réservée aux anciens actionnaires.
—
Les Etablissements Tricoche, fonderie de suif, à Rouen, viennentd'être achetés par la
Société d'alimentation d'Aubervilliers.
*
* *
NOS PORTS
LE HAVRE
La Chambre de commerce du Havre est autorisée, par décret du 6 août, àemprunter 1.017.434 francs pour faire face aux améliorations suivantesdu port : Construction d'un appontement à l'extrémité est du grand quai.
Amélioration du bassin-dock. Etablissement d'une voiecharretière sur la partie est de l'écluse de Vetillart. Acquisition desterrains.
CAEN
La Chambre de Commerce a adressé au ministère des Travaux publics unedemande d'emprunt de deux millions destinés aux premiers travauxd'élargissement et d'approfondissement du canal de Caen à la mer. Degrands travaux vont en effet être entrepris pour rendre le portaccessible aux navires de 4.000 tonnes. Le devis s'élève à 20 millionsde travaux. Le canal qui a actuellement un tirant d'eau de 6 m 12, enaura 7 mètres et une largeur de 21 mètres au plafond au lieu de 10 m.qu'il a actuellement.
CHERBOURG
La nouvelle jetée du Homet est maintenant en pleine exploitation ; elleoffre aux navires six ports d'accostage de 125 mètres de long chacun.Des voies ferrées la desservent, on y compte 11 grues à vapeur à benneautomatique de 3 tonnes de puissance à 14 mètres de portée.
Le déchargement simultané de 3 à 4 navires est actuellement exécutédans de bonnes conditions. (Le nombre de grues prévues pour l'ensembledes postes est de 18 ; quand ces grues auront été livrées, 6 navirespourront être déchargés simultanément dans de bonnes conditions.)
L'établissement maritime de Homet est en principe réservé aux naviresportant des marchandises pondéreuses en vrac (combustibles minéraux),accessoirement aux navires porteurs d'aciers ou métaux lourds ; ladisposition des lieux ne permet que les déchargements directs debateaux en wagons découverts. Mais un stockage situé à 2 kil. 500environ de la jetée, et desservi par wagons de brouettage, peutrecevoir les marchandises pondéreuses en provenance des navires et enattente.
Deux remorqueurs, l'un de 1.200 chevaux, l'autre de 500, sont affectésaux manœuvres d'accostage et de départ du navire ; ces opérationss'exécuteront donc dans des conditions de sécurité aussi complètes quepossible. L'ensemble des manutentions et des transports à exécuter dansl'Etablissement du Homet c'est-à-dire depuis la jetée jusqu'àEqueserdreville) sera assuré par une entreprise unique, composée de MM.Jules Cavroy, Y. et G. Hersent, et à la Société commercialed'affrètements et de commission.
__________
—
Les Régions Economiques. — Le projet de division de la France enrégions économiques ayant été soumis pour avis à la Chambre de commercede Caen par le ministère du commerce et de l'industrie, l'assemblée adécidé de demander que la Basse-Normandie ne soit pas englobée dans la2e région, dont le siège a été primitivement fixé à Rouen, et qu'elleforme, en égard à l'importance du port de Caen, auquel le plus grandavenir est réservé, ainsi qu'aux richesses minières et au développementindustriel de la région, une division autonome comprenant lesdépartements du Calvados, de l'Orne et de la Manche, dont le siègeserait Caen.
—
Mines de houille du Plessis. — Par décret du 1er août 1917, estautorisée la cession de la concession de mines de Houille du Plessis,consentie au nom de l'Etat à la Société Civile de Recherches deBasse-Normandie, sans que cette autorisation implique aucuneapprobation des conditions financières de la cession ou préjuge de lavaleur de la mine.
—
Mines de fer de Barbery (Calvados). — Par décret en date du 28juillet est rejetée la demande de la société des mines de fer deBarbery en extension de la concession des mines de fer du même nom, surle territoire des communes de Barbery, Saint-Germain-le-Vasson ;Fontaine-le-Pin et Grainville-Langannerie.
—
Nouvelle Société à Rouen pour la fabrication de tissus. — Unesociété en nom collectif a été constituée au capital de 800.000 francset pour une durée de 10 années, avec siège, à Rouen, 34-36, rueSaint-André, sous la raison sociale :
André Laîné, Bignolais et Cie.Cette société a pour objet la fabrication de tissus.
— La Société anonyme
Union Normande, quai du Havre, 21, àRouen, vient d'augmenter son capital de 1.700.000 francs à 2.f25.000fr. suivant acte du 22 juin 1917, déposé à l'étude de Me Gaston Gence,notaire à Rouen.
— Une Société en commandite simple,
Van Linden et Cie, vient de seformer à Rouen, 5, rue Moiteuse, avec pour objet le
Commerced'approvisionnement de navires à Rouen, et tout commerce accessoire.Capital, 50.000 francs. Durée, 5 ans.
*
* *
Le Palmarès Normand
DUVAL, J
OSEPH-M
ARIE, marin, de Fécamp :
« Lors du torpillage du « Mont-Viso », s'est fait remarquer par sonénergie et son dévouement dans les opérations de sauvetage de cebâtiment. » M. Duval est actuellement second maître de manœuvre à borddu chalutier Normandie.
DESBAINS, pharmacien auxiliaire :
« Pharmacien auxiliaire, très dévoué et courageux, acceptant gaiementles missions périlleuses. S'est particulièrement distingué lors desattaques du 16 au 23 avril 1917 en assurant la liaison avec un P. S.régimentaire et en dirigeant les évacuations dans une région violemmentbombardée. » M. Debains est pharmacien rue du Général-Faidherbe, auHavre.
PREVOST F
RANÇOIS-A
RMAND, sergent au 74e d'infanterie :
« Sous-officier de grande valeur. Au front depuis le début de lacampagne. S'est distingué en maintes circonstances par son courage etson sang-froid, et notamment le 5 avril 1916, en se portant dans unélan superbe à l'assaut des tranchées ennemies, a été très grièvementblessé au cours de cette action. » M. Prévost, dont c'est la troisièmecitation, était directeur d'assurances à Rouen, 43, rue de laRépublique.
LABRO, H
IPPOLYTE-F
ERNAND, lieutenant au 23e régiment d'artilleriecoloniale, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur :
« Officier d'une bravoure et d'un dévouement remarquables. Déjà blesséau début de la campagne, l'a été de nouveau très grièvement le 16 avril1917, en accomplissant une mission périlleuse. Déjà cité à l'ordre. »Pour prendre rang du 27 avril 1917). La présente nomination comportel'attribution de la croix de guerre avec palme. » Ancien élève del'Ecole communale de Maromme, de l'Ecole supérieure de Rouen et desBeaux-Arts de Rouen, M. Labro est le gendre de M. Bennelli, chimiste,aux Etablissements de Thaon, à Notre-Dame-de Dondeville.
DUVAL, R
AYMOND, sergent au 329e d'infanterie :
« Sous-officier d'une très grande bravoure et d'un sang-froidexemplaires, volontaire pour toutes les missions périlleuses, a étéblessé en se portant, à la tête de sa demi-section, à l'assaut d'unetranchée ennemie fortement organisée et armée de mitrailleuses. » M.Duval était un des plus brillants équipiers de l'équipe foot-ballassociation du Havre-Sports.
AVENEL, E
UGÈNE, de la compagnie de mitrailleuses du 329e d'infanterie :
« Bon soldat mitrailleur, a fait preuve de beaucoup de courage et desang-froid en servant sa pièce sous les feux les plus violentsd'artillerie et de mitrailleuses. » M. Avenel est le propriétaire ducafé Thiers, au Havre.
ULLERN, C
ARL, capitaine, directeur d'une école de grenadiers d'armée :
« Après s'être fait remarquer dans la troupe par son courage et sonactivité, commande depuis plus d'un an une école de grenadiers d'armée: à ce titre, a organisé plusieurs opérations difficiles. Le 24 avril,a pris la direction d'un combat acharné contre un adversaire trèssupérieur en nombre et après quatre heures d'efforts a conquis de hautelutte un point d'appui important. » M. Ullern est de Honfleur.
____________________
Le Gérant : MIOLLAIS.
_________________________________________________________
IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur.