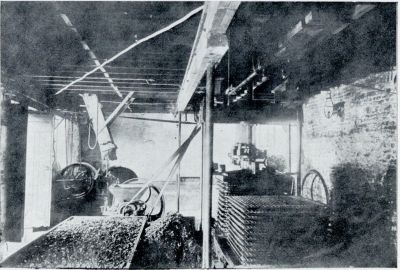Corps
| LESQUIER, Jean(1879-1921) : Le Cidre de Normandie(1913). Saisie du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (27.I.2015) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographeetgraphieconservées. Texteétabli sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm31bis) de la Revue illustrée du Calvados,7ème ANNÉE / N°4 - Avril 1913. Le Cidre de Normandie par Jean Lesquier ~*~Si nous en croyons Victor Hugo, onvoyait ciselés sur le bouclier du preux Olivier : la guerre de Bacchuscontre les Normands, Rollon ivre, sauf votre respect, Rouen consterné, Et le dieu souriant, par des tigres traîné, Chassant, buveur de vin,tous ces buveurs de cidre. C'est une antithèse dont bien peu de gens aujourd'hui songeraient àsuspecter l'exactitude. Elle eût fort surpris Rollon cependant et mêmeles Français du XVe siècle encore, s'il est vrai qu'au siège dePontoise les soldats de Charles VII brocardaient les troupes de ladéfense en criant : Entre vous. Anglais et Normands, ....retournez à la cervoise De quoi vous êtes tous nourris. Il le faut bien avouer : nous avons été d'abord des buveurs decervoise, non pas de bière. La cervoise est sans doute une bière, maissupérieure : on y employait plus de gru, ou de braise, comme disaientnos pères, c'est-à-dire plus de blé. Par contre elle n'était peut êtrepas aussi savoureuse : certains érudits doutent qu'on y ait ajouté duhoublon ; on n'ose pas supposer que des érudits ignorent l'existence deLa Houblonnière, auprès Lisieux, et, recherches faites, LéopoldDelisle, qui savait tout et de qui les autres ont tant appris, laconnaissait ; ce que ces savants hommes ont entendu dire, c'est que lacervoise ne peut avoir saveur de bière avant que cette Houblonnière nefût plantée ; et au demeurant c'est peu qu'elle seule pour toute laNormandie. Tant y a qu'agréable ou non, les Normands de jadis ne boudaient pasdevant la cervoise. Ce n'est pas tout. On hésite à le répéter : Selon d'aucuns, notrepommier normand serait un horsain venu du pays basque ; et ce n'est paslà une tradition de fraîche date, avec laquelle il soit permis deprendre des libertés. L'abbé Roziet, qui écrivait au XVIIIe siècle, etqui était bien de son temps, puisqu'à son cours d'agriculture iljoignait « une méthode pour apprendre l'agriculture par principe », necroyait pas que le pommier eut été planté en Normandie avant le XIVesiècle ; il y serait venu dans les bagages des rois de Navarre, comtesd'Evreux ; à telles enseignes que dans plusieurs coins de notreprovince le pommier à cidre porte le nom de biscait, où l'on retrouvesans peine celui de la Biscaye. Et dès la fin du XVIe siècle, laquestion pendait déjà au croc sous le juge, comme dit l'autre : lemédecin Jacques de Cahaignes se déclarait incapable « de composer ledifférend entre les Normands et les Biscains pour la premièrepossession ; de quoi toutefois jamais homme, que je sache, n'a laisséaucune chose par écrit » ; nous n'avons pas là l'opinion suspecte d'unhomme qui fait place au cidre, dans ses régimes d'abstention, ces motssont tirés de son apologie du cidre. Voilà des autorités auxquelles ondevrait accorder créance en tout état de cause, mais leur témoignagene laisse pas d'être confirmé par le fait qu'on expédia. longtemps ducidre de Bayonne à Rouen. Le pommier serait-il donc basque ? C'est une pensée que ne peut uninstant soutenir un coeur vraiment normand ; hâtons-nous de rassurer,sinon de pleinement satisfaire, le patriotisme provincial. Plus heureuxque le bon Jacques de Cahaignes, nous pouvons composer le différend, enrenvoyant les parties dos à-dos ; les hommes ont laissé plus de chosespar écrit qu'il ne le soupçonnait, et bien interrogés les textes ontrépondu que le pommier était français. A Jove principium, commençonspar la Loi salique : elle parle de plants de pommiers et de poiriers.Les gens de Charlemagne brassaient le cidre et le poiré dans sesdomaines. Le pommier sauvage croissait dans nos forêts et le duc Richard y trouva,dit-on, la variété qui porte son nom ; les usagers avaient le droitd'en cueillir les fruits, comme ceux du poirier ; l'abbaye deSaint-Ouen de Rouen touchait des redevances de pommes des bois. Dans lenom du village d'Auppegard, près de Dieppe, on retrouve la formeanglaise Applegard (en) « verger de pommes », et ceci supposel'habitude de replanter des entes prises dans les forêts, à une époqueoù le vocabulaire germanique ou scandinave était encore en usage enNormandie. Voilà pour l'arbre. Et quant au cidre, il est aussi indigène que lepommier ; si les vilains ramassaient les pommes sauvages des forêts,c'était pour les brasser ; on en a entre autres preuves un passage d'uninventaire de l'aumônerie de Saint-Ouen de Rouen, et ce latin est assezculinaire, ma foi, pour qu'on le cite sans vergogne : Item, unus parvusbarillus plenus viridi succo (verjus) pomorum de bosco. Ce cidre nedevait pas valoir grand'chose : les vies de Saints du moyen âge voientdans son usage (que les temps sont changés !) une grande marqued'austérité et un exemple édifiant de mortification ; si tel étaitcelui qu'on offrit au poète Raoul Tortaire lors de son passage àBayeux, il est excusable de s'être cru empoisonné, sinon de nousl'avoir dit en de méchants vers ; et l'on comprend que, tout indigènequ'il fût, le cidre n'ait été d'abord que peu répandu en Normandie. C'est une conquête dont on parle trop peu que celle de notre provincepar le cidre : conquête tardive, lente, difficile, pacifique etbienfaisante. Au XIe siècle encore, Lisieux, Lisieux même, qui s'estrattrapé depuis, faisait platement infuser de l'avoine dans l'eauchaude ; c'est l'angevin Baudry de Bourgueil, bien étonné (vousconnaissez le dicton), qui nous l'apprend en vers latins, s'il vousplaît : Lisoïs. ... nescia vini. Cocdas potat aquas et aquis immiscet avens. Mais le XIIe siècle, le grand siècle, estl'époque des progrès décisifs du cidre ; vers 1100, date mémorable denotre histoire, la dîme en est déjà payée à Basseneville-en-Auge ; etquelque cent ans plus tard, il figure, consécration officielle, autarif des prévôtés de Caen et de Pont-Audemer. Le pays d'Auge était dès lors la terre d'élection du pommier ; le cidrea beaucoup inspiré les poètes et Guillaume le Breton célèbre « l'Augeque rougissent à l'automne les pommes dont la Neustrie sait tirer uncidre agréable »,« l'Auge buveuse de cidre moussseux, siceraequetumentis Algia potatrix ». Tout de même, Saint-Louis interdisait defaire de la cervoise en Normandie en temps de disette, à cause de lacherté du blé ; et un siècle après, il se vendait encore à Caen, en uneannée, pour près de 33.185 livres de vin et 5390 livres de cidreseulement. Si le Roumois était déjà gagné, les pays au Nord de laSeine résistaient ; il ne fallut pas moins que le recouvrement de laNormandie par Charles VII et la restauration générale qui le suivit,pour que le pommier et le cidre franchissent vraiment le fleuve ;toutes les mentions de l'arbre ou de la boisson antérieures à la findu XVe siècle sont exceptionnelles ; ce n'est que vers 1550 que lecidre devient d'un usage commun à Rouen et dans les campagnes, et en1589 notre médecin, Jacques de Cahaignes, peut écrire : « Il n'a pascinquante ans qu'à Rouen et en tout le pays de Caux la bière était leboire commun du peuple, comme est de présent le cidre ». Il n'a pasfallu moins de cinq siècles pour que le cidre se rendit maître de sonfief normand tout entier, mais aussi qu'il le tient bien ! Et quepenserait Raoul Tortaire s'il revenait en ce bas monde ? — RaoulTortaire, s'il revenait, ferait partie de La Pomme et chanterait comme Robert Planquette.. Jean LESQUIER. |