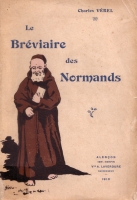~*~
A Monsieur Auguste LOUTREUIL
Industriel à Moscou
L’un desPrésidents d’honneur
de la Sociétéd’Agriculture de l’Orne
Hommagerespectueux,
CH. VÉREL.
Nonant-le-Pin, décembre 1909.
Préface
___
A l’époque lointaine où j’étais parisien, je fus arrêté un jour parune toute petite brochure aperçue à l’étalage d’un libraire. Elles’intitulait : Rimes percheronnes.
Ma joie fut grande d’abord dedécouvrir, au milieu de l’exil de Paris, ces vers écrits dans le parlerque j’avais entendu pendant mon enfance et une partie de ma jeunesse.Mais je fus vite déçu. Je parcourus ces poésies, et je ne les entendispoint : le sanscrit m’était à peu près aussi familier. Je me suis rappelé cet incident en lisant les Contes de ma Voisine
etles Scènes Normandes,
de Charles Vérel, récits que j’ai suivis leplus aisément du monde, encore que le parler des environs d’Alençon mesoit un peu moins connu que celui des environs de Mortagne. Levocabulaire, il est vrai, ne se modifie pas bien profondément à sept ouhuit lieues de distance, parmi une population volontiers voyageuse etqu’un négoce actif mêle par une pénétration réciproque. Mais, d’oùvient que le poète avait été inintelligible, tandis que le conteur estlu à peu près couramment par le premier venu, ainsi que j’en ai faitl’expérience sur des lecteurs qui n’ont jamais mis le pied en Normandie? C’est que le poète avait fait une œuvre qui n’était qu’érudition,tandis que le conteur a mis dans la sienne le mouvement et la vie. Pourécrire en un certain patois, il ne suffit pas d’en avoir appris lagrammaire et le vocabulaire et de les appliquer scrupuleusement à untravail littéraire. L’érudit qui procède de la sorte traduit tous lestermes du français correct par tous les termes spéciaux qui ont le mêmesens. Et, comme il y a peu de mots vulgaires ou d’idées courantes quin’aient, en patois, leur expression, le simple érudit ne produit, aumoyen d’éléments vrais, que des œuvres sans vérité. Notre poète avaitoublié un point : c’est que dans le Perche, et généralement dansl’Orne, surtout dans les arrondissements d’Alençon, le langage n’estpas composé exclusivement de patois, mais d’un mélange d’expressionsfrançaises et d’expressions de terroir, où le français figure pour laplus grande part. Le paysan de l’Orne n’est pas illettré : aussi a-t-ilpour chaque idée deux mots à sa disposition, le mot littéraire et lemot populaire ; et il emploie l’un ou l’autre, tantôt suivantl’instinct ou l’humeur du moment, tantôt pour se faire mieux entendrede son interlocuteur, parfois aussi, assurent de méchantes langues,pour être mal compris. Mais, si l’on néglige la prononciation, qui estvicieuse ou, plus exactement, incorrecte, c’est le français moderne quidomine et reste, à peu près, la langue de cette contrée. On pourraitcomparer les termes de patois qui s’y introduisent aux bleuets étoilantun champ de blé. Les bleuets y sont nombreux, mais pas au point del’empêcher d’être un champ de blé. Aussi M. Vérel, qui est du pays,s’est-il contenté de semer ses récits, dans la dose modérée qu’ilconnaît, de locutions de patois, locutions qui sont les fleurs agrestesdu langage. Le conteur qui veut écrire en patois entreprend une tâche plus malaiséeque celui qui écrit en français. Celui-ci, exprimant sa penséepersonnelle, y met son âme telle qu’elle est, l’esprit dont il estdoué, l’éducation de fond et de forme qu’il a acquise. Il n’a point àsortir de lui-même. Mais celui-là, lorsque son éducation l’a misau-dessus de la culture ambiante, doit se faire pour la circonstanceune âme pareille à celle des paysans qu’il fait agir et parler ; il luifaut revêtir leur humeur, s’assimiler leur tournure d’esprit. Or, nullescience et nulle faculté d’assimilation ne sauraient improviser cela.Il faut, pendant de longues années, avoir habité parmi les paysans,participé à leur vie, les avoir suivis dans leurs travaux, s’être faitle témoin de leurs actes, louables ou non, pour apprécier leur nature,bonne ou mauvaise, connaître leur véritable physionomie et mettre surleurs lèvres les discours qui les peignent en traits d’une parfaiteexactitude. De longues années même y pourraient-elles suffire ?Pouvons-nous à notre gré nous faire une âme à l’image de celles parmilesquelles nous avons été transplantés, même depuis longtemps, parnotre volonté ou par le caprice des circonstances ? Pénétrer ces âmes,cela se peut faire si l’on est doué de l’esprit d’observation ;s’assimiler à elles paraît une transposition impossible. Un compatriote seul est donc capable de penser et de parler, sans riend’artificiel, comme ses compatriotes. Tel est le mérite des scènes etdes récits ornais de Charles Vérel. L’auteur est né dansl’arrondissement d’Alençon ; il y a presque constamment vécu. Normand,et non des moins déliés, admirablement renseigné sur la langue et lesusages à dix lieues autour de son clocher, il a, de naissance plusencore que d’éducation, tout ce qu’il faut pour écrire ces contes,auxquels il pourrait donner ce titre collectif : Les Habitants del’Orne peints par eux-mêmes.
A un ou deux récits dont le fond estlégendaire, mais qu’il a illustrés de cette gaîté narquoise qui est lecaractère de l’esprit normand, Charles Vérel en a ajouté d’autres deson invention, joignant ainsi à la malicieuse bonhomie de ces histoiressa propre malice, qui ne détonne pas, puisqu’il est normand.D’ailleurs, il n’est tributaire de personne pour les Scènes normandes,
charpentées par lui de toutes pièces, et fort ingénieusement. Mais ony retrouve la même bonne humeur, la même naïveté de langage, avec unemalice égale, mais qui s’affine ici de qualités remarquablesd’observation comique et satirique. Exprimons le vœu qu’il se révèle, dans chaque région de notreNormandie, un esprit curieux et fin qui, à l’exemple de l’auteur desContes de ma Voisine,
ait la pensée de fixer dans des livres cesparlers pittoresques : ils ne sont rien de moins, en général, que lesreliques de notre vieille langue, reliques que l’enseignement,aujourd’hui généralisé, du français moderne, aura fait disparaître dansun temps peu éloigné.
Stanislas MILLET
Professeurhonoraire du Lycée de Lorient.
~*~
Les Contes de ma Voisine
I
LE CURÉ CONSTITUTIONNEL
A LouisDuval.
Y avait eune fouais, dan eune commeune des environs d’Courtomer, uncuré qu’les gens héyissaient pasqu’il avait été nommé par lesRévolutionneîres pour prenne la place d’un vieux curé qu’était partivêquir bin loin, bin loin, dans des pays, ousqu’en mettait pus d’un anpour aller-et-d’véni, et éioù qu’i mourit d’miseîre... Qué l’bon Guieuait son âme à ç’pauvre cher homme !...
Quand l’faux curé s’apercieuvit qu’en l’hubissait d’tous côtés, qu’endisait partout qu’i n’avait point l’drait d’dire la messe, i s’plaignitau comité révolutionneîre, ousqué y avait des gâs qui, bin sûr,n’étaient poin-en-tout c’modes. I li donnîtent souvent reîson, etm’nîtent eune venue d’hommes à la prison d’Alencon, qui pourtantn’était point à chomme dé monde, à c’qué j’ai ouï conter.
Çà qu’allit bin comme çà quioque temps ; mée v’la-t-i pas qu’un tourl’curé dénonçit un godivellier, qui n’v’lait point v’ni à ses offices!... Ah bin ! el comité n’en fit ni eune ni deusse, i happitl’malhûreux gâs dans son lit et l’conduisit en prison, malgré les crisd’sa pauve bourgeouêse, qu’était en train d’bin fêire, et qui n’allaitpus aver personne pour nourri ses six p’tits t’éfants.
A mais qu’les gens sûtent d’en par éioù qu’i n’n’était, i chongîtent àfeîre parti l’faux curé en li jouant des tours et en li feîsantd’villaines crasses. I n’savaient, en vérigousse, quai s’inventionnerpour l’éluger : i li disaient des reîsons quand i l’joignaient entréquate z’yeux, i chantelusaient des chansons sus li en pâssant à rase désa porte, pendant qu’les éfants d’chœu, véyant bin qué l’bon Guieun’était pus là, feîsaient la couplette dans l’mitan d’l’église,jouaient à guignettes dans les confessionnals, s’mettaient à caliberdasus la cheîre et j’taient des piâcrées d’poix sus la selle ousquél’curé s’assisait, si bin qu’un tour i s’démouletit quasiment l’génouquand i v’lit s’erléver.
*
* *
Quioque temps apréé, l’faux curé v’lit feîre l’catéchime ès èfants, méei z’étaient si endemnés, si malgestés, qu’i n’sut jamée leus apprenneeune seule leçon, bin qu’i z’eut menacé leux gens d’les renderesponsabes de leus conduite. Mée, ça n’servait à rin d’rin, et chaquefouais qué l’curé v’lait s’flonner, les maigniers n’manquaient pasd’l’atticocher en criant : Kss ! Kss !... Ç’qui li feîsait bin deu,comme dé juste.
A la fin des fins, quand i vit qu’i n’savait v’ni à bout d’toutes cesquenâilles, il essayit d’les aniqueter :
- V’nez quant et mai dans l’chœu, qui leus y dit comme ça, j’vas vousmontrer queuqu’affeîre.
V’là les gâs partis en feîsant un grand câbris ové leux bourbettes, eten rûchant des birons et des canettes ava l’église. Alors l’curé leusmontrit deux magnieîres d’estatues taillées dans l’mur et qu’lesguerdins d’Révolutionnêires n’avaient point su décrucher :
- Véyez-mon ces deux saints qui sont en face l’un d’l’aute (qui leus ydit comme ça). Çtilà qu’est amont la murâille, à draite, lève les mainset lé z’yeux au ciel, pendant qu’l’aute étale les bras et regarde parterre. Eh bin, ceûtes-là qui m’diront, d’anuit en huit, c’qué ces deuxsaints s’enteracontent, je leus y donnerai des cornuyaux et dé d’quaid’bon à manger.
Ça dit, l’curé les renvéyit sez ieux et s’n’allit au preubytêire ens’disant bontivement :
- J’ai réussi à l’z’apîper, et c’est bin hâsa si, en feîsant caôser lessaints, jé n’trouve pas l’moilien d’donner eune bonne leçon d’catéchimeès éfants sans qu’i s’en aperçieuvent.
*
* *
Vlà don les maigniers bien embarrassés et qui houêlent la question danstoute la commeune, mée personne en tout n’sut la d’vigner. Pourtantl’peîre Teiller, du village dé la Gravelle, dont qué l’freîre était enprison pa la faute du faux curé, s’mit à ruminer pendant trâs jousd’affilée, saôtit tout d’un coup et dit à son p’tit gâs la réponse à lad’vinade.
L’jeudi d’aprée, les maigniers avolîtent tertous au catéchime et l’fauxcuré arrivit, sieuvi d’sa domestique, qui portait eune pleine géronnéed’cornuyaux et un p’tit pagnier bien plombant.
Aprée aver chanté quioques cantiques, l’curé d’mandit lesqueulxqu’avaient trouvé ç’qué les deux saints s’disaient.
L’p’tit gâs au Teiller s’lévit sans s’émoïller et i li réponnit enl’ergardant un brin d’bicoin :
- J’sais bin ç’qui dîsent, mai, mée jé n’vas vous l’conter qué si jém’promettez dé n’point vous fâcher.
- Ouai, qu’i li réponnit un brin blard.
- Eh bin, qu’dit l’petit gâs, v’là l’affeîre : l’saint, qui lève lesmains et lé z’yeux au ciel, dit comme çà à l’aute qu’est en face dé li: « Hélâ ! qu’j’avons don un curé qu’est beîte !... ». L’aute li réponden étalant les bras d’un air fourgonné : « Dé quai don qu’tu veuxqu’j’y fasse ! »
Quanté l’euré ouït ça, i rabattit ses chapes et remançait si fo qu’ilen baubait. Il en était, en bonne vérité, déconnaissabe. Aussi quandl’gâs au Tellier vit qu’i v’nait pou li remuer l’câsaquin, i s’ensauvitdans l’çumequeîre, et l’z’autes éfants s’jétant sus la servante, lisourniguîtent ses cornuyaux, li nettîtent son pagnier et décanillîtentvitement dé d’dans l’église.
Le curé s’dépêchit d’aller au Comité pour sé plaindre du peîre Tellier,mée les Révolutionneîres, véyant qu’i n’en finissait point d’les érucerd’ses raprônages, l’renvéyîtent d’éioù qu’i v’nait. Et ça fut bonemplié !...
Quanté l’faux curé vit ça, i r’tournit au preubyteîre, chergit sonbassic et ses bâclages sus eune banne, et partit durant la nuit.
Dedpis, jamée, au grand jamée, en n’ouït parler d’li.
II
L’ABBÉ MARTIN
A Léon Berthaut.
Y avait eune fouais, dan un grand sumineîre, un abbé tout plain farce,qu’en appelait Martin d’son nom : i n’savait quai s’inventionner pourjouer des tours ès maîtes qui n’li piaîsaient point. Anuy, i mettaitdes souris-chaudes dans la poche du Supérieur : un aute coup, i j’taitdu poive dans la touine du curé qui montrait à feîre lé prône, sitellement qué l’pauve homme en trustait à s’dépendre la courée ; et untas d’autes gnoles. Comme dé juste, en n’pouvait saver, au grand jamée,dé qui qui manigançait tous ces affuts-là.
L’abbé Martin était itout à plein saffre, un vrai faimvallier : ilaigrippait dans les jerdins du sumineîre du raisin, des guignes, desgadelles, des groiselles et un guiâbe d’affeîres raides-bonnes àmanger. Malgré çà, pourtant, i n’pouvait point s’erteni dé r’garderd’bicoin, d’la feneîte dé sa chambe qui donnait sus eune méchantevénelle, des peîches manifiques qui venaient tous l’z ans amont l’gabed’la meîson d’un voisin. Mée son honnesté li défendait d’y biter, ç’quil’feîsait bin dauner, li qu’en était d’eune grand’vie.
- Il est permis à un curé d’eîte allouvi, qu’i disait comme ça, mée in’a point l’dreit d’eîte voleus... Faudra tout d’meîme qué j’trouve elmoyen d’aver des peîches aussi gouléyantes.
*
* *
Ça n’manquit point. Un jou d’sortie, il allit vais Louison, eunemeînageîre dé son pays, qui vendait au regrat dans la ville et qu’avaitmeîme, à c’qu’en dit, eune boutique bin accoursée.
I li dit comme çà :
- V’lous veni tras fouais par semaigne, à dix heu du soi, sous mafeneîte qui donne dans la venelle, et apporter quant et vous despeîches mûres et poin-en-tou godies ?... J’n’airiez qu’à miander amontl’mur et j’dévallerais, ovec eune ficelle, eune magnieîre dé pagnieréioù qué j’mettériez les frits... J’vous payerais tous les mouais à lasortie.
La bonne femme, qui n’était point bégaude, li tapit dans la main, etréponnit qu’ou li donnerait eune peîche d’achet par douzaigne.Là-d’ssus, i prîtent ensemble un p’tit dégout d’foutinette, histoueîredé s’ravigotter.
*
* *
Çà n’manquit point !... Deux jous après, à dix heu, bin qué l’iauversait à-pigra, la meînageîre rouaudait si bin dans la venelle qu’onaurait dit, pour le certain, qu’c’était un vrai marcaud. L’abbé Martinouvrit sa feneîte, en s’guettant d’feîre du brit, descendit l’pagnieret lé r’montit quand y sentit dé d’quai d’dans.
Çà marchit bin comme çà eune bonne pause, mais v’là-t-i pas qu’un tour,eune prâe, eune villaine traîgnée comme i n’en chomme point dans lesvilles, sieuvit la bonne femme et qu’ou vit dé ç’qui n’n’était !... Ous’mit à riocher et dit à son à-part :
- V’là un curé qu’eîme bin les pêches, j’y en apporterai eune géronnéela semaigne qui vient !...
*
* *
Çà n’manquit point !... Quioques jous aprée, il arrivit dans la venelleeune vieuille quiâpine hourdée, qui marchait ovec eune crignoche, etqu’avait lé z’yeux comme el z’éfants qui s’amusent à faire pieurer labonne Vierge. Ou s’mit à miander l’mieux qu’é pouvait, la sâdo !...L’abbé Martin dévallit vitement son pagnier, et l’rattirit, pendantqu’la bîlande s’ensauvait en hoûtant comme eune fersâs.
- Sarché noble gueux ! (qu’disait l’abbé, qui papait déjà dû), c’estbin b’sant à soi ! J’ai, en véricotte, peux qu’la corde n’s’en câsseristibilli... J’vas jamée pouver manger tout ç’té nuit.
Oui mée, quand il ergardit c’qu’était dans l’pagnier, i s’mit àguerdiner et lé z’yeux li béluettîtent si fo qu’i manquitd’s’événoui... M’z amis, i vit, embobeliné dans d’méchantes chiffestrésalées, un p’tit gâs d’deux jous qui dormait !... Ah ! i n’avaitpoint l’air résoud, l’innocent, ové sa pau p’tite teîte afillotie !...
- Nom dé d’là ! (qu’dit l’abbé en pognassant l’éfant ové ses grossespoques), c’est i pas daunant !... J’sais bin en soin d’saver d’quai quéj’vas feire dé ç’maignier là ! Hureusement qu’en a core iu la d’vignéed’mette dans l’pagnier un biberon et eune douzaine dé suçons : en avaitquioque doutance qué les nourrices sont bin râles dans lessumineîres... Mée, mon Guieu, queu scandale ! L’Supérieur va m’dire desreîsons et l’Evêque va bin sûr s’en guermanter. J’sais bin fourbi...j’nai pus qu’à mette el fouet sous l’auge.
Tout d’meîme, comme i pouvait à peigne s’téni susbout, i s’mit à genouxet fit d’grandes prieîres à tous les saints qu’i conneîssait dansl’Paradis pour qu’i l’îdent à s’tirer dé d’là. Et aprée aver bin prié,i li vint eune idée tout-à-fait bonne : i défraquetit l’éfant dé d’dansl’pagnier et allit tout uniment l’mette à la porte de l’écolome.
- Ça t’apprendra, vieux nagre, (qu’i dit comme ça), à nous feîre mangerdes pouais et des patates toute l’année !
Pis, comme i s’en r’vénait sez li, i ouït co miander sous sa feneîte :
- C’est-i un deuxieîme maignier qu’i m’rarrive ? (qui dit comme ça d’ungrand sens). J’vas l’sacquer dé c’té fouais... Véyons... Dé qui qu’estlà ? (qu’i dit).
- La meîre Louison, qu’en li réponnit.
I descendit l’pagnier, l’é r’montit, prit les peîches, les prûlit, lesmangit et s’couchit.
*
* *
Oui mée, v’là-t-i pas qué, dans l’mitan d’la nuit, l’écolome entendithouiner l’guiâbe dé maignier sus son paillasson !... I s’lévit binvite, tout échaubouillé, débarrit sa porte, et r’culit en drieîre commes’il avait vu un mouron.
- Un éfant !... Un éfant ! (qu’i disait comme çà, bianc comme un linge).
A la fin des fins, aprée qu’il eut bin ruminé à son affeire, i pritl’maignier, l’bercit dans ses bras pour qu’i n’miche point, li mitl’biberon dans la goule, allit l’mette à la grand’porte du sumineîre,branlit la tintenelle et fouinetit. L’porquier arrivit ové son bonnetd’coton et créyant qu’ç’était un éfant perdu, i l’portit à l’hospice.
Quand l’abbé Martin apprit l’lendemain qu’l’écolome avait été aussirenârré qu’li, i s’dit qu’i li jouerait eune bonne tournée quand l’hivés’rait v’nu !
*
* *
Çà n’manquit point !... L’écolome disait la premieîre messe à cinq heudu matin et, pour réveiller l’z abbés, l’porquier fernâillait eunequioche dont la corde ballait au bas d’l’escalier qui m’nait à leuxchambes. Eune nuit qu’la p’tite bonne femme pieumait ses oies (1),l’abbé Martin s’lévit à eune heu, descendit à guignettes, sonnit eunebonne branlée, et eune miette aprée les curés étaient tertous à lamesse...
Mée v’la-t-i pas qu’en décampant d’la chapelle, les curés entendîtentjûper à la porte du sumineîre !... En allit vite ouvri : c’était lespompiers qu’avaient ouï la matigne dé quioche pertinter à eune heuaprée meînuit, et qui créyaient bontivement qué l’feu était dans lameîson. L’écolome ergardit à sa monte et en restit tout ébaubi, mée ijurit bien d’aiguetter jusqu’à tant qu’i happe le coupable.
- Allons bon ! (qué s’dit l’abbé Martin), i va sûrement surger ç’ténuit sous l’quiocher, mée, vingt gueux ! j’va co l’joinde s’i gna pasd’détourbe !
*
* *
Çà n’manquit point !... Avant l’souper, l’abbé Martin s’mit à leuneterdu côté d’la cuisigne et ramâssit un vieux gigot, éioù qué y avait coquioques brins d’chai et des p’tits bouts d’tirouesne ; et, en feîsantsembiant d’rin, il allit éioù qu’était la corde dé la quioche et yaffûtit l’gigot à quate pieds en l’air. Pis, i s’mésaisit d’aller quéril’chien du porquier, qui n’tait poin-en-tout c’mode quand enl’ergardait d’coigne en-cul ou qu’en l’agouçait. Il l’ménit à quioquespârs dé la corde, dan un racoin, mit à son collier eune ficelle, qu’ifit passer drieîre un pilier, et dont il attachit l’bout dansl’collidor d’en haut, ousqu’étaient les cham’bes. Çà fait, i décanillitet allit à quant et l’z’autes curés qui chapaient dans la cour.
Un coup qu’meînuit fut sonné, l’abbé Martin s’lévit, prit des cisiauxdans la liette dé sa tabe et coupit la ficelle qui r’ténait l’chiensous l’quiocher. Li, qu’était là, j’pensez bin, à s’défrire et quisentait l’gigot dedpis eune pause, i s’mit vitement à saôter pourl’aveinde et l’roucher, mée à tous les coups qu’il essayait dél’décrucher, la guiâbe de quioche rabâssait.
Quand c’est qu’l’écolome, qui guettait tout affribondi dan un vieuxconfessionna, entendit ç’câbre-là, i s’démussit bin vite et, créyantaver affeire a un abbé, i happit l’chien pa l’cou en li houêlant àtue-teîte :
- Vous n’pâsserez pas l’ordination ç’t’année !
Oui, mée, c’est qué l’chien était rudement furé : i v’lait absolumentdévorer l’écolome !... I corsaient si fo tous les deux, qué, bardadaud! v’là des grands bancs qui chessent et des tas d’cheîses quidécroûlent. Ç’à f’sait un boulvari !... Hureusement qu’les curésarrivîtent tertous et qui les séparîtent. Sans ça, en n’sait point, enconscience, dé ç’qui n’n’airait été !...
Allons, mon p’tit gâs, l’marchand d’sâbe est passé (2), j’té conterail’restant eune aute fouais.
______
NOTES :
(1) Une nuit qu’il neigeait.
(2) Tu tombes de sommeil... tu as du sable dans les yeux. III
LA PIÈCE DE CENT SOUS
Ou les Tribulations de Benoît
A Jules Louail.
Y avait eune fouais un gâs du pays d’Amont, qu’en appelait Bénouêtd’son nom d’baptême, qui vint s’piacer comme domestique sez unveuv’homme du côté d’Tellières, en tirant sus Courtomer. Bin sûr, ifaisait core à pu prée l’affeîre dé çtila qui l’avait loué, i n’étaitpoint feîgnant ni co tant beîte pour l’ouvrage, mée il était si bôné,si bôné, qu’un dimanche l’z aoûterons l’fîtent aller deux grands lieuesd’chemin, ovec eune échelle dé 22 bârriaux sus l’épaule, pour serrerdes sentines dans les bouais ! Jé n’n’airais, sarché vingt gueux, pourjusqu’à la quittée s’i fallait qué j’dîsîs tous les tours qui lijouîtent, et qu’défeux mes gens m’contaient bin souvent quand j’étaistoute pau’ p’tite.
Un jour dé foueîre, son maîte, qui n’était point d’aplomb, l’envéyit àSées porter le terme au propriéteîre, mosieu d’Ecuennes, qui restait audécoin d’eune grande place, tout conte le sumineîre. V’là l’gâs partien honnant et en sublant, ové sa belle biouse de coitil et sa hanoche,et qu’arrive là-bas brouste et brouste, au quart moins d’médi...
Quand il eut pris son ergent, mosieu d’Ecuennes s’n allit à la cuisigneet dit à Laguitte, sa servante, dé servi un bon dîner à Bénouêt et dén’lé leîsser manquer d’rin. L’gâs entrit dan eune salle manifique,qu’était si tellement guissante qu’i manquait d’chais à tous lespârs, et s’assîsit à eune tabe, éioù qu’en vint y apporter un canard èsolives, un caniquet, un p’tit chanquau d’pain, deux norolles et eunebonne affeîre de cide mitoyen.
A mais qu’la bonne sut partie, Bénouêt s’att’lit aprée la vivature, méequand i vit l’s olives, il en restit comme un viau d’six semaines : «
Qué l’guiâbe n’saye pas d’leux tours, ès gâs d’bourgeouais ! qu’i ditcomme ça en li-même. J
’sais bin qui n’sont point co tant malaucurieux,pisqu’i mangent des calimaçons, et qu’i z’attendent qué les lieuvessayent pourris pour les feîre cuire, mais l’guiâbe mé brûle, j’n’airaisjamée chongé qu’i pouvaient mette du gland dans leus fricot. »Là-d’sus, il ramarrit toutes les olives, les sucit crainte dé s’bader,et les mit dans sa poche pou n’point aver l’air d’eîte fûté d’lacuisigne à mosieu d’Ecuennes.
Quand c’est qu’il eut fini d’manger sa chai et pris un bon d’mi,Laguitte el ménit dans l’bureau, éioù qu’i trouvit eune vénue d’biauxmessieurs qui caôsaient censément d’leux affeîres. Mée, pendantqu’Mosieu d’Ecuennes mettait la main à la pieume pour écrire saquittance, Bénouêt, qui suait à d’gout, v’lit-i pas aveinde sonmouchoué d’poche pour sé netti la goule. Crac !... v’là les mâtignesd’olives qui déroulent ava la chambe !... Quand l’gâs vit ça, i pritbien vite son érusée et s’mit à couri aprée l’z olives, qu’même il enaccoîfrit quoiqu’eunes sus les tapis. Les messieurs qui n’ycompernaient rin s’entergardaient en s’demandant c’que ça pouvait bindire, mée Mosieu d’Ecuennes, qui n’était point si beîte, vit bin parousqué l’piat courait. I s’mit à riocher, qu’i n’n’avait l’nez rougecomme eune roupie, et donnit l’mot d’billet au gâs, ovec eune bellepièce dé cent sous pour son vin.
*
* *
Bénouêt s’en r’vint d’Sées à quant et l’peire Loyal, un vieuxharicoquier qu’était si savant qué n’y avait pas d’loi qu’i n’conneîssepoint, et pas un gâs d’avocat pour y en r’montrer.
- Eioù don qu’j’alliez à matin, peîre Loyal, qué j’couriez si fo ? quili dit comme ça.
- Pagué, j’allais prenne el train d’Alençon, et, dans l’espèce, j’n’aipoint perdu ma journée : j’ai gangné vingt bonnes pistoles dans monprocès... Ah ! quins ! vais-tu, n’mé parles point d’ces plaideuxd’quate sous qui chanissent dans d’méchantes justices dé paix. Enconscience, ça fait piquié !...
- Bon d’la, qu’réponnit Bénouêt tout éviôné, j’avez bin d’la chanced’aigripper deux cents francs comme ça tout d’un coup ; i faut quéj’eusse bin des mouais pou n’n’aver autant !... Faudra qué j’médonniez-je des leçons là d’sus, je n’demande pas mieux quéd’m’assavanti.
- T’es pas assez malin, mon pauve éfant, qu’i li dit comme çà toutuniment : tu t’f’rais gourfouler par des gens bin pus r’nârrés qu’tai,et tu leîsserais beîtot ta piau dans les pattes des hussiers ! Tu veuxpiaider.. tu veux piaider, mée, dans l’espèce, tu n’connais seulementpas la loi !...
- Ah bin, qu’réponnit l’gâs, la Loué, ça n’mémoïlle pas !...
- C’est pourtant pus dûr à apprenne qué d’jouer à la galoche...Ecoute-mai bin : j’vas sus douze ans (1), s’pas, j’ai envéyé pus d’deuxcents lettres de juge dé paix dans ma vie, j’ai piaidé pus d’vingtfouais au tribunal d’Alençon et rappelé tras coups à Caen ; eh bin,dans l’espèce, y a co bin d’z affeîres qué jé n’connais point.
- J’m’en fiche, qué dit Bénouêt, j’veux apprenne à piaider ; jé n’saispas si rendoublé beîte qué jé n’n’air l’air, et aussi vrai qu’Mosieud’Ecuennes m’a donné cent sous...
- Ah ! i t’a donné cent sous !... Eh bin, pisqué t’y quiens, qué tum’fais tant d’prîments, j’veux co bin t’donner eune petite leçon quit’profitera sûrement. Ecoute-mai bin : un supposé qué j’té prété centsous et qu’tu n’veux pas m’les rende...
- Oui, j’comprends bin, j’vous dais comme qui dirait cent sous et j’én’veux point v’les payer.
- Tout drait !... Mée j’y chonge, qué dit l’peîre Loyal, si, au lieud’rester là à chouti comme des cantogniers, j’allions prenne un p’titdémion ?
I’z entrîtent dan eune auberge qu’était pleigne dé monde, et un coupqu’i sûtent assis et servis, l’peîre Loyal li dit tout-fin haut pourqué les gens ouïssent :
- Ervénons à note affeîre.. J’t’ai don prété cent sous ?
- Oui, j’en conviens, qu’réponnit Bénouêt..
- Tu n’veux pas m’les rende ?
- Non, qu’dit co Bénouêt en tapant un grand coup d’poing sus la tabe.
- Eh bin, mon gâs, j’vas t’feîre assiner, suffit que dans l’espèce,ç’tite-là qui dait, dait payer. En n’vait quasiment qu’ça d’écrit dansl’Code des Louais. Rumine bin à c’affeîre-là et tu n’s’ras pas binlongtemps à saver dé ç’qui n’n’est.
*
* *
Dé qui qui fut malement supé tras jous aprée ? Ça sut Bénouêt quand ir’cieuvit eune lettre du greffier, qui li disait d’apporter les centsous qu’il avait empruntés, ou qu’sans ça l’peîre Loyal allaitl’entreprenne.
Vlà l’gâs qui s’met à démillionner, à dégouêner conte lé vieux bringandqui l’avait mis dans l’bafoin, et qui pousse des ébrais qu’enl’entendait du mitan d’Courtomer !... Mée, i n’calit point, il allitd’vant l’juge dé paix, li dit qu’i n’avait jamée d’mandé la caristade,et qu’en défénitive, i r’fusait absolument d’payer ç’qui n’devait point.
L’peîre Loyal fit v’ni les gens qu’étaient dans l’auberge et i dîtenttertous qu’en bonne vérité, Bénouêt avait conté d’vant ieux qu’i d’vaitcent sous au bonhomme, mée qu’i n’sé soucissait pas d’les rende. L’jugedé paix, comme de bin entendu, condamnit l’gâs à payer les cent sous etpis les frais qui s’émontaient à deux ou tras francs.
En sortant de l’auguience, Loyal s’appreuchit d’Bénouêt, qu’était binflonné, et qui s’n allait comme un bouret épatté :
- Mets-ça sus ton canepin, mon éfant, qu’i li dit, c’est ma premieîreléçon ; comme tu l’sais, j’n’en sais point l’homicide, c’est toué quil’as demandée. L’prochain coup, ça t’coûterait pusché, j’peuxt’l’acertener.
A la fin des fins, comme el peîre Loyal n’v’lait point co trop profiterd’l’innocence d’un méchant domestique, il emmenit l’gâs et tous lestémoins à l’auberge, éioù qu’i passîtent la r’lévée à boueîre la piècede cent sous à Mosieu d’Ecuennes.
______
NOTE :
(1) Les septuagénaires ont l’habitude de supprimer 60 ans dansl’indication de leur âge : j’ai 10 ans, pour 70 ans, j’ai 18 ans pour78 ans. IV
LES MOINES DE SILLY
Ou la Bourrique à Théodore
A Léon Lhommas.
Y avait eune fouais deux gros moines dé l’abbaye d’Silly, qui s’enr’vénaient du Meslerault, éioù qu’en ieux avait donné en sous et enliâs pus d’cinq cents francs qui leus étaient dûs pa l’z uns pa l’zautes dans ç’pays la.
I z’étaient bin chergés comme dé juste : i hanequinaient si fo amontles côtes qué l’iau leus en pissait sus les joës, et qu’en lesentendait grouller d’un bon quart dé lieue. Aussi, quand i sûtentarrivés dans les bouais d’Plais, i z’étaient si épouffés, i s’avaientl’s épaules si gourfoulées et les mains si glômies, qu’i s’assiessîtentsus l’bord d’un ari pour sé défatiquer.
Y avait bin eune grand d’mi-heure d’horloge qu’i z’étaient là àsoulasser quand, à un p’tit hupet, i ouïtent eune cherrette qui v’naitdu coté d’Alménesches.
L’freîre Ambrouêse ergardit et s’mit à guincher :
- Ah bin, qu’i dit comme ça d’un grand sens, j’apercieus la loin labourrique à Thôdore, çà m’étonnerait co point quante çà s’rait laiqu’emporterait note ergent au couvent.
- Y chongez-vous, qu’réponnit l’frère Adrian, Thôdore est un gâsd’guiâbe, un hourloubier, i n’va bin sûr pas v’ler nous la préter.
- En bonne vérité, cher freîre, j’étes, en ç’moment ici, couenne commeun coq bairaud !.... Véyons, est-ce qué Thôdore n’est pas iun d’nosfermiers ? A vous quioquefois vu la couleu d’son ergent ? Non, pas dis? Eh bien, moué, au jour d’aujourd’hui, j’vas sourniguer l’canasson déç’mauvée payeus. En s’arrangera ovec el supérieur pour qué l’fermiern’y perde point, ni l’abbaye nitout.
- Oui, mée, qu’réponnit Adrian, Thôdore va rester tout conte sa bête,et en n’va pas pouver débouiner d’ové lai sans qu’i s’en apercieuvequasiment tout d’sieute.
- Jé m’cherge dé l’affeîre, qué dit core Ambrouêse, mée i faut vitementnous cati pour qui n’nous vée pas.
La d’sus, les deux moines s’lévîtent, s’accouflîtent fouinassementdrieîre un bisson, et surgîtent du côté d’la route.
*
* *
Thôdore v’nait dans les bouais d’Plais qu’ri des coîpiaux ou serrerd’la guinche à la d’mande qu’il en chommait. Quant il était arrivé dansun endreit bin dérossé, i dételait sa bourrique et l’attachait d’oveceune grand longe autour d’un digon, d’éiou qu’ou pouvait encorserdes gians et quioques brins d’mangeâille.
Aussi, à mais qu’Ambrouêse vit qu’Thôdore était bin aménivé aprée sescoîpiaux, i s’démussit d’sa cache et allit sans feîre dé brit jusqu’àla bourrique, la détachit et la menit jusqué sus la berne de la route.
- Bon sang divin ! qu’dit Adiran, lé z’yeux égarouillés comme eunepoule essauvadie, si Thôdore à la moindre doutance qu’en y a volé sabeîte, i va couri aprée nous et bin sûr nous doueller la piau.
- N’ayez don point peus, mon frère, qué réponnit Ambrouêse. Chergez binvite les pouches dé sous et d’liâs sus la bourrique, mettous àcaliberda et marchez v’z en à Silly.
*
* *
Adrian parti, son compagnon r’vint éioù qu’était la bourrique, prit saplace et s’atourottit la longe au cou... Il était grand’ment temps, carThôdore avait fini d’cherger sa p’tite bagnole et i v’nait qu’ri sabeîte :
- Qué l’guiâbe m’empue, qu’i dit, v’la astheu ma bourrique changée enmoine !
Mée, aprée aver réfléchi un p’tit brin, i s’appreuchit d’Ambrouêse etli bitit l’épaule :
- Dé quai qu’javez fait d’ma bourrique, hein, vieux farceus ?
- En bonne vrai, mon ami, je ne l’ai point vue...
- Allons, pas d’hans ! I n’faut pas faire l’enpeine ni bertonner d’ovémai, j’entendez, ou bin j’housse !
- Mon ami, écoutez-moué. J’avais fait comme qui dirait quioquesméchants péchés et pour mé puni, l’bon Guieu m’avait changé en ânessepour quinze ans, mée sûrement qu’il a iu piquié d’mon repenti, car ivient d’mé r’donner ma philomie d’chrétien.
- J’n’ai pas grand fiance dans les quate sous qué jé m’disez là :j’crais bin qu’c’est des nunus. Enfin, j’allez v’z en expliquer à quantet la bourgeoîse.
Là d’sus Thôdore traignit l’moine au bout de sa longe jusqué dans l’finfond d’son village.
*
* *
Quand c’est qu’i sûtent arrivés sez Thôdore, sa bourgeoîse, qu’enappelait Gélique de son nom, manquit bin d’s’évanouiller, créyantqu’son bonhomme d’homme avait iu d’méchantes reîsons ové les moines deSilly. Mée Thôdore racontit d’en par éiou qui n’ n’était, et Gélique enrestit toute supée.
- Comment, c’est-i Dieu possible ! (qu’ou dit comme çà en feîsant degrands rabis). C’est vous, mon peîre, qui nous avez servi d’bourriquependant pus d’trâs ans ! Eh bin, au respé d’vous, j’étiez un binmauvais avéras, si ergulaîtu qu’en n’savait, en conscience, quai feîrepour vous équarri. En avait biau tirer sus vos grandes oreilles, vousf... iche des coups de d’pieds dans les pattes et des coups d’cro pa lagoule, qu’en n’pouvait v’ni à bout d’vous coger... J’nous en avez tydonné du mal !... Quand j’étes arrivé sez nous, j’nétiez gueîre chairu,marchez, j’étiez même si équiamme qu’en s’attendait bin à vous vaisconi d’un moment à l’aute, et, j’crais bin qu’sans les cherdrons et lesfreûles qué j’vous bâillais à pleines géronnées et dont qué j’vousdélôsiez, jé n’vous seriez jamée embarni... Mée, c’est pas tout çà :sus ç’qué j’vai, j’en étons pour les six pistoles que j’nous avezcoûtés à la foueîre Saint-Maquieu, à Nonant... J’étons ruinés, nousv’là ava les chemins !...
- N’séyez don point si beîtasse, qué réponnit Ambrouêse. Pisqué j’vousai couté 60 francs, ça s’ra 60 francs, pour le moins, qué j’diminueronssus vos prochains fermages. Et patati et patata...
I continuit à l’z endormi d’ses remprônages, et quand i vit qu’iz’étaient si créyants, i n’leus tint pas cognure longtemps ; is’détourottit la longe d’environ l’cou, leus dit
à vous r’vais, ets’ensauvit dans son couvent.
*
* *
- A quai don qu’tu chonges, qué tu fais tant l’noir, qué dit deux jousaprée Gélique à son homme.
- A quai qué j’chonge ?... Eh bin, tant pus qué j’rumine à l’affeîre déla bourrique, tant pus qué j’crai qu’c’est les moines qui m’l’ontaigrippée pour sé payer dé ç’qué j’leus d’vons... I seraient co bincapabes dé la méner demain à la foueîre de la Quasimado, à Ergentan,mée, vingt gueux ! j’irai itout à la foueîre, mai, et si j’y trouvenote bourrique, l’guiâbe m’emporte si jé n’la ramène pas, quand tousles moines de Silly seraient là pour mé bourder !...
L’lendemain, Thôdore montit sus la jument d’son voisin et s’n’allit àErgentan. Quand i sut arrivé sus l’champ d’foueîre à quant et saj’ment, i vit eune magneîre dé p’tit moine qui t’nait sa bourrique ovecun licou et qu’en feîsait grand récit à tous les acheteux. A l’entende,gn’avait pas dans tout l’diocèse une beîte si peu harigneuse.
La bourrique qui reconnut son ancien maîte, s’mit à feîre des gestes, àdresser l’s oreilles, à houetter, et finablement à crier à longs hans.
- Combin qu’j’en demandez d’vote minisse ? qué dit Thôdore au p’titmoine.
- Six pistoles, mon ami, qu’i réponnit.
- Six pistoles ! qué dit Thôdore, eune villaine bourrique poussive quin’pourrait s’ment pas s’téni susbout ovec eune somme de grain sus l’dos!... C’est famine cher !
- M’est avis qué j’vous trompez, mon ami, qu’réponnit l’moine, car oulest qualiteuse et bin résoude.
- A qui qué j’disez ça !... Eh bin ténins, j’fais la gageâille qu’oun’vous porterait pas seulement eune demi-lieue, en sieuvant ma j’mentau pâr...
La d’sus l’moine sé présumit, et montit sus la bourrique, qui s’mit àsieûde dé bin prée la j’ment d’son maîte... Quand i sûtent arrivés à200 mètes de la ville, Thôdore montit sus sa jument et la bringit sitellement qu’ou s’mit à couri, à couri, comme s’oul avait iu l’feu dansquioque endret... A mais qu’la bourrique vit çà, j’pensez bin, ou pritson envahie pour rattraper son maîte, mée comme oul était en foucade détrimballer un homme, qu’était co bin b’sant sans n’n’aver l’air, ous’mit à ruer si fo, en passant par sus un pont, qu’ou rûchit l’guiâbedé moine, les quate fers en l’air, dans l’mitan de la rivieîre...
Hureusement qu’des gens piquiabes vîtent el pauve moine qui barbottaitfallait vais ! et qui l’idîtent à s’tirer d’dans l’iau ; sans ieux, ilétait bin sûr néyé.
Aprée aver bu eune bonne affeîre dé vin chaud pour sé rémouver,l’moine, qui n’était pourtant pus gueîre bastant, s’en allit d’son piedjusqu’à l’abbaye, ousqu’i contit ç’qui li était arrivé. Quand sescompagnons entenditent çà, i s’mîtent à rire, à rire, qui n’n’avaientco mal au vente huit jours aprée, et i dîtent qu’en véricotte ! iz’envéyeraient à Thôdore un mot de billet, comme par lequel il’ténaient quitte de ses fermages, et qu’même i feraient eune quêtedans le couvent pour ageter eune cherrette toute pimpante neuve à sagentie bourrique.
V
LE VOLEUR D’ABRICOTS
Ou le Jardinier du Grand-Séminaire
A Léon Boutry.
Y avait eune fouais amont l’mûr d’un grand sumineîre un abricoquierhurif qui rapportait tous l’z ans par couellées ; mée, malhureusement,quante Mathurin, l’jerdignier, s’n’allait pour les serrer, is’apercieuvait qu’les pus biaux frits, ceutes-là qu’i donnait à mangerau Supérieur, avaient été sournigués durant la nuit. Ça l’feîsaitétriver, comme dé juste, et tous les matins en l’véyait feîre elguiabe, en déguenaçant conte les voleux.
- Vingt gueux ! qu’i dit comme ça un tour, c’est bin sûr des berlaudsqu’amontent par sus l’mur du jerdin et qui font tout ç’carnage-là !J’prendrai un balai, un fouet d’ovec eune bonne mîse, n’iporte quai, etj’les hourdanserai.
*
* *
Quai qu’y fit m’z amis !... Eune nuit, i prit eune grand’housse ets’couchit adents drieîre un gros bouis qu’était tout contel’abricoquier.
Y avait bin tras heures d’horloge qu’i droguait en aiguettant du côtéd’la muraille du jerdin, quand tout d’un coup i ouït dé d’quai au-d’susd’li. Il ergardit en l’air et vit beîtot deux grand’ jambes noueîrespasser par eune feneîte et s’mette à d’valler dans l’abricoquierabsolutement comme ava eune échelle.
- Jésus Maria ! qui dit comme ça tout beîtasse, c’est un abbé quiratiboise mes abricots !...
L’sang n’y en fit qu’un tour sus l’côrps, à c’qué j’ai ouï conter pardéfeue ma meîre.
L’abbé, j’pensez bin, qui n’sé guettait d’rin, s’mit bin vite à coulerles pus biaux frits dans ses poches et à en engouler quioques-uns, dontque les essâs et les nouyaux chutaient jusque sus la teîte aujerdignier... Mathurin rondissait lé z’yeux, mée i n’y véyait quette, in’pouvait point erconneîte el voleus : la nuit, s’pas, tous les curéss’enter’semblent...
Oui mée, v’là-t-i pas qu’l’abbé tréveuchit sus eune branche et quimanquit d’chais les quate fers en l’air !... Comme il était hinel, is’rattrapit bin à un méchant sicot, mée i s’était côffi l’bras,dépiaustré eune jambe et égrimé les joës. Tout ça c’était rin, carl’malheur sut qu’en chessant, la queue d’sa soutane s’était défaite etqu’ou ballait à ric la terre.
- Dé ç’coup, qu’dit Mathurin à son-à-part, jé l’quiens !
*
* *
Quai qu’i fit, m’z amis ! Bin qui sût à son désamain, il avançit unbras, happit la guiâbe dé queue tout doucètement et d’ové son couquiauy fit une coupure dans l’bas.
- L’Supérieur saira bin d’main dé qui qui mange les abricots ! qui ditcomme ça en li-même.
Oui mée, comme il avait gangné un rhieûme à eîte couché sus la terre,il n’put point s’erténi d’teîgler. Aussi, quand l’abbé entenditç’brit-là, pensez bin, i sut rudement en fourgane, car i n’sésoucissait pas grandment d’eîte pris ; i r’montit bin vite, déboulit pala feneîte du collidor et rentrit dans sa chambe. Oui, mée, v’là-t-ipas qu’en défaisant sa soutane pour s’ercoucher, i vit qu’la queueétait mincée !
- Mon Guieu faut-i ! qui dit comme ça, en aiguettait l’voleus et c’estbin sûr pour m’erconneîte qu’en a hagé ma soutane !... Mée c’est pasgeînant, qu’i dit l’instant d’aprée, j’vas donner d’l’ouvrage autailleus du sumineîre.
*
* *
Quai qu’i fit m’z amis ! Comme l’z abbés dormaient tertous, i s’n’allità guignettes dans leux chambes et coupit la queue de toutes lessoutanes qu’i put aigripper. Pis, l’lendemain matin, en sortant de lachapelle, i s’coulit, sans feîre mine de rin, drieîre l’Supérieur et enfit autant à la sienne !...
Mathurin feîsait l’gros, comme dé juste ; i créyait bin aver pris lapie au nid ! Aussi quand i rapportit d’en par éioù qui n’n’était,l’Supérieur s’mit en coleîre et son nez devint rouge comme eune piône,c’qui n’était pas bon sine, à c’qu’i s’paraît.
*
* *
Quai qu’y fit m’z amis ! I sortit vite en clârant les portes et allitjoinde els abbés qui caôsaient dans la cour.
- Mettous en rang. Messieurs (qui leus y dit comme ça d’un air pointc’mode), et tournous la teîte du côté du mur.
L’z abbés, tout ébaubis, obéirent comme de bin entendu, et l’Supérieurpassit drieîre eux pour erconneîte el coupabe... M’z amis ! quand ilvit qu’les queues d’toutes les soutanes étaient abîmées, il en restitcomme innocent !...
- Qué l’Guiâbe mé patafiole ! (qu’i dit comme ça), la mienne est coupéeitout !
Là d’sus i s’en r’tournit bin couenne, et l’z abbés s’mîtent àguincher, bin en soin d’saver si leus maîte n’était point dévenubettelé.
*
* *
L’mangeus d’abricots finit son temps au sumineîre, pis partit bin loindans les missionneîres. Sûrement qui v’lit co feîre des tours ès gensdé d’par là-bas, car j’ai ouï dire qu’eune fouais les gâs d’Chinouaisl’mîtent sous eune grosse quioche et tapîtent dessus d’leux cent dixmille forces ovec dé gros marquaux.
Quanté l’pauve curé s’tirit dé d’là dessous, il était sourd comme unmouron, et i n’vêquit pas bin longtemps après.
N, i, ni, mon conte est fini.
~*~
MON ONCLE RADIGOIS
(MONOLOGUE)
A Charles Pitou.
Bon sang divin !... Sarché nom dé d’là !... Qué y en a-t-i qui sontpourris chanceux !... Ainsi, c’est commé j’vous l’dis, note voisin,Minique Morel, vient d’hériter d’un cousin remué d’germain, qu’in’avait jamée vu et qu’i créyait mo dans des pays bin loin, et l’peîreThomas, du village dé la Brosse, qu’avait ageté quinze erpents de bienà fonds perdu, a tout juste payé un terme d’arriérages !... Bon d’làd’bon d’là !... cez nous ça n’tourne point dé d’même : j’n’avions qu’unbonhomme d’onque, le peîre Radigois, dont qu’j’étions-je les seulshéritiers, et ses écus s’sont ensauvés d’la famille !... Cà n’faitpoint piaisi, tendous bin ?
V’là-t-i pas que, y a deux ans, ç’vieux lubre-là s’mit à démenerl’amour à quant et la Marceline ! eune grand’ sergale qui portait desbonnets-montés si tellement chergés d’bouquets qu’eune dé nos vaches yairait trouvé son nourri durant tout un hiver !... J’essayis dél’dépersuader, de li raprôner qu’i pourrait mieux s’sorter, (carMarceline avait biau s’parluiser et faire des gestes, ç’n’était pasd’éluite), mée mon oncle était si rendoublé batévanne, si autorieuxmalgré son âge, qué jé n’pus arriver à m’en chevi :
- Tu comprends bin, mon gâs, qu’i m’disait comme çà, jé m’fais ancienet c’est bin triste dé s’téni tout fin seu dans l’fin fond d’eunecampagne. Si j’veux eune femme jeune et bin d’aplomb, c’est uniquementpour soigner les dolaisons qui m’font sainti amont la hanche, etm’réchauffer les pieds quanté j’les ai gelés... Car, tu penses bin, monneveu, qu’à 70 ans, jé n’sais pus gueîre d’âge... à compromettre tonhéritage !... Quai qu’tu veux ! j’en serai quitte pour li feîre eunepétite donaison sus l’contrat... Oui mée, voilà ! c’est qu’lameînageîre ouve la goule si grande que j’en sais au d’zo : ou veut dixmille francs ou bin, comme ou dit,
aguieu l’mariage... J’compte donsus tai, mon neveu, pisqué t’es intéressé dans l’affeîre, pour m’ainderà li feîre rabatte quioque chose et à rac-moder l’marché !
- Tout ça c’est bin des arriâs, qué j’li réponnis, çà n’m’avient gueîred’eîte darin... et pis Marceline est un brin ergoline, à c’qué j’ai ouïconter.
- Bûth !... qui mé r’prit en chantûsant, tu russiras bin à l’apîper...Ecoute-mai : à force d’alos t’as quioquefois vendu à la foueîre un g’vacornard pour un g’va bin résoud, et eune taure bariotue pour eunegénisse ameuillante !... Eh bin, mon gâs, gna point d’aute magnieîre déreîsonner dans les mariages d’astheu !... Allons, pas d’hans,marche-t-en, et tu t’en tireras d’fin premieîre !
*
* *
Pagué ! qué j’mé dis quand l’onque Radigois sut parti, Marcelinen’mange pas l’linge, à c’qué j’crai ; en peut co bin li caôser ! J’mémis bin vite en dimanches et mé v’la parti cheuz lai ; mée j’eus biaul’entreprenne qué jé n’pus la feîre rabatte d’eune centime... Ah, ouremançait dû !...
- Créyous par hâsa, qu’ou m’dit en rondissant l’œil, qué j’vassacrifier bontivement ma jeunesse à soigner vote quiâpin d’onque !...Eioù don qué j’trouveriez une jeune fille qui s’marierait d’un hommed’âge, qui marche avec un bâton et core quand la jambe accidentée veutbin sieûde ! Ah bin oui, j’m’en cherge !
- En bonne vrai, j’exagérez, qué j’li réponnis. L’peîre Radigois veutbin vous reconneîte dé d’quai, mée faut pas li demander pusché quin’peut donner. Créyez-mai, n’bacicotez point d’o li et jé n’vous enrepentirez point... Bin sûr, mon onque est pâssé d’mûreur, i commence às’adôssir et n’est pas tout-à-fait délibre, mée, j’en réponds, il a lespomons solides et l’cœur co bin attaché !
- Oh là là, qu’ou mé r’prit en feîsant la lippe, j’êtes bîcle pour lecertain : j’avez mal ergardé l’peîre Radigois !... En défénitive, c’estbin unutile dé bertonner là-dessus pus longtemps : c’est dix millefrancs ou j’en restons d’enpar...
Quand j’vis çà, j’m’en allis en clârant la porte :
- « Non ! non ! qué j’mé disais, jé n’veux pas mais la vais, estégrande poueîson là ! »
Comme de bin entendu, l’mariage s’fit quioques semaines aprée, et mononque né s’conneîssait pas d’épouser eune si gentie quériature ! I lachérissait si dû l’jou des noces qu’il en jetit son bâton dans l’mitand’la cour, et qu’i marchit durant quioque temps hinel comme eune bique.Oui mée, au bout d’six semaignes, i dut rehapper son bâton et, au boutd’six mois, s’traîgner ové deux béquilles !
*
* *
Un dimanche, la r’lévée, pendant qu’ma bourgeoîse était ès vespres,v’là mon onque Radigois qu’arrive à la meîson et boîtant si bas qu’in’eut qué l’temps de s’assîre.
- Mon gâs, qu’i m’dit tout unîment, j’viens t’démander un grandservice... Tu sais qu’anuy, pièce en dehors dé mai n’peut porter l’nomd’Radigois, un nom qu’est, en peut l’dire, célèbre dans tout l’pays.Mon arrieîre-grand-peîre, Adrian Radigois, était maîte-chante dansl’église de Chalange ; mon grand-peîre, Minique Radigois, étaitbouilleur de crû à Montchevrel ; mon peîre, Thôdore Radigois, qu’t’asbin connu, était chercutier et conseiller municipal à Saint-Aignan, etmai j’ai gagné une petite fortune dans mon méquier d’affranchisseus !Eh bin, en conscience, j’peux-t-y leîsser péri l’nom d’Radigois, portépar des gens qui furent tertous bin honnêtes et bin savants !... Ah !si tu t’appelais Radigois d’ton nom, comme ta meîre, pagué, j’s’raisbin tranquille pisqué t’as déjà deux gâs solides, mée tu t’appellesBourdeloie ! Des Bourdeloie ! n’mé caôse pas d’çà, y en a comme duchien-fou ava les chemins : y en a du côté d’Vimouquiers ; i n’enchomme point dans l’z’environs d’Laigle et dans bin d’autes endreits !
- Eh bin, mon onque, qué j’li dis, n’étous-pas marié ? Déjà d’un, quanden s’marie à pus d’soixante-dix ans ovec une forte fumelle dévingt-trois ans, en a toujours eune vénue d’quégniots. C’est mai quivous l’dis !
- P’t-ête cob in ! qui mé r’prit, mée appreuche-tai que j’té contequioque affeîre dans l’oreille...
A mais qu’j’entendis c’qui m’dit, j’en devins tout blard et léz’yeux m’en béluettîrent.
- Bin, mon onque, qué j’li réponnis, faut qué j’séyez-je rudementinnocent pour mé d’mander eune chose aussi farce ! Mée, véyons, sij’faisais çà j’perdrais toute espérance sus vote héritage !...
- Ecoute-mai bin, qu’i m’dit en sé r’lévant, c’est mon dergnier mot :j’té donne la préférence pisqué comme ça rin n’sortirait d’la famille,et pour ton vin j’té ferai cadeau de 5.000 francs l’jour du baptême...Tu n’airas qu’à v’ni d’anuit en huit, à dix heures du soir, la porten’s’ra point crouillée et ta tante sera toute seule. Guette-tai bind’manquer !...
*
* *
Moué, qui m’sais marié devant note adjoint et devant note curé, jén’pouvais point en conscience décider d’ça tout seu. Mée, un coupqu’j’eus conté à ma bourgeoîse d’en par éioù qu’i n’n’était, ou s’mitdan eune grande coleîre, fallait vais !
- En v’là-t-y un vilain sagouin, qu’ou dit, pour demander des affeîresaussi abominabes ! Non, non, jé n’veux point... Ah mée non, jé n’veuxpoint... Et surtout qu’sa grande traîgnée n’s’inventionne pas d’venicez nous, je n’n’airais pas pour longtemps à l’effouqueter.
J’étais bin en soin, comme dé juste, mée aprée aver disputé duranttoute la nuit, en décidit qu’aprée tout cinq mille francs était bons àramasser et qu’i faudrait eîte bin Nicodême pou n’point profiterd’l’occasion.
Au jour dit, j’encorcis un pot d’maîte-cide pour mé donner du ton, et,la cassiette sus l’oreille, mé v’la parti cez mon onque ; mée i feîsaitsi noir qué jé m’perdis dans les mauvais chemins et qu’jarrivis là-bas,tout consommé, ovec eune bonne heure dé retard. Aussi j’eus biau taperà la porte, rin n’mé réponnit.
- Oul est pa là quioque pa, qué j’mé dis.
Là-d’sus j’entris dans la cuisigne, j’pris un fallot sus la pente de lacheminée et j’mé mis à houter dans tous les bâtiments, mée jé n’pus rinapercieuve... J’radoublis don à la meîson, bin couenne comme dé juste,et çà n’sut qu’huit jours aprée qu’mon onque Radigois m’contit,qu’étant arrivé trop ta au rendez-vous, ma tante avait pris un auteouvérier. Mée, qu’i m’dit, en compte bin sus tai pour eîte parrain.
*
* *
Quasiment un an aprée, v’là ma nouvelle tante qui vient cez nous àquant et mon filleu, déjà bin éluché, bin effestoui.
- Bonjou, ma tante, qué j’dis, l’peîre Radigois dait eîte bin contentd’aver un hériquier aussi hurif ?
- Bin sûr, qu’ou mé réponnit en riochant, mée Ugène est bin pusdifficile à élever qué j’créyez : y a pas moilien dé l’feîre boueîre.
- Mettez-lé don dans la Chérité (1), qué j’li dis, et i boueîra bin !
Là-dessus ou s’mit à rire, en s’ramissit pour dé bon, et j’causîmespendant eune grande heure d’horloge.
- A preupos, qué j’li dis comme çà, i n’n’est ni pus ni moins, pisquél’mariage est fait et l’pêtit gâs arrivé, mée y a eune affeîre quéj’s’rais bin en soin d’saver. Disez-moué don, ma tante, pourquai qué jén’vous trouvis point cez vous comme c’était convenu, j’savez bin l’soirqué... l’soir où...
- J’êtes bin curieux, mon n’veu, qu’ou m’dit en m’ergardant d’bicoin,mée j’veux co bin m’espliquer là-dessus sans feîre la baubelle...J’airiez dû comprenne combin qu’j’aviez été peu révérend ové mai,pisqué non-seulement j’n’arriviez point à l’heure, mée core quéj’demandiez cinq mille francs pour... J’n’étais point à chommed’ouvériers bin moins regardants, tendous bin ?
- Beau d’mage ! c’est pas moué qu’avais fixé la somme, qué j’liréponnis. Mée, pourrious m’dire combin mon onque donnit à l’homme quis’était mésaisé d’arriver avant moué ?
- Ah voilà, qu’ou m’dit, l’pauve gâs n’avait point chongé à feîre sonprix d’avance et vote onque eut la mauvaiseté d’bacicoter pendant sixmois pour le payer, sous prétexte que c’était mai, et non li quil’avais commandé. Finablement, avec bin des
si et des
mais, i lidonnit deux cents francs d’ergent blanc et un port d’armes.
______
NOTE :
(1) Charité, confrérie paroissiale qui assiste aux inhumations ; laréputation des confrères laisse beaucoup à désirer sous le rapport dela sobriété. ~*~
SCÈNES NORMANDES
___________
UNE VEILLÉE NORMANDE
PERSONNAGES
________
LE FERMIER. – LA FERMIÈRE. – HONORÉ, père de la fermière. – MATHURIN,propriétaire. – ISIDORE, charpentier. – MICHEL, cultivateur. – RENOTTE,femme d’Isidore. – MARIENNE, femme de Michel. – LOUISON, vieilledemoiselle. – ALEXANDRINE, jeune fille. – VALENTINE, fille du fermier.– CÉLESTIN et HENRI, enfants d’Isidore.
La veillée se tient dans une ferme des environs de Courtomer. Deuxpaysans, menant grand tapage, jouent aux cartes à l’extrémité d’unetable longue et épaisse ; à l’autre bout, plusieurs femmes cousent outricotent ; des enfants s’amusent dans un coin et le fermier s’absorbedans la lecture du
Bonhomme Normand. Le père de la fermière,octogénaire qui a fait avance d’hoirie à sa fille, moyennant qu’il seravêtu, nourri et logé sous son toit, sommeille doucement auprès del’âtre. Sur le genou du vieillard, un chat aux moustaches tombantesronronne en fermant les yeux, qu’il entr’ouvre parfois quand le bruitproduit par les divers groupes se manifeste plus violent.
A Alfred Marre.
LA FERMIÈRE,
à Mathurin, qui entre en secouant sa casquette.
Bin, en va sonner la crémâillieîre et vous feîre manger à lagrand’cueiller ; j’n’avez pas été longtemps en riote !... (
Palpant sablouse) J’étes à plein confondu.
MATHURIN
N’m’en caôsez pas, i chait de l’iau à siaux !... Leîssez feîre, lesgueîpes n’viennent point vionner à vos oreilles, et gna pas besoind’mette des barbottiaux à la teîte des j’ments. Bonjou, la compagnie !
LA FERMIÈRE
Accouflous prée du feu qui mouronne sous la cende. J’vas aller qu’rides parottes et des coîpiaux pour vous feîre eune bonne fouée qui vavous remouver.
MATHURIN
L’résan n’est point chaud, ténins ! J’en ai les leuves tout halitréeset mon rhieûme n’va co pas s’guéri dé ç’coup. Jé n’n’airais, noblegueux, fait la gageâille : l’vent était d’ava quanté j’sais parti etl’temps commençait à s’abômi sus Courtomer... M’z’amis, j’n’étais pastant seulement rendu à la sapée qu’est amont la côte, qué j’étais saucépar eune ârée conséquente ; j’étais, en véricotte, endécisd’radoubler... Fious don ès erménas, l’temps n’s’est pas l’vé etl’solei n’a pas ri eune miette de la journée.
RENOTTE
Bin ! la mariée s’ra rudement lichouse.
LA FERMIÈRE,
d’un air rogue, à son père.
Gence-tai dé d’là, vieux déguenaceux !... Il est là toute la saintejournée à aniqueter l’chat qui trouille sus son g’nou ;... gna pasd’danger qui s’dérange.
HONORÉ,
essayant de parler.
Heu... Heu...
LA FERMIÈRE,
de plus en plus montée.
Tais toué, tu m’fures ové tes remprônages... Y n’est bon qu’às’chauffer jusqu'à tant qu’i s’périsse dans l’fouyer. Gna pas moiliend’li feîre entrer çà dans sa sarchée horgne !... N’n-a-t-i d’lamauvaiseté !...
LOUISON
Y n’sait p’tête pas ç’qué j’li disez, il entend si haut !
LA FERMIÈRE
Ouai ! I n’est pas sourd quand en rabâsse les assiettes, l’vieuxfaimvallier !
LE FERMIER,
sentencieusement.
Un couquau d’adlaisi coupe toujous bin. (1)
HONORÉ
Heu... Heu... (
Une larme glisse sur le visage du vieillard).
LA FERMIÈRE,
à son père.
As-tu bintôt fini ové tes pigneries !... (
A Mathurin) J’devez averfaim.
MATHURIN
Dame oui, j’sais fade, j’n’ai rin pris dedpis à matin.
LA FERMIÈRE
Véyons, dé quai qué j’vas v’s’offri ?... V’lous eune amelette, dugigier, ou un brin d’lapin ?... N’feites pas d’cérémonies, note lapigneest co chêlée dé çté nuit.
MATHURIN
Merci bin, j’sais fûté d’chai... Donnez-mai un brin d’pain et dufromage.
LA FERMIÈRE,
apportant ce qui lui est demandé.
Jé n’sais pas si j’allez bin l’eîmer, note fromage ; y a des guillots àplein d’dans.
MATHURIN
Tant pus qué y a d’guillots, tant pus qué l’fromage est gouléyant.
VALENTINE, (
bas, à Louison).
Disez-nous un conte.
LOUISON (
haut).
Tu m’hébétes !...
ALEXANDRINE (
à Mathurin).
Et la noce, ça c’est-i bin passé ?
MATHURIN
Bien sûr, c’était du grand, marchez ! J’étions cent quatre-vingt-sept,sans compter les serveuses, quinze garçons et quinze filles d’honneu.La messe était manifique : y avait là des gâs d’Montchevrel quichantaient à tue-tête et l’sacriste nous a sonné six bonnes branlées!... Mée ont-i un drôle de curé !... C’est un bon homme bin sûr, méequ’il est don farce, mon Guieu faut-i !... Comme il y vait tout à faitgros, i j’tait des tambourignées d’eau bénite par la teîte ès mariés eti d’mandait co d’un grand sens à l’éfant-d’chœu : « Gnen a-t-i ? gnena-t-i ? » I n’n’étaient, en véricotte, néyés !... Pis, v’la-t-i pasqu’à la fin d’la messe, pendant qué l’chasse-coquin souffiait lescierges ové son démon, v’la-t-i pas qué l’curé montit dans la cheîre etfit un sermon ès mariés. I s’espliquait bin, mazette !... ah ! ah ! ilen disait des paroles !... A la fin des fins, quand la meîre dé lamariée vit qu’i n’décessait point d’péronner, ou montit dans l’escaïerd’la cheîre et ou li dit comme ça : « Mossieu l’curé, il est midi ! » Idevallit bin vite et allit vais à sa monte qu’était sus l’autel. Oui,mée, i sé r’tournit aussitôt et dit d’un air point révérend, energardant par sus ses leunettes : « J’vous d’mande bin pardon, Madame,i n’n’est qué l’quart moins, et à eune horloge bin réglée. »
(Longscommentaires).
VALENTINE (
bas, à Louison).
Disez-nous don une histoire dé r’venants.
LOUISON (
haut).
Tu m’héruces !
LA FERMIÈRE
Et la mariée, dé quai qu’j’en disez ?
MATHURIN
Oul est bin honnête, s’ment oul est ébréchée et oul a quioques tachesde son.
RENOTTE
Faut qu’ça saye tout de même une bonne mêinageîre, car tout le monde enfait grand récit... Et ses gens ?
MATHURIN
M’est avis qu’c’est du bon monde. L’bonhomme surtout est très franc :il airait donné tout c’qué y avait cheux li, mée, malhureusement, ilest d’meuré d’une estropisie. La bonne femme, lai, c’est eunegrand’bécue, picotée d’la p’tite véreule ; gnen a trébin qu’ont l’airde dire qu’ou s’rait comme çà un brin nagre... Ç s’pourrait bin : ouguignait fo dé z’yeux quand ou vit qu’en mettait la quenelle à latrâsieîme pipe dé maîte-cide... Ou feîsait même si tellement la corne,à un moment, que les nociers en riochaient.
LOUISON
N’empêche que c’est étonnant que l’gâs Toussaint sait si bin rencontré.Faut dire qu’au commencement, malgré qu’Vincent saye son darin, çàqu’allait d’croc et d’hanches. Gnen eut même qu’essyîtent dédépersuader la meîre, mée il était trop ta : y avait déjà du papiermarqué d’piné.
MARIENNE (
hochant la tête).
C’est un mariage qu’on doute pour le bonheur...
LE FERMIER
Ah ! pargué oui !... Véyons... dé d’quai qu’c’est qu’un gâs d’guiâbecomme çà ! I bouévait à tire-la-rigole, i virvouchait d’coin etd’autre, pâssait ses dimanches au bastringue, éioù qu’i mangeait toutç’qui pouvait gangner. I n’était bon qu’à bricoler : i bougonnait poul’z’uns, et sceillait pou l’z’autes !... Et son peîre don ! c’était unfeîgnant qu’allait ès couesmes en été, et à la rêchée àl’arrieîre-seîson, mée l’pus souvent en l’véyait bîlander dans lesfermes, un méchant balluchon sus l’dos. La meîre était à li r’véni :eune vieuille souille écrignée, eune petite boscotte qui chantaitcopinette à tout l’monde...
ALEXANDRINE
C’est qu’i n’est point c’mode l’gâs Toussaint quand il est en vind’chien ; i n’fait pas bon veni environ li. I vous ergarde dé coin ovéses yeux égarouillés et sa goule pleine dé braue.
MATHURIN
I s’assagira p’tête bin, astheu qué lé v’la marié et à la teîte d’uncommerce.
LE FERMIER
Ouai !... Ça qu’ira beîtôt à la dérive ; (
solennellement) avant trasans i sera déculotté, c’est mai qui vous l’dis.
ISIDORE
Atout ! Atout ! t’es fiambé !
MICHEL (
avec humeur).
Gna rin qui m’fait deu comme dé jouer ové des cartes neuves, gna pasmoilien d’les feîre téni dans mes douégts... A toué d’feîre.
VALENTINE
Moman !... Célestin m’a pris ma dône, i m’griche des dents et n’faitqué d’mé rebaubigner.
CÉLESTIN (
bas à Valentine).
J’té vas fiche eune souffe, méchante couineuse.
MATHURIN
Mée, à preupos, dites-mai don, j’avez changé d’domestique ?
LE FERMIER
Ah ! pargué oui. Il était si tellement beîtasse qu’il airait fini parnous mette ava-les-chemins.
LA FERMIÈRE
En n’la jamée battu pa la teîte pour eîte trop fin.
LE FERMIER
Ténins, j’allez vais. L’autré jou, j’l’envéyis au Mesle vende eune demes vaches, j’savez bin, la ribauguieîre, çté-là qu’était toujous enchasse ?
MATHURIN
C’était eune beîte pourtant bin empessée, oul avait eune belleapparaissence.
LE FERMIER
Bin oui, ou donnait co d’bons mochons... J’dis don au gâs avant qu’in’quitte : « Méfious d’la j’ment, oul est poureuse, faut s’guetterd’ové lai. » Lé v’la parti quant et la bagnole, la vache attachéedrieîre. Oui mée, m’n’ami, v’là-t-i pas qu’i rencontrit eune muète ! Laj’ment s’appeurit et déboulit à fond d’train. Au lieu d’la r’téni ovéles guides, l’gâs perdit l’estrémontade et s’mit à jûper : Bourdez-là !Bourdez-là ! Oui mée, ou n’sarr’tit point, ou daguait tous ceutes-làqui v’laient l’apprécher. Quand la vache vit çà, j’pensez bin, oudonnit un bon coup d’saquet, câssit sa longe et prit du pu battu àtravès les champs. Pis, enfin, la j’ment allit dauber amont un abre etbardaud ! vl’à la voiture berlin l’envès et l’gâs chû dan un mouciau aufin fond d’un abréout.
MATHURIN
En v’là-t-i du négoce !
LE FERMIER
Il avait biau giguer et crier hario, i n’pouvait point sorti déd’là-dedans. Hureusement, qu’un homme qui pâssait l’long d’un champl’entendit cusser et geigner, li j’tit un carriau, et l’défit del’abréout. Il était grandement temps, l’gâs commençait à eîteasphyqué... Ma carriole est grugée, les r’sorts crochis et eune rôed’berzillée... Aussi, quanté j’vis arriver l’gâs ové la j’ment quiboîtait bin bas, j’étais furé. Chongez don qué, pas quinze jous avant,oul avait été servie pa l’chéva pêchard à Zidore, à dix francs du saut !
HENRI (
à Célestin).
Tu vais bin ces jerquiers là, qui sont sus m’n’épaule ! Bite-z’y donpour vais !... J’t’en dépite bin, p’tit pastre, p’tit calard.
CÉLESTIN
Grand trîte !
HENRI
P’tit dénicheus d’gueîpes !
CÉLESTIN
Grand épierreus d’biques !
RENOTTE
Les v’là co qui s’entechiénassent, ces mauvais trains-là ; i sontincarnés !... Si j’happe un scion, va y aver du défécit...
LA FERMIÈRE
Allons, v’là qu’il est bintôt meînuit... j’vas v’z offri eune idéed’goutte pour trinquer. (
Elle verse du cassis à tout le monde, sauf àson père).
HONORÉ
Heu... heu...
LA FERMIÈRE (triomphante).
Véyous comme i n’entend quette, l’vieux gourmand !...
HONORÉ
Heu... heu...
LA FERMIÈRE
Y a tras heures qué tu devrais eîte couché. Quand en est ancien, en vapus tôt qu’çà dans sa guenasse.
MARIENNE
Allons, les hommes, finissez votre jouerie... Faut qué j’nous lévionsd’main dépétrominette : l’affranchisseus vient au p’tit jou ennyer nosnorturiaux.
LE FERMIER
A vote santé, la compagnie !... (
Aux joueurs) Eh bin, j’espeîre quéj’en avez fait du brit !...
ISIDORE
En s’est amusé à plein.
MATHURIN (
ouvrant la porte).
L’iau pîsse en bonne vérité, et i fait un vent infoucable !
MICHEL
J’ai d’bons sabiots-à-botte et des talonnettes ; avec çà en n’a paspeus d’la patouille.
LOUISON
Les gorgettes de ma gouline vont eîte faîtes dé c’temps-là !
LA FERMIÈRE
Attendez un brin ! J’vas vous préter un parapi qui n’est pasconséquent, bin sûr, mée qui peut co bin servi.
TOUS (
aux fermiers).
A vous r’voi !
LA FERMIÈRE
Bonne nuit et guettous bin d’vous engâser dans les augnieîres.
CÉLESTIN (
à Valentine).
T’as la mite !
(Il s’enfuit).
Dans le lointain.
RENOTTE (
à son mari).
Combin qu’tas gangné à soi ?
ISIDORE
A pu prée rin.
RENOTTE (
soupçonneuse).
T’as perdu, j’parie ?
ISIDORE
Rin, pour dire.
RENOTTE (
impatientée).
Combin ? Combin ?
ISIDORE (
la tête basse).
Tras centimes.
RENOTTE (
furieuse).
J’té défends dé r’jouer, entends-tu ?
______
NOTE :
(1) Le fermier veut dire que l’adlaisi, c’est-à-dire le paresseux, atoujours bon appétit ; que s’il néglige ses instruments de travail, ila grand soin de son couteau de table. ~*~
LE PRÉ DES MARETTES
_______
PERSONNAGES
_____
MARIN, propriétaire, fiancé de Marguerite............................. MM.CHARRON.
THOMAS................................... GANGNON.
HENRI....................................... Le petitGIROD.
MARGUERITE........................... Mlle EmiliennenGIROD.
La scène se passe dans un chemin du canton de Courtomer (Orne).
Cette pièce a été représentée pour la première fois àSaint-Michel-de-la-Forêt, le 14 juillet 1906.
SCÈNE I
MARGUERITE (
entre et pose ses seaux par terre)
C’est tout d’même un rude méquier qué ç’ti-là d’eîte dans l’feîsantvaloir !... En a eune ouvrage dé chien : c’est les vaques à tirer,c’est la soupe ès aôutrons, c’est les beîtes à affourer, qu’ça n’enfinit en conscience pus. Aussi çà m’fait rudement dauner quandj’entends les bourgeoîses dire comme ça tertoutes : « Sont-i hureux lesgens d’la campagne, i z’ont l’solei, i z’ont d’bonne air, i z’ont tout,quoi ! » Eh bin, vingt gueux ! qu’ces belles dames viennent don là,ovec eune devanqueîre et eune méchante gouline sus la teîte, feîre àmanger ès cochons avant qué l’jou n’sait l’vé !... Çà s’rait quioquechose à vais !... Quiens ! dé qui don qui descend là-bas ava la côte?... en dirait qu’ça s’rait Marin, mon pertendu... ah pargué, c’est li; il est bin facile à reconneîte ové sa goule dé coin et sa barbicherousse... ; en dirait quasiment d’un homme des bois !... Y a pas moyend’eîte eune miette tranquille sans qué c’grand adlaîsi n’sait rarrivélà à m’égausser de ses dîries... (
Avec un soupir). Ah, si c’étaitThôdore !... en v’là un bon june homme, et adret, don ! c’n’est qu’eunevoix dans la commeune pou l’alôser. I sait labourer qu’çà fait pleîsi,i fauche étonnamment bin, i chârrie sans bourder et herse dé finpremieîre... Oui, mée, i n’a pas éiou planter l’daigt d’bout, i n’a pasun liâs fendu en quate !... C’est bin pour ça, malhureusement, qu’popan’sé soucie pas qué jé m’marie d’o li... Mée, quai don qu’est d’vénumon p’tit freîre ?... il est sûrement dans quioque racoin à serrer desporions ou des pinvères... Henri ! Henri !
(
Elle sort) .
SCÈNE II
MARIN (
entre et cherche de tous côtés).
Par éioù don qu’oul est coulée ?... oul était là tout-à-l’heu... Ah !v’là ses siaux et son carcan, ou n’est pas loin... ou va bin surer’véni. Assiessons-nous en l’attendant... Qu’i fait don chaud à soi,j’sue à d’gout !... Jé n’sais pourtant pas trop pouillé, j’n’ai qu’mach’mise et eune biouse minabe... J’crai, en bonne vérité, qu’j’airaismieux fait dé m’téni sus la bancelle qu’est d’vant not’porte à r’garderbavoler les souris chaudes, ou bin à lire l’Code des Lois... Mée,véyons, ruminons à not’affeîre. Tant pus qu’j’y chonge tant pus quéj’crai qué j’sais volé !... Les bons comptes font les bons amis, s’pas? i n’est point défendu d’vais quair dans ses carculs. Comment qu’çàs’fait qué l’père Thomas n’donne que 500 pistoles à sa fille ! C’est iça qu’est louche !... J’voudrais co bin saver dans queul endreit qu’ila mis ç’qui r’vient à Margrite du côté d’sa meîre... Faudra qu’çatrouve, dame ! Il a co l’air bin r’nârré l’bonhomme, j’ai pasgrand’fiance dans li... Si l’biau-peîre n’était point co trop bastant,si n’vêquissait point trop vieux !... mée c’est qui va bin, mâtin !...Faudrait qué jé m’z’aise dé saver sans feîre sembiant d’rin, s’i n’apoint quieuque méchante maladie qu’en n’connaît point ; ça n’s’raitpoint étonnant... il est un brin puissant... Ah dame oui ! sis’n’allait comme qui diraît l’année qui vient, l’affeîre n’s’rait pointmauveîse : son pré des Marettes bordâille mon couchis, j’abats la haieet j’ai l’pus bel herbage du pays... C’est égal, j’crai qu’sans ç’prélà, qui m’convient d’fin premieîre, j’airais d’mandé la fille à Jérôme.Oul aira tout plain dé d’quai, lai, son peîre est potrineîre et sameîre n’a pas la vie à deux jous : c’est l’pus biau parti du cantond’Courtomer... Ah ! v’là Margrite...
SCÈNE III
MARGUERITE, MARIN
MARGUERITE
(
A part.) Jé n’sais pas ç’qu’est d’vénu Henri ; il est sûrement partid’vant, il aira pris pa l’raccourci...
MARIN
Bonjou, Margrite, ça va-t-i commé j’vélez ç’té r’lévée ?
MARGUERITE
J’étes bin honnête, Marin, ça va d’un cherme... et vos gens ?
MARIN
Ma meîre est toujous bin mal. Dedpis quieuques jous, i li passe commeça des dolaisons dans l’côté qui la font tant souffri, qu’en n’s’rait ybiter sans la feîre crier. Oul a itout un fichu mal de teîte !... pasmoyen d’clôre d’eil... oul a des lans qui li tapent dans l’tempe sanspour dire décesser... C’est eune méchante pâssée pour nous.
MARGUERITE
Dé quai qu’les méd’cins en disent ?
MARIN
N’mé caôsez pas des méd’cins, i n’y connaissent goutte. L’z’uns disentqu’oul a les pomons attaqués et l’z’autes qu’oul a quieuque chose déméchant en d’dans qui l’a mine...
MARGUERITE
Li donnent-i des r’mèdes ?
MARIN
Ah pardé oui, i z’ordonnent des tas d’portions à n’en pus fini. Untour, c’est d’l’obélisque des Carmes sus des nosses dé sucre, un autec’est d’la salade dé magnésie, un aute c’est des sangsures !... C’estbin du coûtage, allez, et ça m’crucifie quanté j’vai qu’toutes cesdrogues-là n’l’empêchent pas d’toûte à longueu d’jous et d’nuits qu’çala rend déconnaissabe.
MARGUERITE
Pauv’ bonne femme, oul est bin accidentée !... Véyez-vous les gensgrossiers, qu’ont comme ça trop d’corporence, i z’ont toujous quieuquechose... Mée ça s’pass’ra p’tête.
MARIN
Jé n’crai pas, oul est bin usée ; oul a tant travâillé et tantécolomisé durant sa vie... (
On entend pleurer un enfant.)
MARGUERITE
Quiens ! c’est mon freîre !... Quai qu’il a core à cointer... il est cochû, j’parie...
SCÈNE IV
LES MÊMES, HENRI
MARGUERITE
Eh bin, té v’la propre, vilain pâssier, t’es tout dés’nâillé !... Eioùqu’t’as core été t’couler ?... Ta culotte est toute fin pleine décanillée ?
HENRI
Jé n’l’ai pas fait par exprès : j’vélais aveinde un nic dé mêles susl’bord du russiau, j’ai guissé ava l’âri et...
MARGUERITE
Tais tai, p’tit nâs, ton gilet est tout étaussé ; t’as tiré si fo d’susqué l’bouton d’en bas a emporté la goulée... tu mérit’rais bin qué j’tédouelle, ça s’rait bin emplié !... Quai qu’t’as core à encenser commeça... vas-tu fini ? j’té vas bintôt fiche eune quiaque pa l’coin d’lateîte ; j’eîme pas qu’en reîsonne, entends-tu ?... Allons, sauve-tai àla meîson qué jé n’té vée pus... En ahanne bin à l’téni propre, il esttoujous sale comme un mouciau. (Henri sort.)
SCÈNE V
MARGUERITE, MARIN
MARIN
Il est rude c’pétit gas-là !
MARGUERITE
Oui, mée il est bin endemné, c’est un vrai déluge !... En a biaul’régencer et l’housser, qu’ça n’l’empêche pas d’couri l’guérou ava lesch’mins comme s’il avait l’feu quioque pa.
MARIN
Dé quai qué j’vailez, les maigniers çà qu’à l’guiâbe dans l’côrps. J’aiitout un p’tit freîre qu’est bin malgesté, eune véritable mouvette ; in’fait qué d’berdasser, y a pas moyen dé l’téni. Ah ! i nous coûte chaid’entréquin, il est si usurier !
MARGUERITE
I sont tous comme çà, l’z’éfants, ça n’fait qué d’goguer et d’rûcher ;i n’savent en conscience quai s’inventionner pour hager leux hardes...Mée, si on s’assisait sous ç’fouquau-là ?... J’ai amonté l’chemin ovédeux siaux d’lait qu’j’en sais tout essavée... i fait si chaud !
MARIN
Les banvoles sont d’amont, j’é n’n’avons core pour quieuque temps déç’sec-là.
MARGUERITE
Bin sûr, mée si ça continue en s’ra obligé d’érusser. Y en a déjàqu’ont commencé, à preuve qué l’coureux d’pouches, qu’est v’nu qu’rinot’ monnée à matin, nous a dit qu’à l’aître des Noës, i n’ont pus nid’herbe ni d’iau.
MARIN
C’est la miseîre !
MARGUERITE
Pargué oui, l’ergent né r’soudra co pas ç’t’année... Avous seulementdes pommes par cheux vous ?
MARIN
Y en a et y en a pas... eune demi-année, quoi !... Jé n’n’avionspourtant eune belle appareîssence ç’printemps.
MARGUERITE
C’est pas comme chez nous, alors, y en a comme du souï, les branches encouellent ; nos solages sont tout à fait chanceux... Mée, à preupos,dites-mai don eune affeîre qui m’pâsse... c’est-i-vrai qu’en a fait lavendue à Miché ?
MARIN
C’est bin vrai, en a tout vendu, poil et bourre.
MARGUERITE
Jé n’y étons allés pièce, j’n’en savions rin en tout. En v’la-t-i eunedrôle dé chose ! dé qui qu’airait dit qu’ces gens-là mangeaient leusbien ! Quand j’ai ouï conter ça, j’en sais restée toute jugée.
MARIN
Quai qué j’vailez, y avait un gaspi là-d’dans... tout était j’té ad çàya d’là ; la femme était trop enhâsée et l’homme feîsait des tasd’commerces...
MARGUERITE
Trente-six méquiers, trente-six miseîres !
MARIN
Commé j’dites, faut mieux né s’guermanter qu’d’eune ouvrage et la feîrebin... Miché était un brin amuseux, à ç’qu’en dit, i s’bouessonnait dû,et qu’même qu’i parée qu’sa ménageîre et li n’cordaient gueîre ensemble.
MARGUERITE
Ah !... Çà c’est-i co bin vendu ?
MARIN
Ouai ! J’ai ajeté eune vaque amouillante, et une aute fraîche vêléequ’a un père manifique, pour quarante-cinq pistoles, c’est pour rin...Jé n’m’en livrerai qu’la s’maigne qui vient.
MARGUERITE
Oui, mée, s’i n’allaient point v’ler vous les livrer astheu ?
MARIN
J’leus envéyerais eune lettre du juge dé paix, v’là tout ; j’connais laloi, leîssez feîre.
MARGUERITE
J’étes pas c’mode à ç’qué j’vai, j’étes core bin haricoquier, j’eîmezles procès à c’qué j’ai ouï dire pa l’z’uns pa l’z’autes.
(
Ils se lèvent et se promènent.)
MARIN
Bin, vingt gueux, faut s’marier pou s’feîre atteler... Haricoquier, mai? c’est trop fort ! jé n’sais core allé qu’dix-sept fois d’vant l’jugedé paix et j’ai bintôt vingt-six ans !... Mée, j’sais comme toutl’monde, comprenez bin, j’eîme pas qu’en m’fasse to d’eune centime.Quand l’fis à Pierre pâssit dans mon hivernage, j’n’avais-t-ipointl’drait d’li d’mander des dommages-intérêts ?... Quand Louis tirit susiun d’mes lapins, qu’i prénait pour un lieuve, fallait-i point qué j’léleîsse tout bontivement égoïner mes avéras ?... Sarché nom dé d’là, çàs’rait tout d’même innocent !...
MARGUERITE
J’entends bin vot’ affeîre, mée quai qu’ça v’s a rapporté ?
MARIN
Cent sous d’dommages et c’était bin juste.
MARGUERITE
Bin sûr, mée j’avez dépensé pour ça eune vingtaine dé francs !... Etl’procès qu’j’avez d’ové Lambert, d’en par éiou qu’j’en étez ?
MARIN
Queu procès ?
MARGUERITE
Comment, est-ce qué j’n’avez point iu d’procès d’o li ?
MARIN
Si, deffet, j’en ai même iu... tras... oui tras... duquel qué j’vélezcaôser ?
MARGUERITE
Dé çtite-là ousqu’en parle d’eune poule.
MARIN
Ah oui, mée c’est fini y a biaux jous. Mon affeîre était raide bonne,c’est en vérité vrai. Lambert a eune hâ qui bordâille mon couchis,comprenez bin. V’là-t-i pas qué l’jou d’la foueîre de Courtomer, desmillauds, qui jouaient de la bouzine, perdent eune poule câille, quéçté poule vient ponde dans la hâ et qu’oul a des p’tits au boutd’quioque temps ! Lambert pertendait, li, qu’la couvée et la pouled’vaient li r’véni, pasqué les poulets étaient v’nus sus li. j’liréponnis tout uniment « qué jé n’vlais point bacicoter d’ové li, quéj’détestais les procès, mée qu’si v’lait garder tout, fallait qu’im’paye les dégâts », pasqué, comprenez bin, la poule avait fait,d’aller-t-et d’véni, eune grand sente dans mon couchis, et qu’oum’avait bin fait perde 200 bottes de foin pour lé moins. I n’v’litpoint et j’allîmes dévant l’juge de paix : i gangnit ; je m’ostinis eten allit à Alençon.
MARGUERITE
Et j’avez gangné.
MARIN
Pargué non ! Figurous qu’en li donnit reîson et qué j’fus obligéd’payer à l’avoué 20 pistoles et six sous.
MARGUERITE
Bin, v’là eune poule, qui v’z a fait feîre du ch’min et qui v’z a coûtégros !...
MARIN
Séyez tranquille, j’n’eîme pourtant point les procès, mée i m’paiera ça: à force dé plaidâiller, j’finirai bin par y aggrimer un seillon deson champ.
(
Ils sortent).
SCÈNE VI
THOMAS (
appelant.)
Margrite !... Margrite !... Hou !... Hou !... J’ai biau la houterdedpis eune grand’demi-heure d’horloge qué j’n’entends rin m’réponne...(
Cherchant)... Y a co bin d’l’espôsition à pâsser dansl’z’herbages... les tauriaux ballonnent par moments... (
Il rit.) Ahj’avais bin to d’m’émâyer, j’l’apercieus là-bas qui chape ové son bonami ; oul est bin gardée, j’n’avons qu’à nous en r’tourner cheuxnous... Mée, j’y chonge, pourquai don qu’Marin vient toujous latrouver, comme ça à la quittée, quand ou r’vient d’tirer les vaches,c’est co bin drôle, çà. N’peut-i point licaôser à la meîson ?... Fautcresre qué ç’qui li dit est bin ségret... Si jé m’coulais pa là quioquepa pou l’z écouter quand i vont rapâsser... Véyons, p’t’ête qu’enbrochant à través l’z épignes, j’pourrais m’accouver drieîre la hâ...V’la justement eune pétite coulée... (
Il essaie de pénétrer.) Eh ! çafonce par là... pis les gians et les cherdrons m’consomment les mains,y a d’quai s’péri... Eh pargué ! qué j’sais simpe, gna qu’à griperamont ç’t’abre-là et à s’hûcher ové les chahouts et l’z épivars...Essayons et tâchons dé n’point feîre la couplette... (
Il grimpe.)Ceutes-là qui m’verraient chatonner à mon âge, diraient qué j’saisbettelé, i m’tireraient en poltrait pour lé certain... Allons bon, v’làdes cherpleuses qui m’dévallent dans l’cou... Ouf ! mé v’la toutd’meîme arrivé... I n’s’agit pus qué d’bin s’gencer, pou n’pointdécrucher... Mettons-nous à caliberda sus la grosse branche... là...j’sais tout-à-fait à mon amain, j’sais comme un co dan un pagnier... Ilétait grand’ment temps pasqué les v’là qu’arrivent...
SCÈNE VII
MARGUERITE, MARIN, THOMAS
MARGUERITE
Avous été à Saint-Lomer ?
MARIN
Dame oui, et qu’même j’ai parlé l’greffier. J’y ai dit : « Jdaism’marier ové la fille à Thomas, j’viens vous prier à seul fin quéj’nous banîssiez-je. » Ça s’fait pas comme ça, qui m’réponnit enriochant, faut d’abord qué j’veniez-je à quant et l’peîre d’la future,et pis qu’aprée jé m’fournissiez-je un tas d’papiers pour vous marier àl’officier.
MARGUERITE
C’est bin des affiâs !
MARIN
Pardé oui, et c’est coûtageux... mée j’espeîre bin qu’vot’ peîre enpayera sa part.
MARGUERITE
Jé n’mé soucie pas d’ces affûts-là, j’v’z’en arrangerez çtasoirant ovépopa... Dites-mai don, airous beaucoup d’nociers d’vot’ côté ?
MARIN
Oui, eune tapée, soixante personnes pour lé moins ; en n’sé marie pastous les jous, jé n’régarde point à la dépense, mai !
MARGUERITE
C’est qu’ça vous cout’ra gros !
MARIN
(
A part.) Quai qu’ou dit co là ? (
Haut.) Comment, c’est-i pointvot’ peîre qui pâss’ra la noce ?
MARGUERITE
I pâssera la noce, bin entendu, pasqué vos gens n’sont point résouds,mée les frais sont à même el marié, c’est comme ça partout.
MARIN
(
A part.) Aïe !
THOMAS
(A part.) Y a d’la trompe dans tes carculs, mon gâs.
MARGUERITE
Seulement, comme j’airons pus d’nociers qu’vous, popa a dit qui n’vlaitpoint qué j’payiez-je pour nos parents et nos amis ; j’li donnerezsimplement 100 sous par personne qué j’aménerez quant et vous... Oh !popa n’est pas r’gardant, ç’n’est bin sûr pas la moiquié dé ç’qué çacoût’ra.
MARIN
C’est bin arrangé comme ça... (
A part.) A c’prix-là j’n’amènerai pasgrand monde.
MARGUERITE
Véyons, disez-mai au juste ç’qué j’sérez ?
MARIN
Pas tant qué j’créyais, j’n’ai pus gueîre de parents, j’sais binesseulé...
MARGUERITE
Mée, j’avez des amis, des voisins ?
MARIN
Bin oui, j’pensais bin à mon-à-part inviter Marion, l’peîre et la meîreClément, les Duval, les Gervais, mée ma fai j’viendrai tout seu ové monp’tit freîre, qui s’ra garçon d’honneur ; i pass’ra bien par susl’marché, li, un éfant, quai qu’ça mange !... J’donnerai don cent sousà vot’ peîre... à moins quin’mé fasse l’honnesteté dé m’nourri l’joud’mes noces.
THOMAS
(
A part.) J’crai qu’j’ai iu to d’m’affroquer dé ç’t’homme-là...
MARGUERITE
Ça sembler drôle, p’t’ête bin, si j’n’avez point pus d’monde...
MARIN
Ma fai, tant pire ! Les langueteries n’mé dérangent point ; j’nousmarions, s’pas, ça né r’garde personne. Et pis, aprée tout, j’n’aiqu’des voisins qui m’enquineraient l’instant d’aprée qué j’leus airaisfait feîre la noce pendant deux jous d’affilée. Les voisins,véyez-vous, jé l’z’abomine : en n’en chomme point quand j’êtes dans lajoie, i n’déculent pas d’cheux vous, i mangeraient tout c’qué j’avez ;mée s’i vous arrive du malheu... à r’voi bernique, tout çà débouinecomme des pâsses !...
MARGUERITE
Enfin, dé quai qué j’vélez qué j’vous dise ?... J’verrez ça d’ové popa,j’sais bin assez occupée environ ma toilette. Faut qué j’prenne latâilleuse au moins pour huit jous, oul a deux robes à m’coûte : c’estl’cochelin d’marraine !
MARIN
La belle happe ! ça n’fait jamée qu’eune soixantaine dé francsd’gangnés.
MARGUERITE
J’étes tout d’même innocent, eune soixantaine de francs ?... Créyouspar hâsa qué jé m’mettrai sus l’dos des robes dé popeline ou d’orléanse? En en caôserait à pus d’quat’ lieues à la ronde... Pou l’jou desnoces, j’airai eune robe de soie verte et un bonnet monté d’ovec desribans roues. L’lendemain, j’mettrai eune robe câille à relles bleues.Tout ça coûte bin 350 francs.
MARIN (
avec stupeur)
Tras cent cinquante francs !..... Mée, oul est folle vot’ marraine,fallait bin mieux qu’ou vous donne tras cent cinquante francs d’ergentblanc... (A part). Aprée tout, ça m’est égal, pas un lias à débourser.
MARGUERITE
Touton Octave donn’ra l’live dé messe et tétan Louise un châle qu’oun’a porté qu’eune fois et qui n’a nu mal. J’véyez qu’ça fait déjà euneécolomie conséquente... I n’vous rest’ra pus qu’les orreries.
MARIN
(
A part.) Aïe ! (
Haut.) Des orreries !... J’voudrais bin saverpourquai feîre ! J’avez pas bésoin d’orreries pour aller à lamangeâille, j’avez pas besoin d’orreries pour tirer les vaches.
MARGUERITE
Ça s’peut, mée j’veux des orreries, c’est l’habitude...
THOMAS
(
A part.) Est-i avaricieux !.... C’est bin la meîre toute crachée !
MARIN
Véyons, Margrite, éiou qué j’vélez qué j’pêche l’ergent pour ajetertout çà ?
MARGUERITE
Avec ça qué j’n’étes pas soutu, j’avez bin deux mille francs d’rentes.
MARIN
Jé n’dis pas mée véyez-vous, j’ai ouï dire bin des fois à défeu mongrand-peîre qu’il était aussi malaisé d’garder son ergent qué d’laganger... Véyons, à combin qu’ça peut r’véni vos orreries... Oh ! c’esthistoueîre de saver...
MARGUERITE
Une bague et des pendants d’oreilles pour commencer... mettons 30 écusl’un dans l’aute.
MARIN
(
A part.) Aïe !
MARGUERITE
Une broche, vingt écus à pu prée...
MARIN
(
A part.) Aïe !
THOMAS
(
A part.) Çà li fait rondi lé z’yeux, çà !
MARGUERITE
En peut bin aver la monte et la chaigne pour 15 pistoles.
MARIN
Et pis aprée ?
MARGUERITE
Mée, c’est tout.
MARIN
Non, fallait pas vous geîner, j’pouviez continuer, en vait bin quéj’parlez d’affeîres qué jé n’payez point.
THOMAS
(
A part.) C’est li qui fait noir !... Bisque-t-i ! Bisque-t-i !...
MARGUERITE
R’merquez bin qué jé n’parle point du meube ni du linge, c’est popa quiles donne ; çà qu’a coûté pus d’quinze cents francs. Aussi, séyeztranquille, j’n’airons ni bâquaux ni chiffes.
MARIN
(
A part.) Quinze cents francs ! I devient innocent, l’bonhomme, jél’f’rai interdire : il airait bintôt mangé toute la bricolle. (
Haut.)J’disiez don qu’ces orreries-là s’émontraient à eune... trentaine défrancs ?
MARGUERITE
Bin pusché qu’ça... mettons 30 écus, pis 20 écus, pis 15 pistoles, çafait... 30 pistoles, j’crai...
MARIN
Véyons, Margrite, n’séyez don point si éfant !... Chongez don qu’trascents francs à cinq du cent çà fait 15 francs d’rentes ! Quinze francsd’rentes par ci, quinze francs d’rentes par là, en finit par enaigripper mille. T’nez, jé n’veux point bacicoter, leîssez-mai feîre,jé n’vous en r’pentirez point : j’vous donn’rai des orreries moinscheîres et qui f’ront bin pus d’effet. Ainsi, l’aut’jou, à l’assembléed’Sainte-Escolasse, j’ai vu des orreries qu’étaient si belles ! sibelles !! qu’en n’n’avait des béluettes dans lé z’yeux rin qu’à lesr’garder. Pour 4 francs, en avait eune broche manifique, pour 20 souseune bague d’ové des diamants. Tout ça r’luisait, malheur ! cent foispus qué d’l’or vrai.
THOMAS
(
A part.) Des orreries d’Villedieu, quoi !
MARIN
Allons, c’est-i entendu ? Tapez dans la main, j’vous ajét’rai tout ça àSées, la s’maigne qui vient, en m’nant deux coureux à la foueîre.
MARGUERITE
Non, non, j’veux d’vraies orreries ou j’en restons d’en par éiou !
THOMAS
(
A part.) J’ai bin envie d’l’affronter.
MARIN
Allons, n’vous fâchez pas, j’vous donn’rai tout ça, pisqué jé l’vélezabsolument : (
à part) en rattrap’ra ça d’un aute côté. (
Haut.) Mée,pou c’qui est d’la monte, leîssez-mai vous donner celle qui m’est v’nued’mon onque. En vl’à eune rude monte ! C’est pas comme ces méchantsaffûts qu’en vend anuy, des montes lerges comme des pièces de 40 souset qu’enporte toutes les s’maignes cheux l’orfeuve ; la monte déd’cheux nous, véyez-vous, en n’n’a plein la main, ou pèse bin deux bonshectos et on l’entend marcher du mitan d’la cour ! En v’là eune monte !oul a des r’sorts solides, lai !...
THOMAS
(
A part.) Grand cro, va.
MARGUERITE
Allous m’éluger comme ça longtemps ? j’vous dis qué j’veux toutflambant neu... ou bin aguieu l’mariage.
THOMAS
(
A part.) Oul est d’mauveîse himeur, ou n’est pas facile àramarrer !
MARIN
J’nétes gueîre révérende à c’qué j’vai... Eh bien ! ramissons-nous,j’airez tout ç’qué j’demandez, mée jé n’lé dirai pas cheux nous : momanf’rait les cent dix-neuf coups, ou mé r’mancerait, ou m’agonîseraitd’mauveîses reîsons !... Mée, jé m’promettez d’bin écolomiser pourr’gangner çà ?
MARGUERITE
Séyez tranquille, j’savez qué jé n’sais point malaucurieuse et quéj’connais l’feîsant valoir. N’caôsons pus d’ergent, ça m’fait tropmarronner, et pis, allez, l’ergent n’fait point l’bonheur.
MARIN (
riant.)
L’ergent n’fait point l’bonheur !... Ah ! ah ! çtite-là qua dit çan’avait point volé l’Saint-Esprit dans s’n’église.
MARGUERITE
J’lai pourtant ouï dire par des gens riches qu’étaient tout pleinsavants.
MARIN
Pargué, i l’contaient pour consoler ceux qui n’ont rin, créyez-lé bin.Mée, malgré ça, j’sais un brin d’leus sentiment, et la preuve, c’estqué j’sais à même tous les jous d’la fille à Jérôme, qui s’ra bin riched’ici quioque temps.
MARGUERITE (
vexée.)
La fille à Jérôme ?... Bin oui, parlez-mai de çté méchantegestieîre-là, oul est belle, ma foi ! eune petite nabotte.
MARIN
Son peîre li mettra dix mille francs sous chaque pied, ça la grandira.
THOMAS
(
A part.) Véyez don comme i s’crampe !... I lève la teîte comme un coqu’est effalé.
MARGUERITE
Oul est rousselée comme un œu d’dinde, oul hacquetonne, oul estcalorgne...
MARIN
Hein qu’ou n’bîcle point quand ou dort à côté d’ses écus !
MARGUERITE
Oul est maline comme un mouron.
MARIN
Çà s’peut bin, mée oul est forte, allez ; ou monte sans s’geîner eunesomme dé grain d’la cour dans l’grégnier, qu’çà peut feîre l’écolomied’un domestique : c’est à considérer...
THOMAS
(
A part.) I n’connaît gueîre les nouvelles : la fille à Jérôme estmariée dé ç’t’arrieîre-seîson.
MARIN
Mée, n’caôsons point d’çà, nous v’là à la quittée, l’co du quiocher atourné dedpis eune pause, i pourrait co bin chais d’l’iau d’acquard.
MARGUERITE
Çà s’rait pas une affeîre : en s’mettrait en tapis sous ç’fouquau-là.
MARIN
Mée, si preumier qué d’s’en aller cheux vous, j’chantions core eunefois la
Chanson d’la Mariée ? (1)
MARGUERITE
J’veux bin, mée dépêchous... mettous là-bas en face dé mai... là...bin... J’fais la mariée, comme dé juste, et j’sais comme qui diraitassise sus la selle au haut d’la table. Vous, j’faisez les garçonsd’honneu, qui sont dehô ovec lé joueux d’violon... C’est à vousd’commençer.
MARIN
De l’île de Bourbon,
Nouvelle mariée,
Nous venons sans façon
Chanter votre hyménée.
MARGUERITE
Jé n’mettez gueîre sus l’air.
MARIN
Ah dame ! jé n’sais pas chanter en musique, mai.
THOMAS
(
A part.) Ah pargué non, i beugle comme un viau qua la teîte prisedans un échellier.
MARGUERITE
Ecoutez-mai... (
Accentuant la cadence.)
Messieurs jé n’connais point
Ni vos chants ni vous-mêmes,
Pâssez votre chemin
Je vous en prie moi-même.
MARIN
Dites don, Margrite, jé n’sais pas si jé m’trompe, mée i m’semble quévot’peîre a bin mauveîse mine dedpis quioque temps !
MARGUERITE
Mée non, il est bin courbaturé par ci par là, mée çà n’l’empêche pointd’aller à son ouvrage.
MARIN
N’a-t-i point quioque étourditions ?
MARGUERITE
Ma fai, non.
THOMAS (
furieux.)
(
A part.) J’ai bin du mal à mé r’téni.
MARIN
Allons, tant mieux, j’sais bin aise dé saver ça... C’est qué j’l’eîmebin vot’peîre, un si bon homme !... Mée, quel âge qu’i peut bin aver ?
MARGUERITE
Il aira cinquante ans à la Mont-Carmel.
MARIN
Qué çà ? Ah bin ! i n’est point trop ancien.
THOMAS
(
A part.) Il a sûrement envie dé m’détruire.
MARGUERITE
J’n’étons point près dé l’perde. Guieu merci ; il est d’eune familleousque vêquit vieux : son peîre est mo à quatre-vingt-quatorze ans...
THOMAS
(
A part.) C’est ça qu’est envéyé !... Mets-çà dans ta poche et tonmouchoué par dessus.
MARGUERITE
Sa meîre, lai, est morte à quatre-vingt huit ans et core pasqu’oulétait chute dé sa hauteur.
MARIN
(
A part.) Mâtin d’mâtin ! j’sais volé comme dans l’fin fond d’un bois.
MARGUERITE
Mée, éioù don qu’j’en étons restés d’not’chanson... C’est à vous dér’prenne, j’crai...
MARIN
Avant dé nous r’tirer...
MARGUERITE
J’vous dis qué jé n’mettez point sus l’air.
MARIN
Quai qué j’vailez, j’ai la teîte un brin dure pour apprenne deschansons, c’est tout comme pour danser, j’n’ai jamée pu mettre eunejambe dévant l’aute.
THOMAS
(
A part.) J’ai bin envie d’li feîre danser la malaisée, mai !...
MARIN
Avant dé nous r’tirer,
Madam’ la Mariée,
Permettez-nous d’chanter
Votre heureus’ destinée.
(
A part.) C’est tout d’même un biau parti la fille à Jérôme, sonpeîre est potrineîre et sa meîre n’a pas la vie à quat’ jous...
MARGUERITE
Chantez, Messieurs, chantez,
La société s’empresse
A bien vous écouter,
Je vous en fais promesse.
(
A part.) J’ai-ty un drôle dé bon ami ! I n’m’a s’ment pas coreembrassée dedpis qu’il est là... Oh ! si c’était Thôdore !
MARIN
Vous vivrez très longtemps
Sans peine sur la terre,
Et votre époux constant
Sera doux et sincère.
(
A part.) Faudrait qué j’véye si l’bonhomme n’a point l’cou un brincourt...
MARGUERITE
Continuez de chanter,
Chevaliers qui voyagent,
Puisque vous connaissez
Les dons du mariage.
(
A part.) C’est-i malhureux qu’Thôdore n’ait pas un brin dé d’quai!... Sans ça, pardi, popa voudrait bin.
MARIN
Dès l’âge du berceau,
Votre ange tutélaire
Vous prépara l’anneau,
Aussi le diadème.
(
A part.) Sans l’pré des Marettes qui fait rudement mon affeîre...
MARGUERITE
Vous nous comblez de biens
De vœux et de richesses,
Et vos doux entretiens
Nous mett’ en allégresse.
MARIN
L’Eglise vient de bénir
Votre union époux tendres,
Et vous garde à venir
Des richess’ abondantes.
(
A part.) Si son p’tit freîre n’était point là, j’n’airais point cotrop à m’plainde, mée bin qui n’saye haut comme rin, i casse sanss’geîner les pièces dé cent sous pa l’mitan (2).
MARGUERITE
Le ciel soit adoré,
Les anges et Dieu lui-même
Et vous qui prédisez,
Soyez bénis de même.
MARIN
Vous tous qui contemplez
Votre jeune épousée,
Priez-là de bonté
Qu’elle nous permett’ l’entrée.
(
A part.) Si l’peîre Thomas vêquit jusqu’à quatre-vingt-quatorze ans,j’n’étons point près, malhureusement, d’abattre la hâ qui nous sépare.
MARGUERITE
Entrez, Messieurs, entrez,
Partagez notre fête,
Car vous le méritez,
Sans savoir qui vous êtes.
MARIN
En vous remerciant
Madam’ la Mariée,
Oui nous allons entrer
Pour vous voir couronnée.
MARGUERITE
La d’sus j’entrez dans la meîson et j’chantez l’dergnier couplet.
Salut, respect, honneur,
Oh ! société aimable,
Nous entrons de grand cœur
Pour vous y voir à table.
THOMAS
Bravo l’z’éfants, j’chantez d’fin premieîre, j’en r’montrez, pour lécertain, ès curouges et ès mésigues.
MARIN
(
A part.) J’parie qu’i nous aiguettait, l’vieux finassier.
MARGUERITE
Hélà ! qué l’Guiâbe n’sait pas d’ses tours ! v’là popa qu’est huchédans l’fin haut d’un fouquau ! Mée quai qu’tu fais don, as-tu envie dét’péri ?... J’en sais en frague !...
THOMAS
J’vélais dénicher des pupus, mée l’nic est enhaï... N’aie point poux,va, j’vas bin descende, j’sais core soupe... (
Il descend lentement.)
MARGUERITE
Prends bin garde dé décroûler... n’mets pas ton pied sus d’méchantssicots surtout... eh ! la branche berdance... l’corps m’en trute...
MARIN
T’nez, peîre Thomas, happez don la branche qui balle... là... sousvous, et pis leîssez-vous guisser tout doucétrment... V’lous qué j’vousainde ?
MARGUERITE
J’en fruble !...
THOMAS (
prenant son élan.)
Une..... deusse..... (
sautant à terre) et mé v’là.
MARGUERITE
En v’la-t-i d’eune dévignée d’aller griper comme çà dans lé z’abres!... Ça qu’avient bin à un homme de ton âge.
MARIN
Boujou, peîre Thomas, comment qu’j’allez à soi ?
THOMAS
J’vas l’guiâbe, Marin... J’sais justement content d’vous vais, j’aiquioque chose à vous dire qui va vous feîre pleîsi... (
A Marguerite.)Tai, va vais à la meîson si j’y sais... leîsse tes siaux, j’vasl’z’emporter. (
Bas.) Fais dire à Thôdore que tu s’ras sa femme dansquioques jous ; j’f’rons les accords dimanche.
MARGUERITE (
bas, à Thomas.)
C’est-i point eune attrappe, c’est-i point pour mé feîre enrager ?...Non ?... oh ! qu’t’es bon, popa. (
Elle l’embrasse avec effusion etsort vivement.)
SCÈNE VIII
THOMAS, MARIN
THOMAS
Dame oui, Marin, j’vas vous dire eune affeîre qui va bin voussurprenne... j’vas profiter du mariage dé Marguerite pour feîre meslots !
MARIN (
stupéfait.)
Ah ! j’allez feîre vos lots !... (
A part.) Mâtin ! si l’pré desMarettes allait m’échapper...
THOMAS
Véyous, jé m’sais dit à mon à part : « Jé n’mé soucie pas qu’mes éfantss’entechiénassent aprée ma mort à preupos de mon bien, et pour ça gnaqu’un moyen c’est d’feîre les lots. »
MARIN
J’sais tout à fait d’vot’ sentiment, mée pourrious m’dire à qui quér’viendra l’pré des Marettes... C’est histoueîre dé saver, j’pensezbin...
THOMAS
Les Marettes sont dans l’lot d’mon p’tit gas Henri.
MARIN (
à part.)
J’l’avais bin dit qué j’s’rais volé ! Comment feîre pour mé tirer déd’là ?
THOMAS (
riant.)
(
A part.) Il est au d’zo !
MARIN
C’est qu’çà change l’z’affeîres ça, peîre Thomas ; si j’avais iu lamoinde doutance qué l’pré des Marettes n’mé r’vienne point un jou àv’ni, j’crais bin qu’en n’sé s’rait point entendu ès accords.
THOMAS
C’est bin ç’qué j’ai pensé, et la preuve c’est qu’il est v’nu anuy ungas m’demander Margrite et qué j’l’i ai promise tout de suite... Is’conviennent on n’peut mieux. J’leus donne la ferme qué j’ai à deuxlieues dé d’là, pasqué, véyez-vous, les gens qu’y restent astheu laleîssent tomber en démence.
MARIN
(
A part.) Bin, si j’m’attendais à ç’coup d’temps là... (
Haut.) Mée,j’avez fait ça un brin à-la-va-vite, peîre Thomas, j’vous l’dis sansfâche, j’airiez co bin pu m’en caôser, en airait p’t’ête pu s’entende.
THOMAS
Ouai, c’était gueîre possibe, pasqué les Marettes n’iront jamée àMargrite.
MARIN
J’mentirais si j’disais qu’les Marettes n’mé conv’naient point.Pourtant, j’regrette bin qu’not’mariage saye manqué, j’airais étéhureux d’eîte dé vot’famille... mée dès l’instant qu’les Marettes...(
A part.) Mé v’la tiré, Guieu merci.
THOMAS
Consolous, allez, i n’chomme pas d’filles à marier dans l’pays...
MARIN
É sont co pu râles qué jé n’créyez.
THOMAS
Râles ?... ah ! bin oui, j’en connais eune masse, mai.
MARIN
J’voudrais co bin saver éiou qué j’les prénez ?
THOMAS
Y a d’abord la fille à Frédéric, eune belle ménageîre, dûre àl’ouvrage, écolome...
MARIN
Ou f’rait bin mon affeîre, ç’té-là, mée dites-mai don... a-t-é d’quai ?
THOMAS
Ah ! dame, pour ça non.
MARIN
C’est ennuyant... quelles sont l’z’autes dont j’vélez parler ?
THOMAS
Y a core la fille à Thôphile... En v’là eune belle fille ! Faut vaiscomme les gâs la r’luquent quand on sort dé la messe !... En dit qu’oulest bin travâillante et qu’ou conneît s’n’affeîre.
MARIN
J’en sais assez. Du moment qu’oul est gentille et qu’on s’conneît èsbeîtes, j’vas aller la d’mander dé ç’pas ; ou d’meure tout prée déd’la, j’crai... Mée, dites-mai don, a-t-é dé d’quai ?
THOMAS
Ou n’a pas grand chose.
MARIN
C’est ennuyant... en connaissous co d’autes ?
THOMAS
Y a itout la nièce à Bazile, la plus forte créature dé la contrée, oupèse au moins deux cents.
MARIN (
émerveillé.)
Deux cents ! Bou d’la, queue belle garcette... par éiou don qu’ou reste? Jé n’connais gueîre l’pays, c’est pas ma tirée.
THOMAS
A la ferme des Lasserons, j’savez bin là-bas sus la côte, en tirant ducôté d’Moulins.
MARIN
J’irai la vais dès demain. (
Il serra la main à Thomas.) Merci, peîreThomas, j’m’avez trouvé mon affeîre, à r’voi, et portous bin...(
Revenant sur ses pas.) Mée, dites-mai don, a-t-é un brin dé d’quai ?
THOMAS
Ou n’a qu’ses dix daigts.
MARIN
C’est égaussant.
THOMAS
Pourquai qué j’n’allez point d’mander la fille à Jérôme... j’en étiezpourtant rud’ment entiché à ç’qué j’ai ouï dire... Çà ! ou n’est pasbelle, ou n’est point c’mode nitout, mée oul est ergentée ; son peîrevient d’mouri et sa mère est bin bas.
MARIN
(
Vivement.) Ah ! son peîre est mo !... Je n’sais pas si jé m’trompe,mée m’est avis qu’c’est l’plus biau parti du canton d’Courtemer.
THOMAS
C’est en véricotte vrai, les autes filles n’bossent gueîre auprée d’lai: c’est d’la grandeur... Mée, si j’la v’lez, courez vite, on n’daitpoint eîte à chomme dé bons amis... c’est amicablement qué j’vous l’dis.
MARIN
Eh bin, j’irai dès d’main matin au p’tit jou..... I s’fait tard, peîreThomas, j’vas m’ensauver, j’n’eîme point nuitâiller sus les routes. Ar’voi et bonjou cheux vous. (
Il s’éloigne.)
THOMAS
A vous r’voi et bonne chance.
(
Il prend les seaux et sort.)
THOMAS (
revenant.)
Marin !... Marin !...
MARIN
Quai qu’y a ?
THOMAS
T’nez, jé n’sais point méfaisant, j’vas vous dire, c’était euneattrape...
MARIN
Quai qu’j’entendez dire par là ?
THOMAS (
en s’éloignant peu à peu.)
La fille à Jérôme est mariée dedpis 8 mois et jé m’sais laissé direqué, dans ç’moment-ici, ou cherche un parrain. (
Il disparaît enriant.) Ah ! ah !...
MARIN (
furieux.)
Mille milliasses dé sort, j’sais bringé !
_______
NOTES :
(1) Cette chanson est très connue dans l’arrondissement d’Alençon, oùelle est encore dite à la campagne, dans la plupart des repas de noces.
(2) C’est-à-dire que la naissance de cet enfant nécessitera le partagede la succession paternelle.
BONUS :
Le mal de Saint (1913), nouvelle en parler bas-normand de Pierre de Hertré (pseud. de Charles Vérel)