Corps
| MAUPIN (17..-17..) : Essaisur l'art defaire le vin rouge, le vin blanc et le cidre Avec des vues pour laplantation de la Vigne en Normandie & dans quelques autres de nosProvinces septentrionales.- Paris: Chez Musier, MDCCLXVII. [1767].- 104 p. ; 18,5 cm. Numérisation du texte : O. Bogros pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (05.IV.2012) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros]obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées, à l'exception des slongs qui sont restitués. Texte établi sur l'exemplairede laMédiathèque (Bm Lx : Norm 742). 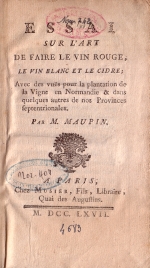 ESSAI SUR L’ART DE FAIRE LE VIN ROUGE, LE VIN BLANC ET LE CIDRE ; Avec des vuës pour la plantation de la Vigne en Normandie & dans quelques autres de nos Provinces septentrionales. PAR M. MAUPIN A PARIS, Chez MUSIER, Fils, Libraire, Quai des Augustins. M. DCC. LXVII. ~*~PRÉFACE. L’ART de préparer les boissons naturelles, & surtout le vin, estencore si incertain, & cependant si important en tous pays à laconservation des hommes, qu'on ne peut mieux faire que de s'occuper dusoin d'en éclaircir & fixer les vrais principes. C'est le but queje me propose dans cet Essai. Pour y parvenir avec ordre, je commencerai par deux observationspréliminaires ; l'une sur les défauts du commun de nos vins, &l'autre sur les manières de les faire, les plus usitées ; ensuite dequoi, après avoir remarqué l'insuffisance & le préjudice de cesdernières, je proposerai en partie, d'après mes expériences, deuxMéthodes nouvelles, dont la seconde convient non-seulement au vinrouge, mais encore au vin blanc & au cidre. Tous ces objets, avecdes vuës sur l'introduction de la Vigne en Normandie & dansquelques autres de nos Provinces septentrionales, seront la matière desquatre Chapitres qui composent cet Ecrit. ESSAI SUR L’ART DE FAIRE LE VIN ROUGE; LE VIN BLANC, ET LE CIDRE. CHAPITRE PREMIER. Défauts du commun de nos Vins. SI on excepte nos Provinces les plus méridionales, unpetit nombre deVignobles, & quelques années assez rares, tous nos vins, fauted'une suffisante maturité, ont dans leur primeur, & souvent bienau-delà, le défaut d'être verds, & jamais moëlleux : au contraire,épais ou non, ils sont maigres, ont peu de substance propre, & parconséquent ne sont ni corsés, ni vineux. On ne peut pas dire non plusqu'ils ayent du feu ; ils ne donnent point à l'estomac de chaleursensible ; souvent même, suivant les années & les cantons, ils fontcruds, froids, lourds & indigestes. Pour ce qu'on appelle saveur,parfum, bonne odeur, vertu balsamique, en un mot tout ce qui annonce& constitue essentiellement un bon vin, un vin gracieux &vraiment bienfaisant, ce sont des qualités réservées à un petit nombrede vins choisis, mais dont les vins communs sont entièrement privés. Tels sont en général, indépendamment des défauts particuliers attachésà certains Vignobles & à certains usages, les vins destinés à laconsommation de la plus grande partie de la Nation. Parmi nous, cequ'on entend par bon vin, les vins d’une bonté absolue, sont fortrares, même aux meilleures tables : c'est une vérité reçue de tout lemonde. Il est pourtant vrai que dans les années favorables, c'est-à-dire, dansles années où la maturité est parfaite & bonne, comme en 1753 &1762, les vins dont il s'ait sont beaucoup moins défectueux ; maiss'ils sont plus substancieux & moins verds que dans les annéescommunes, il s'en faut bien cependant qu'ils ayent les autres qualitésqu'on devroit en attendre : ils sont généralement beaucoup tropcouverts & chargés, faute d'une suffisante fermentation, d'unehuile grossière ; ce qui les rend gros & lourds, sans saveur, &disposés, suivant la manière dont ils ont été faits, à graisser ou àtrancher, c'est-à-dire, à noircir par la trop grande abondance desparties colorantes & leur désunion d'avec la liqueur. A l’égard de nos grands vins & de ceux de nos Vignobles les plusméridionaux, j'en dirai un mot dans le quatrième Chapitre. Ainsi, fansm'y arrêter dans celui-ci, je vais, dans le suivant, donner une idéedes manières de faire le vin les plus usitées, CHAPITRE II. Des diverses manières de fairele Vin rouge. A En juger par l'excellence & la grande utilité duvin, par le prixque tous les hommes y attachent, par le goût & souvent la passionqu'ils ont pour cette liqueur, par l’usage habituel & fréquentqu'ils en font ; à en juger, dis-je par toutes ces considérations, lapréparation du vin ne doit plus depuis long-temps laisser rien àdésirer pour sa perfection ; & les défauts que nous venons deremarquer dans la plus grande partie de nos vins, ne peuvent êtreregardés que comme les vices d'une nature ingrate & indomptable.Voilà ce qu'il est tout naturel de croire, & cependant ce qui n'estpas. On pourra s'en convaincre par le compte que je vais rendre desdiverses façons de faire le vin. Dans les Vignobles des environs de Paris, à mesure que la vendangearrive de la vigne, où elle a été écrasée peut-être au quart, on ladécharge dans la cuve. Dès le premier jour, ou au plus tard dès lesecond, lorsque la cuve est au quart ou au tiers, on fait un levain oufond de cuve ou autrement dit, pour tremper la grape & prévenir parce moyen le goût qu'elle pourroit donner au vin pendant lafermentation, qui précède le foulage, on entre dans la cuve, & on yfoule ce qui s'y trouve de raisins. On continue de mettre sur la mêmevendange pendant trois ou quatre jours, quelquefois pendant six ousept, & plus ; ensuite de quoi, quand le vin a bien bouilli, &que la cuve est bien échauffée, on foule, bien ou mal, toute lavendange, que l'on porte au pressoir au bout de douze ou vingt-quatreheures de foulage, plus ou moins. Dans cet intervalle, & même auparavant, on rabat la cuve àplusieurs reprises ; c'est-à-dire, qu'on ouvre & retourne àdiverses fois le marc, qui par-là se trouve exposé successivement àl'air dont d'ailleurs on ne prend aucun soin de le garantir, l’usageétant de ne point couvrir les cuves. Cet usage, sans doute, est unabus, & très-grand ; mais, comme on a pu voir, il s'en faut bienqu'il ne soit le seul. On peut en remarquer sur-tout deux principaux. Le premier consiste en ce que la cuve n'étant point couverte, d'uncôte, les parties les plus essentielles du vin, l’air surabondant, lefeu & les esprits s'en échappent continuellement ; & del'autre, l’air ambiant ou externe frappant & pénétrant sans cessedans la liqueur, la refroidit, & ralentit la fermentation toujourssi nécessaire, & quelquefois si difficile, singulièrement dans lesannées tardives. 2°. Une partie considérable de la vendange ayant presqu'entierementfait son effet lorsqu'on foule, lorsqu'on acheve l'écrasement total desraisins, il en résulte que la fermentation se faisant à deux fois, enest beaucoup moins forte ; ce qui n'arriveroit pas si on fouloit touten même tems, ou du moins, qu'au lieu d'entrer plusieurs fois dans lacuve avant le parfait foulage on se bornât à ce qu'on écrase devendange pour le transport de la vigne au cellier : on éviteroit encorepar-là les inconvéniens peut-être encore plus grands, qu'entraîne lefoulage même dans les circonstances où on le fait : le marc & lemoût agités, soulevés & exposés alternativement à l'air dans toutesleurs parties, un ou plusieurs hommes qui se baignent pendant une heure& plus dans un liquide déjà en feu, & souvent au plus hautpoint de son ébullition, on conçoit que tout cela doit dépouiller laliqueur de ses parties spiritueuses, & par conséquent ne peutqu'être très-contraire à la qualité du vin & à la fermentation :c'est ce que j'ai toujours éprouvés singulierement en 1763. Dans cette année tardive & remarquable par la verdeur des raisins,ma cuve, quoique couverte d'une manière imparfaite, étoit brûlante& bouilloit avec emportement lorsque je la fis fouler ; maisl'opération n'étoit point encore achevée, que déjà la chaleur &l'ébullition étoient considérablement diminuées : en vain j'appliquaitous mes soins pour les rétablir ; la Nature avoit été troublée dans lefort de son travail ; elles furent toujours en s'affoiblissant ; &mon vin , qui auroit pû être bon, fut verd, sans couleur & sansqualité. Tels sont les défauts essentiels de la manière dont on fait le vin,non-seulement aux environs de Paris, mais encore, à quelquescirconstances près, peut-être dans la Champagne, ou plutôt dans la plusgrande partie des Vignobles du Royaume. Quant à ceux où les usages sont différens dans quelques-uns, comme dansle Pays Laonnois & dans le Berry, on foule plus ou moins,& chacun à sa manière, les raisins à mesure qu'on les apporte de lavigne, & ensuite on les jette, égrapés ou non, dans la cuve où onles laisse, sçavoir, dans le Pays Laonnois, comme aux environs deParis, & dans le Berry, huit & quinze jours, & souventau-delà. Dans les autres, ou au moins dans une partie de la Franche-Comté, quandla vendange commence à bouillir, on a soin de la fouler avec les piedsjusqu'à ce qu'on s'apperçoive qu'elle se refroidit, après quoi on labat dessus, jusqu'à ce que le vin soit fait ; le vin, couvert de sonmarc, reste dans la cuve pendant un mois ou six semaines, au boutduquel tems, quand il est bien clair, on le tire. C'est-à-dire, quedans la Franche-Comté on fait le vin exactement de la même manière donton s'y prendroit ailleurs pour empêcher qu'il ne se fît. Dans tous lesautres Vignobles, le vin est, à peu de chose près, le seul ouvrage dela Nature : en Franche-Comté il est le pur ouvrage de l'Art : mais quelArt ! A l’égard des visages du Pays Laonnois, du Berry & autresVignobles, ces usages sont défectueux. 1 °. En ce que le foulage, quoique beaucoup plus parfait dans certainscantons que dans d'autres où on y apporte très-peu de soin, esttoujours insuffisant : une partie des raisins,& sur- tout les moinsmûrs, c'est à-dire, ceux qui sont les plus difficiles à écraser, &qui cependant, pour fermenter, auroient le plus besoin de l'être,échappent dans l'opération du foulage, & restent dans leur entier :d'où il arrive, par les raisons qu'on peut voir dans le Chapitresuivant, que le vin en a moins de qualité, & que dans beaucoupd'années il est très-verd. 2°. L'ébullition du moût se faisant à mesure qu'il est exprimé, &le foulage des raisins à l'arrivée de la vigne durant souvent pendantquatre & cinq jours de suite, & même plus, il s'ensuit qu'uneportion du moût qui se trouve dans la cuve au bout de ce tems, ayantdéjà perdu une partie de son air & de ses esprits, l'ébullition& la fermentation de la totalité doivent être beaucoup moins fortes: c'est ce que j'ai éprouvé cette année, du moins quant à l'ébullition,d'une manière bien sensible. Ma vendange ayant été bien égrapée & parfaitement foulée à mesurequ'elle arrivoit au cellier, la cuve qui la contenoit fut couverte ledeuxième jour au soir, tout aussi-tôt qu’on eût cessé de jetter dedans.Le marc étoit à neuf pouces du fond de dessus, & ne s'est pointélevé depuis, tandis que dans le même cellier, une petite quantité devendange qui ne faisoit par la douzième partie de celle de la cuve,mais qui avoit été égrapée & foulée & couverte en moins d'uneheure, s'étoit élevée au bout de douze heures de près de six pouces.C'est une expérience sur l'exactitude de laquelle on peut compter. Il en résulte bien clairement que la vendange de la cuve, lorsqu'on l'acouverte, avoit déjà fait, par rapport à l’ébullition, sinon tout soneffet, du moins la plus grande partie ; ce qui ne seroit sûrement pasarrivé, si ce que j'ai avancé étoit moins vrai, que l'ébullition dumoût se fait à mesure qu'il est exprimé. Cette vérité est prouvée d'unemanière, ce semble, encore plus simple & plus directe par une demes expériences en 1765. Ayant choisi un quarteau bien conditionné, je le fis emplir, à un seauprès, de moût tiré de raisins qui venoient d'être écrasés à l'instant.Je le bondonnai légèrement. Au bout de six heures, ce moût. quis'étoit déjà fait jour par quelques jointures des douves, s'élançoit ensiflant & menaçoit les fonds. Je voulus lever le bondon ; mais ille fit sauter, & jaillit très-haut ; il s'en perdit un seau. 3°. Outre les abus sur lesquels j'ai particulièrement insisté, il y a,& c'est à la vérité par-tout, il y a, dis-je, dans les procédés dedétail de tout ce qui appartient & entre dans la façon du vin, unefoule d'inconséquences & de contre-tems dont résultent lesinconvéniens les plus préjudiciables à sa perfection : c'est ce qu'ilme seroit facile de démontrer ; mais je me borne aux remarques que j'aidéjà faites, & à observer que dans tous les Vignobles du Royaume,les divers usages de faire le vin se rapportent, à quelquescirconstances près, à ceux que je viens de discuter, & seressemblent tous en un point, qui est de ne point couvrir la vendange.C'en est plus qu'il ne faut pour prouver que tous ces usages, loin depouvoir corriger ou tempérer les défauts de nos vins, doivent aucontraire être regardés comme en étant la cause principale &souvent la seule. On peut concevoir par-là combien toutes ces pratiquessont nuisibles, & de quelle conséquence il est à tous égards d'enintroduire de meilleures : c'est l'objet que je me propose dans lesdeux méthodes que je vais présenter dans les deux Chapitres suivans. Laderniere de ces méthodes est sûrement la plus parfaite ; mais peut-êtretrouvera-t-on la première plus pratiquable. CHAPITRE III. Première Méthode defaçonner le Vin rouge. PAR les rapports sous lesquels je me suis borné àmontrer l’insuffisance & les abus des pratiques que je viensd'examiner, par les raisons que j'ai données de ces abus, il est aiséde prévoir mes principes sur la manière de faire le vin, & de jugerque j'en fais dépendre la perfection du haut degré de la fermentation& de la conservation des parties spiritueuses, & en outre del'air interne surabondant. Que la fermentation soit nécessaire & essentielle à la façon duvin, ou plutôt que ce soit elle seule qui fasse le vin, c'est ce qui nepeut faire l'objet d'une question. La difficulté est de sçavoir quelest le degré le plus favorable de cette fermentation ; mais pouréclaircir ce point, aussi important qu'il est peu connu, il fautd'abord commencer par s’entendre, & on ne le peut que par ladéfinition exacte & précise de la chose même. Je dis donc que lafermentation dans le cas présent, est l'action par laquelle la Naturetravaille à désunir les principes du moût pour les réunir ensuite dansune nouvelle proportion. Or cette désunion & cette réunion dontrésulte le nouveau mixte, c'est-à-dire le vin, je le demande, quelsinconvéniens la raison & même l'imagination peuvent-elles faireappercevoir dans leur perfection, ou, pour mieux dire, quels avantagesl'une & l'autre ne doivent-elles pas en faire attendre ? Si ladésunion des principes est nécessaire pour leur nouvelle réunion,n’est-il pas naturel de croire que plus celle-là sera parfaite &plus celle-ci le sera. aussi, & par suite le mixte qui en est lerésultat ? N'est-il pas plus que probable que plus les principes dumoût seront désunis, & plus la partie huileuse & les autressubstances, terrestres ou non, seront dégagées, atténuées &exaltées, & qu'ainsi le vin en sera plus substancieux, puisqu'aumoyen de la parfaite atténuation, il restera dans la liqueur beaucoupde parties, qui, sans cela, se seroient précipitées dans la dépuration; & plus spiritueux, plus chaud, plus fort & moins verd,puisqu’à la saveur du développement, de la raréfaction & des autreseffets ci-dessus, il aura plus d'esprits & retiendra plus de soufre& plus de sels, lesquels feront d'autant moins, piquans en cas deverdeur, qu'il y aura plus d’huile pour les envelopper ? Mais quittonsle raisonnement, & venons en aux preuves que l’expérience, plussure que tous les raisonnemens, nous fournit en faveur de la plus fortefermentation ; on cessera de la redouter, & on sera convaincu detous ses avantages. En effet, les années où la maturité est la plus parfaite & où letems des vendanges est le plus chaud & le plus favorable, sontcelles où la fermentation est la plus agissante & la plus fougueuse: cependant ces années sont celles qui donnent les meilleurs vins.Preuve donc au moins que la fermentation, pour être violente, n'estpoint en soi nuisible à la qualité du vin. Dans les années communes, & encore plus dans celles qui sonttardives & froides, c'est un fait que les cuvées qui ont le plusfermentées se distinguent des autres par la supériorité de leurs vins. Ainsi non-seulement la grande fermentation n'est point nuisible, maisencore elle est la plus avantageuse. C'est une vérité dont on nes'éloigne jamais impunément dans la pratique. J'en ai fait l'épreuvetrop de fois pour pouvoir en douter. En 1761, 1763, 1764 & 1765, dans toutes ces années, mon vin, pourn’avoir pas suffisamment fermenté, pour n'avoir pas même fermentéautant que les vins du lieu, leur fut généralement inférieur encouleur, en qualité, & fut encore moins substancieux & plusverd. Au contraire, en 1766, pour avoir favorisé & forcé lafermentation par tous les moyens que j'avois imaginés alors, mon vin,par cette raison, se trouve supérieur à tous ces mêmes vins. Je puis ajouter encore que dans cette même année 1766, voulantconnoître, du moins à peu près, jusqu'à quel point la fermentation laplus étendue peut corriger la verdeur du suc des raisins, je fissuccessivement trois petites expériences, dont le résultat fut encore,comme on pourra le voir à la fin du dernier Chapitre, en faveur de lafermentation la plus complette. Toutes ces expériences, par la différence du succès qu'elles ont eu,constatent d'une manière frappante la vérité de ce que je viensd'avancer fur la fermentation, & elles doivent avoir d'autant plusde poids, qu'elles s'accordent entierement & dans tous les pointsavec l'expérience générale: ainsi les avantages de la plus grandefermentation sont établis, non (& c’est ce que je prie deremarquer) sur de simples conjectures, souvent déduites avec plus d'artque de solidité mais sur des faits positifs, directs &incontestables : or, à de pareils faits il n'y a rien à opposer. Ce n'est pas toutefois que par la distinction que je viens de faire,j'entende refuser aux probabilités le juste degré de confiance qui leurest due ; je ne les confonds point avec les preuves absolues ; maisd'ailleurs j'en méconnois si peu l’autorité, qu'à défaut d expériencesau moins personnelles, je vais en faire usage pour expliquer la causequi fait graisser nos vins. Les uns la placent dans la trop grandematurité des raisins ; les autres, dans l'excès du fumier ; & toutcela est vrai jusqu'à un certain point. Cependant en 1765, annéecommune pour la maturité, mes vignes, qui ne sont point fumées, m'ontdonné un vin qui a graissé de même que la plus grande partie des vinsdu lieu. En 1764, mon vin avoit encore pareillement tourné au gras. Ily a donc une cause autre que celles qu'on en donne ; & cette cause,qui, à bien dire, est la seule naturelle, est l'insuffisance de lafermentation, trop foible pour dissoudre l’huile la plus grossiere,l'atténuer & la combiner avec les autres substances : mais pour leprésent c'est assez avoir prouvé les propriétés de la parfaitefermentation ; traitons maintenant de la conservation des partiesspiritueuses. Pour peu qu'on se rappelle les défauts que j'ai remarqués dans nosvins, on doit concevoir combien il est important pour leur qualitéd'augmenter leur feu & leurs esprits, & par conséquent de lesleur conserver ; mais ce qui n'est pas moins nécessaire, c'est deretenir, autant qu'il est possible, dans le moût, tout l'air qu'ilcontient : on y trouve deux avantages : 1°. La fermentation en est plusforte, puisque l'air interne en est le premier agent. J'ai toujours vuque le moût commence à bouillir & quelquefois avec emportement,qu'il est encore froid, & souvent très-froid. L’air surabondant estsi nécessaire à la fermentation, que sans lui il n'y en a point, ou ily en a bien moins. L'expérience que j'ai rapportée à la pag. 15 en estla preuve ; en vain je remis dans le quarteau la même quantité de vinqui s'en étoit échappé ; en vain je le bouchai à ferme, & échauffail'air extérieur jusques au 80 & même 88 degré au Thermomètre deFahreinheit, l'ébullition ne reprit point, & le vin ne fut pas pluschaud qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il ne le fut point, & aucontraire. 2°. Si, d'après M. Hales (a),on doit regarder l'air interne surabondant comme l'esprit vital du vin,il est aisé de juger de quelle importance il est de le conserver, &par conséquent, combien les pratiques ordinaires sont préjudiciables àla qualité du vin. Que cet air surabondant, par un effet qu'on ne peut guères attribuerqu'à son ressort & au surcroît d'activité qu'il imprime, en sedébandant, aux parties les plus essentielles du vin ; que cet air,dis-je, donne au vin sa force, sa saveur & le rende plus vigoureux,c'est ce qui ne peut plus faire la matière d'une question , depuis lesobservations & les expériences qui en ont été faites & répétéespar plusieurs Sçavans, soit sur les eaux minérales spiritueuses, soitfur le vin même : ainsi, sans m'arrêter davantage sur cet objet, jevais, conformément aux principes que je viens d'établir, proposer lapremière de mes deux méthodes pour faire le vin. 1°.Pour faciliter le transport de la vendange & éviter à frais, onpourra, comme c'est assez l'usage, l'écraser à peu près au quart, soitdans des bachoux ou barillets, soit encore plutôt, lorsque cela sepourra, dans des futailles, qu'il sera toujours avantageux de couvrir :moins on écrasera la vendange, & mieux vaudra. 2°. A mesure que la vendange arrivera au cellier, on l'égraperatrès-grossierement dans des cribles faits de gros brins d'osier, dansla forme de ceux dont se servent les Maçons ; ces cribles seront posés& arrêtés sur une futaille ; un homme dans sa journée, j'en ai faitl’expérience , peut égraper de la vendange pour faire 5 à 6 muids devin de 300 bouteilles chacun. Cette opération, toujours avantageuse ,est singulièrement nécessaire dans cette méthode, à cause de l'excès dela fermentation ; autrement , il est indubitable qu'en mettant toute lagrape, le vin en seroit très-grossier & très-dur. La vendangeégrapée de cette manière, se pressure aussi parfaitement que si toutela grape y étoit. Ce fait est certain, j'en ai encore fait l'expériencecette année, quoique mes raisins fussent bien plus rigoureusementégrapés que je ne le conseille. 3°. Aussi-tôt que la futaille sur laquelle on égrapera sera pleine, onjettera la vendange dans la cave, ainsi que cela se pratiquegénéralement ; cet usage est de beaucoup préférable à celui où l'onest, dans très-peu de cantons à la vérité, de mettre la vendange dansdes tonneaux. De cette derniere maniere la fermentation estincomparablement moins forte que dans la premiere où la vendange est enbien plus grande quantité : cela s'accorde tellement avec les notionsnaturelles & même avec l'expérience générale, que je crois devoirme dispenser de rapporter l'expérience particulière que j'en ai faiteen 1764. 4°. Quand la cuve sera pleine à 4 ou 5 pouces près, ou qu'on auraentièrement cessé d'y mettre, on la couvrira légèrement avec le dessusde bois dont je parlerai ci-après, seulement pour empêcher la librecommunication de l'air extérieur, & gêner la sortie de l'airinterne. On posera ce dessus sur trois bâtons, tringles ou traverses debois d'un pouce & demi ou deux pouces d'épaisseur, fixés à distanceégale sur les rebords de la cuve. Il seroit, sans doute, bien plusavantageux de la fermer entièrement ; mais comme je ne propose deprocédés que ceux dont je fuis parfaitement sûr, ou dont j'ai moi-mêmeéprouvé l’effet, & que celui-ci n'est point du nombre, je n’ose leconseiller dans le cas où la cuve seroit pleine, dans la crainte que lemarc ou le moût soulevés par la fermentation, ne s'échappassent par lesbords de la cuve lorsqu'on la découvrira pour la fouler. Toutefois ilest probable qu'on préviendroit cet inconvénient, si, au lieu de 4 ou 5pouces, on en laissoit 7 ou 9, comme je l'ai indiqué par la RéductionEconomique (b). 5°. Dès que la cuve sera assez échauffée pour pouvoir y entrer sansdanger, on la fera fouler par un ou plusieurs hommes, suivant laquantité de la vendange ; mais plutôt par plus que moins, afin qu'étantfoulée en moins de tems, elle perde moins de son air & de sesesprits. C'est dans cette vue qu'il faut avancer le moment du foulageautant qu'il est possible. Ce foulage se fera de manière qu'il ne restepas, pour ainsi dire, un seul grain de raisin entier (c).Cette opération, qu'on ne fait le plus souvent qu'ébaucher, faute d'enbien comprendre le but, ainsi que de tant d'autres, est si essentielle& d'une telle importance, qu'on peut dire que de sa perfectiondépend celle du vin. Eneffet, si les raisins ne sont pas bien écrasés, s'ils ne le sont pastous, si, comme cela arrive si souvent, une partie des substances &des plus grossières restent encore attachées à la pellicule intérieuredu grain, comment, principalement quand la vendange, faute de maturité,est encore dure & presqu'en verjus ; quand, faute d'être développé,le suc de chaque grain est, pour ainsi dire, encore brut & fait enquelque sorte masse à part ; comment, dis-je , dans tous ces cas, lesprincipes de ces sucs pourront-ils être suffisamment désunis &raréfiés ? Comment la liqueur renfermée dans les grains qui ne sontbrisés que par le pressoir, pourra-t-elle après la fermentations'exalter, se perfectionner, s'attacher & se combiner avec le vindans lequel elle se trouve ? C'est assurément ce qu'il n'est paspossible d'imaginer : aussi, à l'exception des années les plusdistinguées par la maturité, est-ce une chose ordinaire dans nosVignobles, sur-tout lorsqu'il y a peu de fermentation, de voir des vinsfaits au sortir de la cuve, devenir doux au pressurage & verdsensuite. Nos Vignerons mêmes n'en ignorent pas la cause ; mais comme,ainsi que beaucoup d'autres, ils voyent presque toujours mal le peuqu'ils voyent, ils négligent d'en prévenir l'effet. A la suite du soulage, si le tems est froid & la vendange verte oupeu mûre, on pourra, pour échauffer la cuve & ranimer lafermentation, jetter dans le marc quatre, cinq ou six forteschaudronnées de raisins, toute bouillantes, plus ou moins, suivant lescirconstances : c'est un usage assez commun dans nos Vignobles, &dont on se trouve toujours bien. Toutefois il seroit peut-être encoreplus avantageux de ne verser ces chaudronnées que lorsque la cuve seracouverte & dans le moment même. 6°. Tout aussi-tôt que le foulage sera achevé, on couvrira la cuve avecun dessus ou fond, fait, pour le mieux, de bois de chêne, dont lesplanches de six lignes d'épaisseur seront assemblées à joints quarrés& clefs dedans, ou pour le plus sûr, à languettes. On l'entreradans la cuve de l'épaisseur de ces six lignes, & on le posera surdes tasseaux forts & bien solides. On pratiquera au milieu uneouverture ou trappe de huit ou neuf pouces quarrés, que l'on fermera& arrêtera bien : on s'en servira, soit comme je viens de le dire,pour verser les chaudronnées, soit pour voir, si l'on veut, l'état dela cuve : mais pour quelques raisons qu'on en fasse usage, on ne doitlever la trappe qu'avec beaucoup de précaution, c'est-à-dire, entournant, comme je l'ai fait moi-même, le visage du côté opposé ; sansquoi, lorsque le vin ou le marc ne touchent pas immédiatement au fondde dessus, la vapeur est si violente, qu'il iroit de la vie. A l'égard du fond, en prenant les précautions convenables, suivant laqualité du bois, pour pouvoir le retirer, quand il en sera temps, onaura soin qu'il ferme bien. On pourra le fixer avec quelques crochetsou autrement ; pour peu qu'il le soit, il le sera suffisamment,d'autant que, soit que la cuve soit pleine autant que je l'ai indique,soit qu'elle le soit moins, il n'y a point à craindre que le vin fasseaucune violence considérable au fond. Dans ces deux cas, ce n'est pointle fond, c'est le marc seul qui reçoit les chocs du liquide agité. Dans le premier cas, ce liquide se fait jour à travers le marc ; maisil est tellement affoibli dans son passage par la molle résistancequ'il éprouve, qu'il ne lui reste plus de force lorsqu'il arrive audessus du marc, qu'il couvre d'un ou plusieurs pouces, suivant que lapression est plus ou moins forte. Au moyen de ce que le clair surmonte ainsi le marc, la cuve n'exhaleaucun fumet, & pas plus d’esprits que s'il n'y en avoit point. J'aiéprouvé tous cela, sur-tout dans la derniere de mes trois petitesexpériences, & encore dans une autre que j'ai faite sur des raisinsblancs ; & que j'ai rapportée à la pag. 14. Dans le second cas, il ne s'élève au-dessus du mac que la vapeur du vin; mais cette vapeur, en quelque quantité qu'elle soit, n'a point assezd'activité par elle-même me pour forcer le fond, qui la retient : c'estce que j'ai encore éprouvé cette année. Ainsi il n'y a, comme on voit,aucun danger à fermer la cuve, & au contraire il en résulte unbien, puisque, indépendamment du reste, la fermentation en est plusforte, & que cette fermentation, indispensable à tant d'égards,l’est encore, ainsi que l'expérience le prouve, pour que le vin puissese charger du mucilage nécessaire pour lier ses principes. On sedonnera donc bien de garde de la troubler en découvrant la cuve, soitpour arroser & humecter le marc, soit pour la rabattre avec despilettes, ou autrement : au moyen de ce qu'il est couvert, cesopérations de l’usage ordinaire seroient d'autant plus déplacées ici,qu'elles sont absolument inutiles, le marc étant toujours humide, lorsmême qu'il n'est point surmonté du clair. Mais ce n'est pas seulementdepuis, mais encore avant le foulage, qu’on doit s'abstenir entièrementd'entrer dans la cuve & de toucher à la vendange : égrapergrossierement les raisins, les jetter dans la cuve sans les écraseraucunement, les fouler comme je l'ai marqué, verser les chaudronnéesdans le cas où elles seroient nécessaires, couvrir parfaitement la cuve; voilà exactement tout le travail qu'exige la façon du vin jusqu'aumoment où on le tire. Tout ce qu'on feroit au-delà ne pourroit qu'êtrepréjudiciable. 7°. Quand le vin sera fait & ferme au point où on le désire, on letirera pour l'entonner, ou plutôt, quoique par circonstance je ne l'ayepas fait moi-même pour mon vin de cuvée, on le laissera dans la cuvesans la découvrir jusqu'à ce qu'il soit froid ; on peut être assuréqu’il ne tardera pas à se refroidir de lui-même : j'ai pour garants dece que j'avance les deux dernieres de mes trois petites expériences,& celle sur le raisin blanc : dans cette derniere, le vin qui étoitchaud & bouilloit encore à six heures du soir, s'est trouvéparfaitement froid le lendemain à cinq heures du matin. Quand la Naturea fini son premier travail, elle fait une pause & ne passe pointsans interruption de la première à la seconde fermentation. D’ailleurs pour accélérer le refroidissement du vin, on peut en tirerpar la canelle une douzaine de seaux, plus ou moins, suivant la forcede la cuvée ; & quand ils seront froids, on les versera dans lacuve par la trappe ; mais d'une manière ou d'une autre, il est toujourstrès-important, dans ma Méthode sur-tout, de prendre le vin à froid ;on évite par-là qu'il ne se décharge d'une partie de son airsurabondant, comme il est arrivé au mien cette année. Au bout de douzeheures qu'il avoit été tiré, il bouilloit encore ; néanmoins comme ilétoit fait & clair, il n'a presque point jetté. Ce n'étoit point lafermentation qui s'achevoit, ainsi que cela se voit souvent, c'étoitl’air surabondant qui cessant d’être aussi comprimé qu'auparavant,faisoit effort pour s'échapper, & soulevoit avec bruit la liqueurencore un peu agitée par un reste de chaleur. Quoi qu'il en soit, quand le vin sera froid on le tirera dans destonneaux, cuves ou foudres, selon l'usage des lieux. Plus les vaisseauxseront grands, & mieux le vin se conservera. Tout aussi-tôt quecette opération sera faite, on portera le marc au pressoir. Le vin depressurage, à í'exception de celui des trois premières tailles, seramis à part, à moins qu'on ne veuille faire, comme c'est la pratique laplus générale, qu'une même sorte de vin, un vin parfaitement égal :mais celui des dernieres tailles étant plus grossier, il est à croirequ'il diminuera un peu de la qualité de l'autre. 8°. A mesure, ou du moins dans le jour même que le vin sera entonné, onbouchera, comme je l'ai fait, les tonneaux, qui d'ailleurs serontemplis jusqu'à l’ouverture, avec des feuilles de vigne couvertes detuileaux. On garantira le vin de l'air extérieur ; mais il estnécessaire qu'il soit tenu fraîchement dans tous les tems, &principalement jusqu'à ce qu'il soit bien dépuré. Au bout de six ouhuit jours, & quelquefois moins, on bondonnera les tonneaux àdemeure : on aura grande attention de remplir le vin aussi souventqu'il en sera besoin, c'est-à-dire deux fois par jour tout au moins,jusqu'à ce qu'il soit bondonné, & ensuite tous les huit joursjusqu'à la Saint-Martin : depuis la Saint-Martin jusqu'en Janvier ouFévrier, tous les quinze jours ; & après ce temps, tous les mois auplus tard. On le tirera de dessus sa lie pour le mieux au mois deDécembre, & pour la seconde fois dans le courant de Mars. Avec ces dernieres attentions, aussi naturelles qu'elles sont peucommunes, on assurera à nos vins un degré de qualité qu'ils aurontacquis par la nouvelle Méthode que je viens de proposer pour les faire.Cette Méthode, sans doute, ne les rendra pas si parfaits qu'ils nelaissent rien à désirer ; mais ils en auront moins de défauts, &plus de qualités. Il est vrai que dans cette Méthode encore plus que dans toute autre, levin fera surchargé d'une très-grande quantité de particules colorantes,d'où il semble qu'il doit être plus grossier & plus lourd : maisoutre que dans le Royaume il y a beaucoup de Vignobles qui, raison ounon, s'accommoderoient fort que leurs vins fussent plus couverts, c'estque d'un côté pour sauver ce défaut à nos vins, il ne seroit rien moinsque raisonnable de les condamner aux autres défauts beaucoup plusgrands qu'on évite ; & que de l’autre, au moyen de la parfaiteatténuation des substances & de la conservation des partiesspiritueuses,& notamment de l'air surabondant, les vins, quoiquetrès-chargés en couleur, seront encore plus délicats, plus légers &plus coulants qu'ils ne le sont dans aucune des diverses manières deles faire. Mon vin en est la preuve : ainsi, relativement au défautmême dont il s'agit ici, & qui sûrement n'existera nulle part dansdes années tardives, la pratique que je propose est encore préférable àtoutes les autres. Mais comme il n’y a rien de si bon qui souvent ne puisse être .mieux,& que, quelque parfaite que soit la fermentation dans la Méthodeque je viens d’indiquer, elle le sera encore plus dans la seconde quej'ai annoncée, je vais, dans le Chapitre suivant, présenter cettederniere, avec mes vues pour l'introduction de la vigne dans lesProvinces où elle ne se cultive pas. CHAPITRE IV. Autre Méthode pour fairele Vin rouge, & en outre le Vin blanc & le Cidre ; avec desvues pour la plantation de la Vigne dans les Provinces où elle nese cultive pas. LESprincipes que j'ai établis dans le Chapitre précédent sur le foulage& la fermentation, étant plus que suffisans avec les expéiencesdont je les ai appuyés, pour démontrer l'importance de ces deux objets,sans les reprendre de nouveau, je vais exposer le plan que je crois leplus favorable à leur perfection. 1°. Le transport de la vendange au cellier se fera ainsi que dans lepremiere méthode & par la même raison. Dans celle-ci non plus quedans l'autre, je n'entrerai dans aucun détail sur ce qui regarde lafaçon des vendanges ; mon dessein n’est point de rien apprendre à cetégard ; tout le monde sçait que le choix des raisins, leur plus grandematurité (d), le temsfavorable pour les cueillir, que tout cela contribue beaucoup àla perfection du vin. 2°. A mesure que la vendange arrivera au cellier, on la déchargera dansla cuve sans l'égraper, & on se donnera bien de garde de la foulerou l’écraser en aucune manière, quand bien même on mettroit dans lamême cuve pendant 5 ou 6 jours & plus : on ne doit point craindreque le marc s'échauffe & s'aigrisse faute de moût pour trempersuffisamment. Dans la première de mes trois petites expériences, mesraisins, quoiqu'ils ne fussent point écrasés peut-être au quart, sontdemeurés pendant 10 jours dans la bachou sans être foulés, &cependant il ne leur en est arrivé aucun accident. A la vérité, il nes'est point passé de jour que je ne les aye arrosés ; mais la nouvellevendange dont on rafraîchira journellement la cuve, (car je suppose,comme cela doit être, qu'on y mettra sans interruption,) doit tenirlieu & au-delà de ces arrosemens ; ainsi on est libre de s'endispenser ; toutefois on peut se tranquilliser en tirant par lacanelle, quand on le jugera à propos, plusieurs seaux de vin qu'onjettera dessus le marc. Au reste, moins on mettra de tems à composer une cuvée, & mieuxvaudra: si elle étoit faite en 2 jours, ou plutôt encore en un, le vinseroit beaucoup plus parfait qu'il ne peut l'être en la faisant, commeil n'arrive que trop souvent, en 4 & 5 jours, & quelquefois en6. Il est certain qu'une si grande longueur ne peut qu'êtrepréjudiciable. On peut en voir les raisons au Chapitre II. pag. 13. Ilrésulte de ces raisons que jusqu'au parfait foulage ou au pressurage,il est très-important de n'écraser de raisins que le moins qu’il estpossible. 3°. Lorsque la cuvée sera achevée, on tirera le moût, & on porterala vendange au pressoir le plutôt qu'il sera possible ; toutefois uneheure avant, & pas plutôt, on fera, non pas entrer dans la cuve,car rarement seroit-elle dans ce moment assez chaude pour cela, mais fouler & écraser toute la vendange avec des pilettes (e),& on la pressera fortement dans les mains ; on employera à tous cesprocédés 3 ou 4 hommes de ceux que l'on aura retenus pour lepressurage. L'objet de ce foulage & de cette pression est dedétacher de l'écorce des raisins les particules colorantes pour enformer la couleur du vin. A l'aide de cette opération bien exécutée& du pressurage, on peut être assuré, à moins que le blanc nedomine absolument trop, d'avoir un vin, sinon noir, du moins suffisamment coloré & d'un rougequi, vû la grande fermentation, se soutiendra vraisemblablement mieuxque dans l'usage ordinaire. J'ai éprouvé cette année dans toutes mesexpériences que la pression seule, quand elle est bien faite, donne aumoût, avant même la fermentation, une très-btelle couleur de vin. Quoi qu'il en soit, immédiatement après cette opération & letirage, on portera, sans différer, le marc au pressoir pour y êtreécrasé. 4°. A mesure que le moût exprimé des raisins, sera apporté du pressoir,on le mettra, ainsi que celui qu'on aura tiré, dans une cuve qui, outreces cerceaux ordinaires de bois, sera revêtue & assurée par troisbons cercles de fer, dont un à chacune des deux extrémités, & letroisième au milieu : en en mettant quatre, on pourroit se passerentièrement de cerceaux de bois. Et, comme pendant cette opération, quine peut jamais être faite trop diligemment, le moût ne pourroit quesouffrir d'être exposé à l’air, on aura soin, avant de la commencer, decouvrir la cuve, comme dans l'autre Méthode, avec un fond de bois,& on entonnera le vin par l'ouverture pratiquée au milieu de cefond. Ce fond sera volant ou à demeure. Dans le premier cas, il sera posé, comme je l'ai dit dans l'autreChapitre, sur des tasseaux bien solides & arrêtés à la de fortscrochets placés sur les rebords de la cuve, dans l'épaisseur desdouves. On pourra l’assurer en outre de telle autre manière que l'onjugera à propos, & on le percera au milieu, seulement de la largeurnécessaire pour y introduire l'entonnoir ; c'est-à-dire, d'environ deuxpouces de diamètre. Dans le second cas, on pourra pareillement poser ce fond sur destasseaux, sur lesquels on le fixera à clouds ; mais alors l’ouverturedu milieu sera de deux pieds quarrés, pour pouvoir descendre dans lacuve, quand il en sera nécessaire. Ces ouvertures, quand le vin feraentonné, seront bien bouchées ; la derniere, avec la porte de la trape,qui sera ferrée à deux couplets & fermée à deux ou trois verroux ;& l'autre, avec un bondon qu'on fera entrer de force. On aura d'ailleurs, pendant le tems que le vin se fera, toutel'attention que la prudence doit suggérer en pareil cas ; mais surtouton se donnera bien de garde, par toutes sortes de raisons, d'ouvrir lacuve tant que l'ébullition & la fermentation dureront. En prenant ces précautions & toutes les sûretés que je viensd'indiquer, je ne vois pas qu'on puisse avoir rien à redouter desefforts du vin. Si des vaisseaux bien moins solides que ceux que l'onemploie ici, le sont cependant assez pour lui résister comme celaarrive dans la façon de quelques vins, à plus forte raison les cuves lepourront-elles. Néanmoins si les précautions que je viens d'indiquer ne paroissent pasencore suffisantes pour mettre le vin en sureté, on pourra le verserdans un sac fait d'une toile sorte & serrée, placé exprès dans unecuve dont il aura toute la capacité, à l'exception toutefois d'un poucequ'on observera de lui laisser demoinssur la largeur ; ensorte que dans tout le pourtour depuis un fondjusqu'à l'autre, il s'en faille de ce pouce qu'il ne touche aux paroisde la cuve. Le but & l'effet de cet intervalle est d'empêcher la liqueur de seporter & d'agir immédiatement contre les douves. Il est vrai que,quelque bien frappée que soit la toile, il y a lieu de croire que levin se filtrera à travers, sinon dans les premiers accès & pendantla fougue de la fermentation, du moins lorsque cette fermentation seraaffoiblie : mais il n'en est pas moins vrai que si (ce qui paroît assezprobable,) la toile peut résister sans se laisser entamer, ce sera elleseule qui recevra les efforts du liquide qui, au moyen de cetteinterposition & même du vin qui remplira l'entre-deux, ne pourrachoquer directement & avec force contre le bois. Son action ferasûrement moins forte contre la cuve que dans l’usage ordinaire : aussi,la résistance du sac une fois certaine, pourra-t-on, se dispenser descercles de fer. La toile sera lavée plusieurs fois avant d'être employée, & lespièces en seront assemblées le plus solidement qu'il sera possible : ilsera bon aussi, pour fixer le sac & le tenir également éloigné desparois de la cuve, de la garnir en dedans de plusieurs tringles de boisd'un pouce d'épaisseur, placées à distance égale l'une de l'autre. A l'égard de la longueur du sac, de la manière d'en prendre lesdimensions, de l'ouvrir pour recevoir le moût & de le fermer après,sur ces objets & tous ceux qui concernent l'usage du sac, je m'enrapporte à l'intelligence des personnes qui les premières en ferontl'épreuve. Au surplus, pour que le moût s'étende assez pour que la substance qu'ilcontient puisse se développer, on aura soin de laisser entre lui &le dessus de bois ; ou le fond supérieur du sac, un vuide de 8 ou 9pouces & quelquefois plus, suivant que les cuvées seront plus oumoins fortes, & que les années & les vignobles seront plus oumoins froids. 5°. Dès que le vin sera fait & froid, on l'entonnera dans lesvaisseaux destinés à le recevoir. Ce vin sera fait en très-peu de tems.Le mien qui, à quelques égards, a été façonné selon la premièreméthode, parce que je n'avois point encore imaginé la seconde, a étéfait en quatre jours, y compris les deux qu'ont duré mes vendanges :ainsi dans ce second plan où la fermentation est plus prompte, il y alieu de croire que, suivant les années & les lieux, le vin sera enétat d'être tiré & la cuve libre dès le deux ou troisième jour ; cequi est un avantage, puisque moins de tems les vins occuperont lescuves où ils seront façonnés, & moins il sera nécessaire demultiplier ces dernieres. En général, une cuve de surcroît serasuffisante, assez rarement en faudra-t-il deux, & plus rarementtrois ou quatre : à bien compter, on peut même dire que l'augmentationn'ira jamais jusques-là, quelque nombreuses que soient les cuvées. Ilest vrai que cette augmentation plus ou moins considérable, esttoujours une dépense ; mais outre que plus communément avec le fer& le couvercle une cuve ne coûtera pas plus de 130 à 140 liv. &quelque-fois au-dessous, c'est qu'à raison de la longue durée & dela grande quantité de vin qui se façonnera dans une pareille cuve,cette dépense répartie sur chaque piece de vin, ne seroit peut-être pasun objet de plus de deux ou trois sols par muid, & doit êtreabsolument comptée pour rien, sur-tout par comparaison àl'augmentation du prix du vin. On ne doit donc y avoir aucun égard ;une considération qui en mérite beaucoup plus, c'est que dans cetteseconde méthode, les opérations des vendanges & de la façon du vinsont tellement resserrées & se suivent de si près, qu'il faudroitles faire dans environ un tiers moins de tems qu'on n'y en employéordinairement : ce qui, dans les gros Vignobles & dans les années abondantes, surchargeroit & augmenteroit le travail au pointque peut-être n'y pourroit-on pas suffire ; mais cette difficulté quilimite nécessairement l’usage de la méthode dont il s'agit ici, ne larend pas pour cela impratiquable, & n'empêchera pas que beaucoup depersonnes, sur-tout des plus aisées & des plus instruites, nel'adoptent de préférence ; du moins ai-je, ce semble, de bonnes raisonspour le croire. En effet, si, comme je l'ai démontré, ce qui favorise le plus lafermentation & la conservation des parties spiritueuses & del'air interne surabondant, est aussi ce qui est le plus favorable à laqualité du vin, il faut avouer que la pratique que je propose nelaissant rien à désirer de ce côté, elle est évidemment préférable àtoutes les autres, & même à lapremière, dont le mérite consiste dans l’excellence de la fermentation,qui est pourtant encore moins parfaite que dans la seconde, où,au moyen du pressurage, toutes les substances qui doivent composer levin fermentent en même tems ; ce qui ne peut arriver dans l'autre, lefoulage laissant nécessairement beaucoup de grains entiers dont le sucn'a point subi de fermentation. Quoi qu'il en soit, dans ces deux méthodes, il y a lieu de croire queles vins acquerront toute la perfection à laquelle la Nature aidée del'Art puisse jamais arriver. Tous les principes, ce qui estl'essentiel, seront développés, sinon toujours parfaitement, du moinsdans tous les cas, autant qu'ils peuvent l'être ; c'est-à-dire,beaucoup plus qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Toutes lessubstances plus divisées seront portées au plus haut pointd'atténuation, l'huile plus raréfiée, mieux combinée avec les acides,plus miscible avec l'eau, enfin plus dégagée & moins surchargée desparties terrestres auxquelles elle étoit unie, d'un côté sera bienmoins sujette a surnager & à se séparer de son menstrue ou liquide,comme cela arrive dans tous les vins gras ; & de l'autre , étantplus dissoute, moins visqueuse, en un mot, plus pure, elle ne seprécipitera plus, comme cela se voit souvent dès la premièredépuration, avec les autres substances grossières pour former le tartre& la lie, Que l'huile soit développée & d'autant plus parfaitement atténuée,que la fermentation a été plus grande ; c'est ce que je regarde commeun point avoué, trop bien appuyé d'ailleurs par l'expérience pourpouvoir être contesté. Que faute de suffisante fermentation, & principalement dans lesannées tardives & peu favorables, il passe une partie considérabledu principe huileux, & même des sels essentiels, dans la lie &le tartre ; c'est encore une vérité trop bien établie par l'expériencepour qu'on puisse en douter. Il en est de la fermentation à cet égardcomme de la maturité, moins l'une & l'autre sont parfaites, &plus les vins perdent de leur huile dans la dépuration : de-là vient,comme M. Hales l'a remarqué à l'occasion de la maturité & del’union des principes (f), queles vins du Rhin qui viennent dans un climat septentrional où lafermentation, ainsi que la maturité, n'est pas à beaucoup prèssuffisante, contiennent dans leur tartre plus d'air & de soufre queles vins des contrées chaudes & méridionales, auxquels cesprincipes sont plus fortement attachés. Mais la substance huileuse n'est pas la seule dont l’insuffisance de afermentation dépouille en partie le vin ; il en est de même de toutesles autres. Cela peut se remarquer sur-tout dans les années froides& contraires à la maturité. Dans ces années où la fermentation esttoujours très-médiocre, & où cependant il seroit fort importantqu'elle ne le fût pas, les vins donnent beaucoup plus de lie que dansles autres années. Cette lie communément est blanche, ou peu colorée ;elle est composée presque entièrement de filets blancs qui ne sontautre chose que les fibres du raisin, c'est-à-dire, les vaisseauxcontenus dans le fruit même, & qui servent à la filtration &sécrétion des sucs dont il est formé : ce sont ces filets que les vinsblancs ou autres renfermés dans des tonneaux, jettent dehors lorsqu'ilsfermentent. Ces filets s'épaississent autour de l'embouchure de cestonneaux, & forment un corps pâteux & doux au toucher : d'où onpeut conclure que s'ils étoient assez atténués pour pouvoir adhérer& se combiner avec les substances, les vins en seroient plusmoëlleux & plus veloutés. En effet, les années comme 1762 & autres semblables, où les vinsfont le moins de lie, & par conséquent conservent davantage de cesfilets, sont celles où les vins possedent le plus de ces deux qualités.Il arrive la même chose, je le sçais pour en avoir fait toujours laremarque, dans les années communes, à l'égard des vins qui ont beaucoupfermenté. Ces vins, par la même raison, sont beaucoup plus gracieuxqu'ils ne l’auroient été sans cela. Au contraire, dans ces mêmes années, & à plus forte raison danscelles qui, comme en 1763, sont les plus défavorables à la maturité,les vins qui pèchent par défaut de fermentation, rendent une grandequantité de lie, & sont sans corps, maigres & verds. C'est ceque j'ai éprouvé du plus au moins en 1761, 1763, 1764 & 1765 ; aulieu qu'en 1766, où la fermentation, sans avoir encore été parfaite,l'a été cependant bien plus que dans aucune de ces années, mon vin atoutes les qualités contraires, & les auroit sûrement à un bienplus haut degré, s'il eût été fait exactement suivant la première ou laseconde de mes deux méthodes (g). Ainsi, en résumant tout ce que je viens de dire & de prouver surles grands effets de la plus forte fermentation, il en résulte que dansl'une ou l'autre méthode, quoiqu'avec quelque différence, tous nos vinsseront, sinon parfaits, du moins, moins imparfaits, & de beaucoupsupérieurs à ce qu'ils sont : ils seront en général plus fins, pluslégers, plus délicats & plus coulans, puisque toutes les partiesqui les composeront seront plus atténuées,& qu'ils auront une plusgrande quantité d'air : ils seront plus chauds, puisqu'ils auront plusde phlogistique : ils seront, par les raisons que je viens deprésenter, plus substancieux, plus corsés, plus moelleux, plusbalsamiques & moins verds : ils seront aussi, par les mêmesraisons, plus spiritueux, plus odorants, & cependant moins fumeux& moins capiteux, parce que leurs esprits, quoiqu'en plus grandequantité, seront tempérés par la partie micilagineuse bien plusabondante que dans les vins ordinaires. Ils seront plus piquants &plus forts à raison de l'air surabondant & de sels ; plus fermes seconserveront plus long-tems, & seront moins sujets à se corrompre, puisqu’ils auront plus de substances,& que leurs principes seront plus étroitement unis. Tout le mondesçait par-tout que les vins qui ont le plus fermenté, sont aussi ceuxqui se gardent le mieux. C'est un fait qui seroit attesté par autant de personnes qu'il y en a qui ont fait ou vu faire du vin. Ilsdonneront plus d'eau-de-vie, puisqu'ils auront plus d'esprits, d'huile& de sels essentiels. En un mot, & pour tout dire, ils serontagréables & bienfaisans : qualités précieuses qui manquent presquetoujours à la plus grande partie de nos vins. En vain m'opposeroit-on que les variétés qui se trouvent à l'infinientre les différens Vignobles exigent des pratiques différentes dans lamanière de faire leurs vins : car d'un côté, les principes que j'aiétablis sur la fermentation sont généraux, & conviennent à tous lesVignobles ; & de l'autre cette objection seroit contredite &démentie par le fait même, puisque, ainsi que je l'ai démontré dans ledeuxième Chapitre, il est certain que tous les Vignobles, dans quelquespays qu'ils soient situés, façonnent, à quelques circonstances près,leurs vins de la même manière. Aussi inutilement m'objecteroit-on que dans ma derniere méthode, lesvins ne seroient point assez colorés ; car 1°. comme je l'ai déjàobservé, au moyen du pressurage & de la forte pression dont il seraprécédé, on petit donner au vin, non pas une forte teinture, mais unebelle couleur. 2°. Cette couleur foncée, si indiscrettement recherchéepar tant de gens, ne donne aucune qualité à la liqueur. Le vin; pour enêtre chargé, n'en est pas moins verd, & en est souvent plus dur. Ala vérité, ce rouge peut plaire à la vue ; mais il est insipide augoût, & par sa grossiereté rend le vin de difficile digestion.Ainsi, lorsqu'il domine, on peut dire que le vin n'est ni flatteur nisalutaire. 3°. Pour donner cette couleur, au moins indifférente pour laqualité quand elle n'est pas contraire, faudra-t-il abandonner nos vinsà tous leurs défauts qui les dépriment, & les priver par-là detoutes les qualités qu'ils peuvent acquérir par la pratique qui leurseroit d'ailleurs la plus favorable ? Non sans doute. Concluons donc que ces deux objections ne peuvent porter atteinte nirestriction aux deux méthodes que je présente. Ces deux méthodesconviennent non seulement aux vins à l’égard desquels je les aiproposées, mais encore, dans certains cas, & sur-tout lorsque lesannées sont humides ou peu favorables à la maturité, elles sontappliquables à tous les vins, soit ceux des crûs les plus renommés,soit ceux des Provinces les plus méridionales. A la faveur de cesméthodes, les vins de France, qui à raison du climat, sont déja, malgréleurs défauts, les plus sociables de l’Europe & les plus faits pourl'usage habituel, posséderont ces qualités dans un degré encore pluséminent, & se ressembleront tous sans exception, quoiqu’à différensdegrés, dans le point le plus essentiel ; c'est-à-dire, la salubrité,Ils seront par-là incomparablement plus utiles à la Nation, & àl'Etranger, qui sûrement les recherchera d'autant plus, qu'il lestrouvera plus agréables & plus bienfaisants. Ainsi, perfectionnernos vins, c'est, d'une part, travailler à la conservation des Citoyens; & de l'autre, accroître leurs richesses, & celles de l'Etat,dont le commerce extérieur des vins sera toujours la principale source,la plus importante & la plus inépuisable. Au reste les vins rouges ne sont pas les seuls qui puissent êtreperfectionnés. On conçoit qu'en se conformant à ma méthode, les vinsblancs, gris, paillets, tous les vins en général étant renfermés dansdes cuves où ils ne perdront rien de leurs substances, de leurs partiesvolatiles, de leur air surabondant, où la fermentation sera parfaite,on conçoit, dis-je, qu'en pareil cas, tous les vins doivent être moinsmaigres, plus nourris, plus forts, plus chauds, plus spiritueux, &cependant moins capiteux , plus légers & plus coulans. Mais si ma seconde méthode est si favorable à la perfection de tous lesvins, elle ne l’est pas moins à la perfection du cidre: le suc de lapomme est composé des mêmes principes que celui des raisins. Toute ladifférence est dans la proportion de ces principes, & dans lamanière dont ils sont combinés; mais cette différence n'empêche pas quedans l'un comme dans l'autre, les mêmes procédés ne soient suivis desmêmes effets. Ainsi ce qui dans l'un divise, atténue, exalte &perfectionne les substances, les retient, & conserve les esprits& l'air surabondant ; ce qui rend l'un plus fin, plus coulant,moins froid, plus corsé, plus fort, plus piquant, & cependant plusdoux, plus moelleux, plus suave ; enfin ce qu'une opération, ce qu'unepratique produit sur l'un, elle doit également le produire sur l'autre.Cela posé, la difficulté se réduit à sçavoir s'il est avantageux, ounon pour le cidre, qu'il soit composé de parties moins grossières &plus déliées ; qu'au moyen de la parfaite atténuation, il perde moinsou conserve plus de sa substance, de ses parties essentielles ; en unmot, qu'il possède toutes les qualités dont je viens de fairel’énumération. Or, c'est ce qui ne peut faire une question ; par conséquent ma secondeméthode lui procurant tous ces avantages, on ne peut mieux faire enNormandie & ailleurs, que de l'adopter, & de renfermer dans descuves bien enfoncées des deux bouts, le suc de la pomme aussitôt qu'ilaura été exprimé ; en observant toutefois de laisser entre la liqueur& le fond, trois pouces de distance de plus que je n'ai indiquépour le vin, l'ébullition devant, par plusieurs raisons qu'il estinutile de rapporter ici, être plus forte que n'est celle de la plusgrande partie de nos vins. Au surplus, je propose les cuves comme plus sûres, plus économiques,& plus favorables à la fermentation par la grande quantité de sucsqu'elles peuvent contenir : néanmoins on pourra, si l’on veut, secontenter des tonnes dans lesquelles on a coutume de renfermer le cidre; mais on aura l’attention de les garnir, ainsi que les cuves, deplusieurs bons cercles de fer, de bien barrer les fonds & delaisser un vuide proportionné à la capacité du vaisseau qu'on aura,soin d'ailleurs de bien boucher. Moyennant ces précautions, on n'aura probablement rien à craindre (h), & on peut être assuré, à lafaveur de ma Méthode, d'obtenir un cidre plus parfait qu'il ne l'a étéjusqu'à présent : ce qui seroit d'autant plus à souhaiter, que cetteliqueur, déja peu assortie à la température du climat & au besoindes Provinces où elle est la seule boisson habituelle, est en outretrès-défectueuse par la manière dont elle est faite. Le bon cidre estaussi rare en Normandie, que le bon vin dans le plus grand nombre desVignobles. C'est que par-tout, au détriment de l'Humanité, on s'attacheà la quantité, & que nulle part on ne préfère la qualité. Quedis-je ? on la sacrifie, on la néglige entièrement. De-là vient que levin, par exemple, si propre, s'il étoit mieux développé, à corriger lesvices & la malignité des alimens défectueux ou mal sains, dont ilparoît destiné par la Nature à être le contre-poison habituel &familier, devient souvent le premier principe de notre destruction, luiqui nous a été donné pour notre soutien & notre conservation. A lavérité le mal qu'il fait, ainsi que beaucoup de ceux qui affligentl’Humanité, n’est pas d'abord sensible ; cependant pour être lent &caché, il n'en est pas moins réel, ni moins meurtrier ; mais fût-ilvrai qu'il ne nous fît aucun par lui-même, c'en est toujours un biengrand qu'il nous soit inutile, & qu'il nous refuse les secoursqu'il nous doit. Prévenons donc au moins ce mal ; & désormais plusclair-voyans ou moins inconséquens, attachons-nous à perfectionner,autant qu'il est en notre pouvoir, le vin & tous les alimens quiservent à notre nourriture, sur-tout la plus commune & la plusordinaire. C'est dans ce dessein que j'ai présenté mes vues sur le vin& le cidre, & c'est dans le même esprit qu'en les étendantencore plus loin ; je vais, toujours à la faveur de ma derniereMéthode, proposer non d'arracher entièrement le pommier pour planter lavigne sur ses débris, mais d'essayer de cette derniere dans lescontrées où jusqu'à présent le premier a seul été admis. Il est vrai que par les moyens que je viens d'en donner, le cidre étantdésormais moins visqueux, plus coulant, plus chaud, ou du moins moinsfroid, puisque d'un côté son huile sera plus développée, & del'autre qu'il en contiendra davantage, il semble que dans les lieux oùcette boisson est la seule naturelle, il seroit plus sûr de s'y tenirque d'y introduire la vigne, qu'on peut regarder comme une planteexotique ou étrangère pour ces mêmes lieux : cependant comme il est dela prudence de ne point négliger ce qui peut être le plus utile, &que le vin est la liqueur la plus analogue & qui convient le mieuxau tempérament des habitans où la Nature le refuse, il n'est rienqu'ils ne doivent risquer pour se la procurer. Je n'ignore pas lesdifficultés de l'entreprise, & que dans quelques Pays, comme enNormandie, elle a été tentée plusieurs fois, & toujours fans succès; mais au lieu de chercher inutilement à forcer la Nature, il falloits'appliquer à la développer & à en tirer au moins tout le peuqu'elle pouvoit donner. Voilà ce qu'on devoit faire, ce qu'on n'a pasfait, & ce qu'on doit essayer, ainsi que je l'ai fait moi-même danstrois petites expériences dont résulte, sinon un succès certain, dumoins une indication favorable. Je vais en donner le précis. Le 2 Septembre 1766, je fis cueillir cinq paniers de raisins de vignenoire : les plus mûrs, rouges & noirs en partie, étoient encore siverds, qu'on ne peut pas dire qu'ils fussent mangeables ; le reste,& c'étoit de beaucoup le plus grand nombre, étoit absolument enverjus : dans les grapes les plus mûres, il y en avoit un quart ou uncinquiéme : je les avois fait choisir exprès de cette qualité. Cesraisins furent mis le même jour dans une bachou, qui est une espèce debarillet, où ils furent écrasés environ au quart. Le moût en étoit sûr& nullement doux. Je les couvris avec un petit fond de bois, qui,faute de suffisante largeur, ne joignoit qu'imparfaitement avec labachou. Ils restèrent en cet état jusqu'au 11. du même mois, que je lesfoulai bien, mais assez inutilement ; car quoique l'ébullition, parproportion à la petite quantité, ait été assez considérable, mon vin nes'en est pas plus échauffé qu'auparavant, c'est-à-dire aucunement ; ensorte que le 12 au soir je le tirai passablement rouge, mais verd aupossible; c'étoit du verjus, & cela n'est pas étonnant, puisqu'iln'a pû se développer, ayant toujours été très-froid. Malgré cela, toutle temps qu'il a cuvé, il n'a pas laissé que d'exhaler beaucoupd'esprits. Je supprime le détail de quelques petites opérations quej'ai faites, parce qu'il n'en résulte rien d'intéressant par rapport àl'objet présent : ainsi je vais passer tout de suite à ma secondeexpérience. Le 13 Septembre, je pris pareillement cinq paniers de raisins de vignenoire, ainsi que dans la première expérience ; mais ces raisins,quoiqu'aussi & peut-être encore plus verds à l'œil, l'étoientpourtant moins intérieurement, à raison de ce qu'il y avoit peu degrapes où il n'y eût quelques grains de noir, & que le noir danscette expérience étoit doux, au lieu que dans l'autre il ne l'étoitpoint : aussi ces raisins, qu'à la différence de la premièreexpérience, j'ai foulés en même tems & en les mettant dans labachou, m'ont-ils rendu un moût qui, à la vérité, n'étoit pas sucré nivisqueux, mais qui étoit doux. Ils ont été couverts avec le dessus debois dont j'ai déja parlé : au bout de huit heures, le vin quibouilloit beaucoup, s'étoit élevé de six pouces environ : il touchoitau couvercle, & le clair étoit au-dessus du marc ; mais aprèstrente-cinq heures de cuve, il étoit encore froid, quoique je l'eusseréchauffé à deux reprises. Au bout de quarante, il étoit un peu tiède& verd. A la 42e, il étoit plus chaud : à la 37e, l'ébullition,malgré tous mes secours, étoit diminuée ; mais la chaleur plus grande.A la 57e ; la chaleur encore plus forte, & le vintrès-trouble. A la 65e. le vin étoit froid, moins verd qu'auparavant,& cependant l'étoit encore beaucoup : mais c'est du vin, & unvin qui n'a point de déboire ; c'est un vin qui, quoiqu'assurémenttrès-imparfait, est pourtant encore moins verd, est au moins égal pourla qualité & bien supérieur pour la couleur à celui de plusieurs denos Vignobles dans les années peu favorables. Du reste ce vin a jetté peu de fumet pendant la fermentation, médiocreà la vérité, & n'en a point jetté du tout tant que le clair a étéau-dessus du marc. Voici la 3e. Expérience. Le 17 Septembre je fis cueillir dans une de mes vignes la même quantitéde raisins que ci-devant & de la même espèce ; & comme je n'yvoulois point de choix, j'eus soin que l'on dépouillât indistinctementtous les ceps de suite, sans interruption, sans y rien laisser &sans faire aucun rebut ; en sorte que ma vendange fut composée deraisins mûrs, de raisins qui l’'étoient à moitié, & enfin de verjus& de verdillons. Ces derniers formoient de beaucoup la partie laplus considérable, & assurément on ne doit point avoir de peine àle croire, puisque nous n'avons ouvert nos vendanges que le 3d'Octobre, & que le canton où j'ai pris ces raisins est toujours unde ceux que l'on réserve pour la fin. Ces raisins après avoir été entierement écrasés, ainsi que dans laseconde expérience, ont été couverts de la même manière, si ce n'estque, pour prévenir toute communication avec l'air externe, & pourcontenir encore mieux la vendange & empêcher que le clair nesurmonte le dessus de bois ainsi qu'il avoit fait dans cette derniere,j'ai garni ce dessus d’une toile dont j'ai rabattu les bords en dehorsde la bachou, sur laquelle je l'ai fortement attachée. Je dois observerqu'avant de couvrir ma vendange, j'ai versé dans ma bachou la valeurd'un demi-panier de raisins tout bouillant : j'ajouterai aussiqu'immédiatement après le foulage, le moût étoit un peu plus doux quedans la derniere expérience, & déja très-rouge, ainsi que dans lesprécédentes, où il l'étoit pourtant moins. Au bout de 8 heures le clair qui, par l'ébullition & la résistancedu fond de dessus, surmontoit le marc, touchoit à ce fond, du moinsautant que j'ai pu en juger ; car dans cette expérience, à ladifférence des autres, je n'ai découvert la vendange que lorsque le vina été fait. La bachou étoit déja un peu moins froide. Au bout de 18heures l'agitation paroissoit plus vive que dans l'autre expérience,mais le bruit étoit plus sourd & plus étouffé, le couvercle &la bachou tièdes. A la 23e. heure, le couvercle & la bachou bienchauds. A la 37e. c'étoit à peu près la même chaleur. A la 42e. le vintrès-chaud & d'un bon goût, marquant du feu, mais encore un peudoux la chaleur encore plus forte qu'elle ne l’avoit été. A la 48e. levin & la chaleur toujours de même, la fermentation &l'agitation se sont toujours soutenues avec la même force. A la 51e. levin encore un peu trouble, & cependant plus rouge qu'auparavant,mais un peu dur à cause de la grape, qui, sans doute, lui auroitcommuniqué plus d'âcreté, si la fermentation, nécessairementproportionnée à la quantité, avoit été plus forte. Il n'a point du toutexhalé d'esprits. A la 54e heure le clair sous le marc, l'un &l'autre froids ; le vin d'un rouge qu'on peut appeller foncé. Il est en tout supérieur à celui de la seconde expérience. On ne peut point encore le regarder comme un grand vin ; mais à touségards il est préférable aux vins que nous avons recueillis en 1763 ;sur-tout il est bien moins verd, & cependant c'est un fait que lesraisins dont il a été composé l'étoient beaucoup plus que la vendangede cette même année : que seroit-il donc s'il eût été façonné selon maderniere méthode ; si la quantité, comme cela se voit souvent, avoitété de 100 & 200 fois plus forte, & que la fermentation n’eûtété aussi complette qu'elle peut l'être avec cette quantité ? Je nedirai point qu'il seroit potable, puisqu'assurément il l'est déjà plusque ne le sont les vins de la plus grande partie des Vignobles dans lesmoindres années, & autant que le sont ceux de certains cantons dansles années communes. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est certainqu'il seroit encore bien supérieur à ce qu'il est, & qu'il prouveque la fermentation, en développantles principes du vin, supplée y jusqu'à un certain point, à sa maturité,& qu'avec des raisins presque tous verds, on peut faire des vinsqui ne le soient pas. Pourvu que les raisins soient, je ne dis pasnoirs, mais seulement un peu rouges, je regarde comme chose sûre qu'entous pays on peut, à la faveur de ma derniere méthode, parvenir à faireun vin potable & dont l'usage n'aura rien de mal-sain. Ce seroitbeaucoup sans doute pour les lieux privés de cette précieuse production: on ne pourroit donc mieux faire, en Normandie, par exemple, que detout tenter pour se la procurer. Il est vrai qu'en supposant le succès de ces tentatives, & laplantation de la vigne aussi étendue qu'elle peut l’être, la Province,loin d'avoir assez de vins pour en commercer au-dehors & enconvertir en eaux-de-vie, auroit peine à les multiplier assez pour sapropre consommation en nature ; mais ce seroit toujours (ce semble) ungrand avantage pour elle que de pouvoir en faire sa boisson, au moinsdans le tems où l'usage peut en être le plus nécessaire. Cette boisson,sans doute, ne fera pas délicieuse, & nos vins choisis n'en serontpas moins recherchés par les personnes riches & en état de lespayer ; mais la Province sera à cet égard dans le cas où se trouve àprésent le plus grand nombre de nos Vignobles, & par conséquentelle n'aura rien à leur envier de ce côté. Au reste, quelqu'heureux effets qu'on soit en droit de se promettre dela parfaite fermentation, & de ma seconde méthode, on ne doit pasnégliger de prendre d'ailleurs sur la plantation & la culture de lavigne, les précautions & les moyens qui peuvent, en suppléant cequi manque au climat, aider & concourir à la perfection du vin. Quant à la plantation de la vigne, voici les principales attentionsqu'on doit y apporter. 1°. On évitera de planter dans les fonds humides, soit par leur nature,soit par leur situation : en conséquence, on préférera ceux qui sontsecs, ceux qui sont en côte & en bonne exposition 2°. On ne plantera que du cépage ou plant de vigne noire de lameilleure qualité, & de l’espece qui mûrit le mieux dans lesVignobles les plus voisins du lieu où se fera la plantation. La vigneblanche & les gros cépages seront entièrement rejettés, comme nepouvant donner qu'un raisin vappide & fans qualité ; & parconséquent, un très-mauvais vin. 3°. Comme les vignes seront fumées, on placera les sarmens à ladistance de deux pieds les uns des autres en tous sens ; & on sedonnera bien de garde de les proyigner par la suite, c'est-à-dire deles coucher en terre, soit pour les multiplier ou autrement. Cet usage,qui, lors même qu'il est absolument indispensable ; est toujourspernicieux, l'est particulièrement ici, en ce qu'il dénatureessentiellement la vigne ; le premier sujet, la mère-souche étant, àraison du lieu de son origine, d'une meilleure qualité que lesrejettons, & les rejettons ne tirant qu'une très-petite portion deleurs sucs de la mère-souche, c'est nécessité que le fruit & le vinqu'ils donnent soient inférieurs à ceux que donnoit cette derniereavant l'opération. Il en est ici de la vigne comme des animaux qui sonttransportés d'un climat qui leur est propre & naturel, dans unclimat qui leur est étranger. Il est d'expérience que l'espece s'enabâtardit par la génération. On ne doit donc jamais provigner qu'avecbeaucoup de réserve & à son corps défendant : d'ailleurs la vigne,conduite de cette maniere & ayant, un espace raisonnable entre sesceps, en durera beaucoup plus long-temps. A l’égard de la Culture ; 1°. On fixera la vigne en mettant des échalas à chaque cep, auquel ilsseront arrêtés avec de la paille ou autrement. 2°. On taillera.la vigne plutôt à la fin d'Octobre qu'en Novembre,& jamais en Décembre ni Janvier, & rarement dans les premiersjours de Février. Une attention qu'il faut avoir dans cette opération,c'est de tailler sur les sarmens les plus près de la souche, en sorteque la tige n'excède jamais un pied de haut. Les raisins, j'en ail'expérience, en mûriront mieux. 3°. Comme, à en juger par la température & le peu de chaleur deslieux où se feront ces nouvelles plantations, les vins en général nedoivent pas abonder, à beaucoup près, en phlogistique ; dans la vuë deleur en procurer, on aura soin de bien engraisser la vigne, enobservant de mettre, dans chaque espèce de terre, l'espece de fumierqui lui convient le mieux. Cette attention est de toute conséquence. 4°. On ne négligera rien pour tenir la vigne toujours nette d'herbes,& pour lui donner les autres façons dans les temps les plus propres: il vaut infiniment mieux, il est bien plus profitable de faire moinsde vignes, & de les bien faire, c'est-à dire, de les bien planter,de les bien fumer, & de les bien cultiver, que d'en étendre laplantation au préjudice de la bonne culture ; la fertilité du terrein,& non la quantité. C'est un des grands principes de la RéductionEconomique (i), & la règlede toute bonne cultivation. La fertilité seule enrichit. J'aurois sans doute d'autres documens, & en très-grand nombre, àajouter à ceux que je viens de tracer ; mais dans la nécessité où jesuis de me borner, j'ai préféré les plus essentiels, & ceux queprobablement on suppléroit le moins : dans la suite je pourrai yrevenir & m'étendre davantage sur cet objet, je veux dire laCulture de la vigne. A force d'observations, de recherches &d'expériences, j'ai acquis dans cette branche si importante del'agriculture des connoissances dont je crois pouvoir assurer lacertitude. Il est pourtant vrai qu'elles ne s'accordent nullement avecles exceptions, les distinctions, les limitations, en un mot, avectoutes les futilités que le préjugé malheureusement trop répandu, aopposé au premier Ouvrage que j'ai publié sur cette matière (j) ; mais ces connoissances quej'ai vérifiées dans différens Vignobles, très-éloignés les uns desautres, n'en doivent pas pour cela paroître ni moins sures, ni moinsbien fondées. Quoi qu'il en soit, ce que je viens de dire suffit pourmarquer, au moins d'une manière générale, la voie qu'il faut tenir,& pour prouver que l'on peut par cette voie aider à la perfectiondu vin & assurer le succès des tentatives que je propose à lafaveur de ma seconde Méthode. Cette Méthode & la première que j'ai présentée, sont si simples, ilen résulte de si grands avantages, &, ce qu'on ne doit peut-êtrepas moins priser, elles sont d’un usage si facile & si peudispendieux, que j'ai tout lieu de croire, sur-tout pour peu qu'ellessoient accréditées, que les personnes les plus éclairées, & à leurexemple, le reste de la Nation, les adopteront & les préféreront àtoutes les autres dans la préparation des boissons naturelles quipar-là en deviendront en tous Pays beaucoup plus utiles à laconservation des hommes : ce qui est le principal objet que je me suisproposé dans cet Ouvrage. FIN. NOTES : (a) Statique des Végétaux,pag. 178. (b)Cet Ouvrage, dont, par la faute de l’Imprimeur, l’édition a retardée deplus de 4 mois, se vend chez Musier fils. (c)Il faut excepter de cette règle les Vignobles quisont dans l’usage de faire du demi-vin, c'est-à-dire, dans lesquels,après avoir tiré ce qu'ils appellent la pure goutte, on verse plus oumoins d'eau sur le marc qui reste dans la cuve, pour en faire ledemi-vin dont je viens de parler. Dans ces Vignobles on pourra secontenter, comme par le passé, d’un foulage imparfait, à la différencequ'on le fera dans la cuve & dans le tems que je viens d'indiquer.Le vin en ce cas sera même meilleur que si le foulage de la vendangeétoit complet, vu qu'il y en aura beaucoup moins de raisins verdsécrasés. Après le tirage du premier vin, on foulera le marc de nouveau. (d)Il est si vrai que la plus grande maturité desraisins est favorable à la perfection d'un vin, que les années où ellese rencontre, comme en 17621 sont celles qui donnent les meilleurs vins. (e) Ces pilettes, dont lemanche portera 5 pieds de long, seront faites d'un bloc de bois deforme cylindrique ou quarrée, de 6 pouces d'épaisseur, sur un pied ouenviron de longueur. (f) Stat. des Végét, pag. 173. (g) Voyez, à la page 5, commeil a été fait ; & à la page 40, dans quelle circonstance il a ététiré. (h) Il sera toujours prudentdans ce dernier cas de commencer par faire l'essai fur un très-petitnombre de pièces. (i) Cet Ouvrage, dont leprincipe fondamental regarde en général toutes les entreprises tropétendues, & spécialement celles qui appartiennent à l'économierurale, est si simple, si sûr, si économique dans les moyens qu'ildonne pour relever & enrichir notre Agriculture, & parconséquent l’Etat, que si ceux-là ne sont pas suivis, ou du moinséprouvés, je ne crains point d'avancer qu'il seroit désormais inutiled'en proposer aucun. Plus en particulier on considérera l'état où setrouvent les Bestiaux dans plusieurs Provinces, & plus onreconnoîtra combien il seroit avantageux, combien il seroit nécessaireque chacun ne se chargeât que de la quantité de Bestiaux qu'il peutentretenir en tout tems, & nourrir au sec, quand le verd manque ouest mal-sain : dans ce dernier cas, à défaut de fourrage sec ou de bonfourrage, on pourroit avoir recours à l'usage fréquent du sel : il esta croire qu'on préviendroit par-!à la corruption d’où s'ensuiventforcément les mortalités si communes & si funestes à tous égards.Mais pour administrer ce préservatif dans la quantité suffisante, cen'est point assez que les Laboureurs soient aisés ; on conçoit qu'illeur faut encore d'autres secours & des facilités qui leur manquent. (j) Cet Ouvrage, vû avecapprobation par l'Académie Royale des Sciences, a pour titre : Nouvelle Méthode de cultiver la vigne,&c. & se vendoit chez Musier Fils, Libraire, à Paris. TABLE DES MATIERES. PREFACE CHAPITRE I. Défauts du Commun de nos Vins. Nos vins, pour la plus grande partie, souvent verds, maigres & sanssaveur. Dans les années les plus favorables, ils sont trop couverts, trop gros& sujets à graisser, faute de suffisante fermentation. CHAP. II. Des diverses manières de faire le vin rouge. Manière de façonner le Vin aux environs de Paris & dans le plusgrand nombre des Vignobles. Deux inconvéniens principaux. Usages du Berry & du Pays Laonnois. Deux inconvéniens principaux. Toutes les manières de faire le Vin se ressemblent toutes en un vicecapital, qui est de ne pas couvrir la vendange dans la cuve : ellesdoivent être regardées comme la cause principale & souvent la seuledes défauts de nos vins. CHAP. III. Première Méthode de façonner le vin rouge. La fermentation, dans le cas présent, est l'action par laquelle laNature travaille à désunir les principes du moût pour les réunirensuite dans une nouvelle proportion. La perfection du vin, ou sa plus grande qualité, dépend du haut degréde fermentation & de la conservation des parties spiritueuses,& notamment de l’air interne surabondant. Tout cela, est prouvé par l’expérience générale & par mesexpériences particulières, rapportées dans le Chapitre. Procédés de la premiere méthode. On aura soin de bien fouler les raisins. La perfection du foulage nécessaire à la perfection du Vin. Après le foulage la cuve fera fermée avec un fond de bois. Le vin dans la cuve se refroidit de lui-même : quand la Nature a finison premier travail elle fait une pause & ne passe point sansinterruption de la première à la seconde fermentation. Soins que demande le vin quand il est fait. Objection, & réponse à cette objection. CHAP. IV. Autre Méthode pour faire le vin rouge, & en outre le vin blanc& le cidre, avec des vues pour la plantation de la Vigne dans lesProvinces où elle ne se cultive pas. Procédés de cette méthode avec les raisons de ces procédés. Aussitôt que la cuvée sera achevée, on foulera la vendange & on laportera au pressoir. Tout le moût exprimé des raisins par le pressurage & avant, seramis dans une cuve bien enfoncée des deux bouts pour y fermenter : pourplus de sureté, on pourra mettre ce moût dans un sac de toile, placéexprès dans la cuve. Raisons pour lesquelles les vins seront plus parfaits dans cetteméthode que dans toute autre. Les vins, dans leur dépuration, perdront moins de leur substance, &par conséquent seront plus substiancieux, plus corsés, &c. Perfection des vins qui seront faits suivant la première & laseconde méthode. Réponse à quelques objections. Ces deux méthodes applicables à la façon des vins de nos Provinces lesplus méridionales. Nos vins se ressembleront tous dans le point le plus essentiel,c'est-à-dire la salubrité. Tous les vins blancs ou autres pourront être perfectionnés par maseconde méthode. Cette méthode applicable à la façon du cidre qui en sera beaucoup plusparfait. Le vin contre-poison habituel & familier de tous les alimensmal-sains. Qualités du cidre perfectionné par la seconde méthode. A la faveur de cette seconde méthode, on peut tenter la plantation dela vigne en Normandie & dans nos autres Provinces septentrionales. Raison pour laquelle jusqu'à présent les tentatives faites dans cettevue n’ont point réussi. Précis de trois petites expériences que j’ai faites en 1766 sur desraisins encore verds. Il en résulte sur-tout de la derniere, qu’avec des raisins presque tousverds, on peut faire des vins qui ne le soient pas ou que bien peu. Avantages de cette découverte pour la Normandie & autres Provincessemblables. Documens sur la plantation & la culture de la vigne en Normandie& ailleurs. Fin de la Table. APPROBATION. J'Ai lu, par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier, un Manuscritintitulé : Essai sur l’Art de fairele Vin rouge, le Vin blanc & le Cidre, par M. Maupin. CetEssai renferme des vues & des expériences utiles. Il peut donc êtreimprimé. A Paris, ce 19 Février 1767. GUETTARD. PRIVILÈGE DU ROI. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROIDE FRANCE ET DE NAVARRE : A nosamés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement,Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôtde Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nosJusticiers qu'il appartiendra ; SALUT. Notre amé le Sieur MAUPINNous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner auPublic un Ouvrage de sa composition intitulé : Essai sur l’Art de faire le vin rouge, levin blanc & le cidre. S'il nous plaisoit lui accorder nosLettres de Permission pour ce nécessaires. A CES CAUSES,voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis &permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant defois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter danstout notre Royaume, pendant le temps de trois années consécutives, àcompter du jour de la date des Présentes : FAISONS défenses àtous Imprimeurs, Libraires,& autres personnes, de quelque qualité& condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangèredans aucun lieu de notre obéissance. A LA CHARGE que ces Présentesseront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté desImprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la dated'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notreRoyaume, & non ailleurs, en bon papier &. beaux caractères ;que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie,& notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de laprésente Permission :qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit quiaura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans lemême état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre cher&.féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LA MOIGNON,& qu'il en sera remis deux exemplaires dans notre Bibliothèquepublique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle duditSieur DE LA MOIGNON,& un dans celle de notre très-cher & féal ChevalierVice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU : le tout à peine de nullité des Présentes : DU CONTENUdesquelles Vous MANDONS& enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans-causes,pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucuntrouble ou empêchement. VOULONSqu'à la Copie dès présentes qui sera imprimée tout au long aucommencement on à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme àl'original. COMMANDONSau premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pourl’exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sansdemander autre permission, & nonobstant clameur de haro, charteNormande & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir.Donné à Paris, le dix-huitieme jour du mois de Mars, l'an mil sept centsoixante-sept, & de notre regne le cinquante-deuxième. Par le Roi en sonConseil. LE BEGUE. Registré sur le Registre XVII. de la Chambre Royale & Syndicale desLibraires & Imprimeurs de Paris, N°. 1322. fol. 188. conformémentau Règlement de 1723 qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, dequelques qualités & conditions qu'elles soient, autres que lesLibraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucunsLivres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent lesauteurs ou autrement, à la charge de fournir à la susdite Chambre neufexemplaires prescrits par l’Article 108 du même Réglement, A Pans, ce 8Avril 1767. Signé, GANEAU, Syndic. De l’imprimerie VALLEYREl'ainé. |

