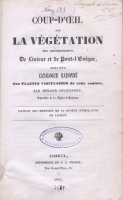| DURAND-DUQUESNEY, Jean-Victor: Coup-d'oeilsur la végétation des arrondissemens de Lisieux et de Pont-l'Evêque,suivi d'un catalogue raisonné des plantes vasculaires de cette contrée. Extrait des mémoires de la société d'émulation deLisieux.- Lisieux : Imprimerie de J. J. Pigeon, 1846.- 127 p.- 1 f. decarte dépl. ; 19 cm. Saisie du texte : L. Maurel pour la collectionélectronique de la MédiathèqueAndréMalraux de Lisieux (31.V.2008) [Ce texte n'ayantpas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement desfautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux,B.P. 27216,14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros]obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusionlibre et gratuite (freeware) Orthographe etgraphieconservées. Pagination respectée. En rouge etentre [] les annotations manuscrites portées sur l'exemplaire. Texteétabli sur l'exemplaire de lamédiathèque (Bm Lx : norm 683). Coup-d'oeilsur la végétation des arrondissemens de Lisieux et dePont-l'Évêque, suivi d'un catalogue raisonné des plantesvasculaires de cette contrée, par Durand-Duquesney ~*~Coup-d'oeilsur la végétation des arrondissemens de Lisieux et dePont-l'Évêque CHAPITRE1er. AspectduPays.Distribution des Plantes. Les arrondissemens de Lisieux et de Pont-l’Evêque, dont lamajeure partie repose sur la craie et le surplus sur les couches quilui sont inférieures, jusqu’au calcaire oolithiqueinclusivement, n’offrent point, à cause de cette dispositiongéognostique, de montagnes abruptes ni de grands accidens deterrain. Le sol, quoique inégal et tourmenté,présente en général des pentes douces, des formesarrondies, et la beauté des sites de cette contrée estmoins due peut-être à la diversité des cultures etdes produits végétaux qu’àl’inégalité de son niveau, qui change à chaque paset varie sans cesse les aspects aux yeux de l’observateur.Indépendamment de quelques rivières assezconsidérables qui l’arrosent, un nombre infini de sources, de(...) [2] (...) ruisseaux épanchent leurs eaux sur toutes les pentes,circulentdans toutes les directions et donnent à nos arbres ce beaudéveloppement, à nos prairies cette vigueur devégétation, cette fraîcheur qui rappellent auxvoyageurs les plus jolies vallées de la Suisse. Sous quelque rapport qu’on l’envisage, cette contrée seprête difficilement à une division rigoureuse,lorsqu’il s’agit d’en donner une description détaillée.Ayant à la considérer seulement sous le rapport de lavégétation, je suivrai l’ordre des niveaux, enprocédant de haut en bas, et je jetterai successivement uncoup-d’œil sur les bois et bruyères, les plaines, lescôteaux et ravins, les marais et le littoral de la mer. Cettedivision suffit au but que je me suis proposé ; elle concorde,d’ailleurs, en quelque sorte, avec celle des cultures dontl’espèce est assez communément déterminéepar la différence de niveau. 1. BOIS ET BRUYÈRES. Les bois occupent ordinairement les points qui dominent laplaine etoù la couche végétale, presque nulle, repose surun lit considérable de silex qui ne permet pas de les labourer,ainsi que la partie la plus tourmentée et les pentes les plusrapides des côteaux. Les espèces ligneuses que l’on ytrouve le plus communément et que j’indique ici dans l’ordre deleurs quantités respectives, sont : le Chêne, le Bouleau,le Tremble, le Noisetier, le Hêtre, le Saule marceau, leMérisier, la Bourdaine, les Epines blanche et noire, leNéflier, le Houx, le Tilleul, etc. (QuercusRobur, L., ~sessiliflora, Sm., Betulaalba, L., Populustremula, L., CorylusAvellana, L., Fagussylvatica, L., Salix capraea,L., Cesarusavium, L., RhamnusFrangula, L., CratoegusOxyacantha, L., Prunusspinosa, L., Mespilusgermanica, L., IlexAquifolium, L., Tiliamicrophylla, L.); et, dansles parties claires, des Bruyères, des Ajoncs, le grandGenêt et l’Airelle, (Callunavulgaris, Salisb., Ericacinerea, L., ~tetralix,L., Ulex europaeus,L., ~ nanus,(...) [3] (...) Smith, Spartiumscoparium, L., VacciniumMyrtillus, L.) L’Alisier (Cratoegustorminalis,L.), qui setrouve assez fréquemment dans les bois et même dans leshaies du canton de Saint-Pierre-sur-Dives, ne croît pas dans lapartie Est des deux arrondissemens. Je dirai peu de chose des plantes herbacées : ce sont, pour laplupart, celles qui garnissent tous les bois de nos climats. Je citeraiseulement la plus belle, la Digitale pourpre (Digitalis purpurea,L.) qui setrouve dans presque tous et, sur quelque points, en immensequantité. Les espèces rares de nos bois sont : Actaea spicata, L., Androsoeumofficinale, All., Lathyrussylvestris, L., ~hirsutus, L., RubusIdoeus, L., Cinerariacampestris, Retz, Serratulatinctoria, L., Campanulapatula, L., ~hederacea, L., Pyrolaminor, L., MonotropaHypopithys, L., Stachysalpina, L., DaphneMezereum, L., Ophrysmonorchis, L., Epipactisnidus avis, All., ~latifolia, All., atrorubens,Hoffm., lancifolia,DC. Les bruyères, heureusement de peu d’étendue dansnotrepays, ne se distinguent des bois que par un sol encore plus ingrat, et,les arbres exceptés, présentent à peu prèsles mêmes espèces. Celles de Glos, près Lisieux,offrent seules quelque intérêt au botaniste et produisent,particulièrement dans les parties tourbeuses, plusieurs plantesque l’on rencontre rarement ailleurs, telle que Gnaphalium dioicum,L., Taraxacum palustre,DC., Epilobium palustre,L., ~ virgatum,Fries, Neottiaoestivalis, DC., Scirpusfluitans, L., Cyperusflavescens, L., Schoenuscompressus, L., PolystichumThelypteris, Roth.,etc. 2. PLAINES. Encore bien que les deux arrondissemens n’aient pas de plainesproprement dites, j’appellerai néanmoins de ce nom lesagglomérations plus ou moins étendues de terreslabourables situées sur un même niveau qui se trouvententre Lisieux et l’Hôtellerie ; aux (...) [4] (...) environs d’Orbec, de Meulles,de Bellou ; entre Honfleur et la forêt de Touques ; entrePont-l’Evêque et Danétal ; aux environs de Saint-Pierre etdeMézidon. Ces plaines, à cause de l’uniformité de leur culture,offrent peu de variété sous le rapport desvégétaux spontanés ; on y trouve la plupart desplantes qui accompagnent les céréales dans l’ouestde la France, et qui ont besoin, pour se développer, d’une terrecultivée. Cependant il en est plusieurs qui croissentabondamment dans les plaines calcaires des environs de Caen et deFalaise et qui, à l’exception de quelques communes des cantonsde Saint-Pierre et de Mézidon, ne se trouvent chez nous querarement et sur des points isolés. Tels sont les Coquelicots(Papaver Rhoeas, ~ Argemone),lePied-d’Alouette (DelphiniumConsolida),les Chrysanthemumsegetum, Lactucaperennis, Carduusnutans, ThymusAcynos, Cerastiumarvense, Adonisautumnalis, etc. Quoique soumises à la même culture et aux mêmesinfluences climatériques, ces diverses parties de plainesprésentent pourtant quelques différences dans laproduction des plantes sauvages. Ainsi, le Delphinium Consolida,le Orlaya grandiflora,le Chrysanthemumsegetum, le Loliumtemulentum sont abondansdans les campagnes d’Orbec, Friardel et Meulles, et assez rares dansles autres ; le Gypsophilamuralisest en grande quantité dans la plaine de Bellou et ne se trouveguère que là. Cette même plaine produit en sigrande abondance l’Agrostisvulgaris,qu’après la récolte du blé et lorsque le chaume aété arraché, ainsi qu’il est d’usage dans lacontrée, la campagne ressemble à une prairieartificielle. Le Lactucaperennisest commun dans les champs de Deauville et de Benerville, et je necrois pas qu’il se trouve ailleurs dans les limites de la craie ;le Lathyrus Nissolia,dansceux des environ (...) [5] (...) de Lisieux et de Saint-Julien-le-Faucon, et fort raredans les autres contrées. 3. CÔTEAUX ET RAVINS. Les côteaux sont, sans contredit, la partie la plusintéressante de notre pays sous le rapport de lavégétation ; c’est aussi la plus habitée. Lesdifférences si fréquentes d’exposition, de niveau, deculture ; les modifications opérées dans la nature dequelques parties du sol par les engrais, les amendemens et uneinfinité de travaux tendant, avec plus ou moins desuccès, à l’augmentation de ses produits, toutes cescauses concourent à répandre, dans les productionsvégétales, une certaine variété qui flatteles regards de tout observateur intelligent, mais qui intéresseplus particulièrement le botaniste. Les côteaux, où l’on ne voit presque pas de terresincultes, se composent de champs, de prés, de pâturages ;quelques bois couvrent leurs pentes les plus escarpées ; defortes haies, la plupart ornées d’arbres de haute futaie,bordent les chemins ; de belles masses d’arbres vigoureux couvrent deleur ombre épaisse les nombreux ruisseaux et les ravins quisillonnent la contrée, et y répandent une fraîcheurqui convient à plusieurs espèces végétalesque l’on y voit en abondance et dans l’état le plusprospère, telles que Helleborusviridis, Primulaelatior, ~grandiflora et leursnombreusesvariétés ou modifications, DaphneLaureola, ~ Mezereum, Circaealutetiana, Chrysosplenium oppositifolium, ~ alternifolium, Paris quadrifolia, Asarum europaeum, Adoxa Moschatellina, Carex leptostachys,Ehrh., etplusieurs fougères que l’on ytrouve en masses et de la plus grande dimension relative. C’est dansles champs des côteaux que croît l’OrobanchePicridis, Shultz,espèce rare et qui manque totalement sur beaucoup de points dela France. Les prés et les pâturages, excepté ceux pourlesquels (...) [6] (...) les propriétaires font des frais considérablesde terrassemens et d’engrais, sont en général d’unemédiocre qualité. Indépendamment des ruisseaux,ayant un cours régulier, une multitude de petites sources sefont jour à différentes hauteurs, surtout au-dessous dubanc de craie, s’épanchent de toutes parts sur la partieinférieure des côteaux et y favorisent ledéveloppement de Prêles, de Joncs, de Laiches, (Carex), etautresplantes robustesqui s’emparent du sol, au préjudice des graminéesqu’elles étouffent. D’un autre côté, le solreposant sur une argile très-compacte mêlée desilex (le diluvium de la craie), retient les eaux pluviales dans lesendroits ayant peu ou point de pente et l’on y retrouve les plantes queje viens de nommer, et quelques autres espèces aussiredoutées du cultivateur, telle que l’Arrête-bœuf (Ononisspinosa),les Genêts (Genistatinctoria, ~anglica, ~sagittalis),la Scabieuse mors du diable (Scabiosasuccisa), le Centaureanigra (1), vulgairement appelé Hannon,et la grande Fougère (Pterisaquilina). Ces diverses espèces, jointes àquelques autres de la famille des Ombellifères, desComposées, et regardées comme plus ou moins mauvaises parles agriculteurs, font, en moyenne, la moitié de la productiondes prés et des pâturages de nos côteaux et, je nepense pas être éloigné de (...) [7] (...) la vérité,en disant que les Graminées et les Trifoliées,estimées à l’égal de celles-là, composentà peine la moitié de la récolte. Quant à la partie des côteaux soumise à la culturedes céréales, elle n’offre pas, dans lesvégétaux spontanés, de différence notableavec la plaine. Cependant les agens puissans qui ont creusé lesvallées, ayant successivement mis à découvertdiverses couches minéralogiques, on remarque çà etlà, sur quelques points où la rapidité de la penten’apas permis à la couche argilo-silicieuse de se fixer, desplantes, pour ainsi dire étrangères à lalocalité, des plantes appartenant principalement aux terrainscalcaires et qui sont communes dans les arrondissemens de Caen et deFalaise. Ainsi, sur un côteau qui regarde la Touques, au-dessousde la forêt de Moutiers-Hubert, et sur une zône largeà peine de cent pas, j’ai recueilli les espèces suivantesdont la majeure partie ne se trouve guère que là, ou siquelques unes d’elles se rencontrent ailleurs dans les deuxarrondissemens, qui font l’objet de ces observations, ce n’est que surdes points analogues et soumis aux mêmes conditions.
Nous ne dirons rien d’un grand nombre de petits vallons arroséspar des ruisseaux plus ou moins considérables ; leurvégétation sous le rapport des espèces (...) [8] (...) n’offrerien de particulier, seulement elle est plus belle, plus vigoureuse quesur les hauteurs. L’on trouve dans ceux de ces vallons qui ne sont pastrop resserrés, de très-bons pâturages. Lesvallées les plus importantes des deux arrondissemens sont cellesque baignent la Touques, la Vie et la Dives. Les deux premièresn’acquièrent une certaine étendue que vers Lisieux pourl’une, et Saint-Julien-le-Faucon pour l’autre. Plus haut, leur peu delargeur, la pente du lit des rivières, l’escarpement de leursbords qui ne leur permet pas de s’épancher au dehors,excepté sur quelques points et dans des cas assez rares, cescirconstances réunies font que le sol éprouve peu demodifications, et la belle végétation du bord des eaux,dont les espèces les plus apparentes ne fleurissent qu’enété, fait un contraste remarquable avec celle descôteaux environnans, surtout dans les annéessèches. Parmi les plantes à fleurs brillantes qui bordentles cours d’eau dans les hautes vallées, tels que les MalvaAlcea, ~moschata, ~sylvestris, Epilobiummolle, ~hirsutum, ~roseum, LythrumSalicaria, Eupatoriumcannabinum, SpiroeaUlmaria, Cirsiumoleraceum, Lysimachiavulgaris, Myosotispalustris, Linariavulgaris, etc., ondistinguel’Aconit (AconitumNapellus,L.) qui élève majestueusement ses longs épis bleusau-dessus des belles fleurs qui l’environnent. C’est dans la vallée de la Dives et dans celles que je viens deciter, surtout vers leur partie moyenne, que se trouvent ces richesherbages réputés à bon droit les meilleurs de laNormandie. Outre la bonté du sol, composé en grandepartie d’alluvions, l’excellente qualité des pâturages estdue à la prédominance des Graminées et desTrèfles sur les autres végétaux. Voici une analyseapproximative de la composition des grandsfonds dans les vallées de la Dives et de la Touques : [9]
Je dois faire observer aussi qu'il est peu d'herbages un peuétendus qui ne renferment quelque partie basse où l'eauséjourne, ce qui donne lieu au développement de Joncs etde Cypéracées. C'est une légère tache surun beau tapis ; l'oeil en est affecté, mais le service en estégalement bon. Les portions de la même contrée composées dumême sol, et que l’on destine à produire du foin,présentent un plus grand nombre d’espècesvégétales. Il est certaines plantes annuelles oubisannuelles, comme les Bromus,les Trifoliumparisiense, ~filiforme, les Crepis,qui ne peuvent se ressemer sur le tapis serré des pâturages, et dont la graine d’ailleurs n’y parvient presquejamais à l’état de maturité, et d’autres, tellesque les Pimpenellamagna, ~saxifraga, Symphitum officinale, HeracleumSphondylium, Pastinacasylvestris, Rumex,etc. qui, quoique vivaces, nerésistent pas long-temps à l’action continuelle de ladent des bestiaux, et qui se reproduisent dans les prés avec unefacilité désolante pour l’agriculteur. Je ne dois pas omettre, en parlant des prairies de nos vallées,de citer celles des bords de l’Orbiquet, les plus riches du pays,puisqu’elles produisent, année commune, un revenu net de 400francs par hectare. En 1840, la récolte des prés desenvirons d’Orbec s’est vendue, sur pied, jusqu’à 550 francsl’hectare ! L’extrême fécondité de ces présest due, en grande partie, à un système d’irrigation bienentendu et exécuté avec soin. Si la présencepresque continuelle de l’eau au pied de l’herbe fait croîtrequelques mau- (...) [10] (...) -vaises plantes fourragères, on en est amplementdédommagé par l’abondance de deux récoltessuccessives. Voici, à peu près, dans quelle proportionles espèces sont distribuées dans les prés d’Orbec:
Indépendamment des prés marécageux et sujetsà des inondations passagères, qui environnent les bonsfonds, dans les parties inférieures et moyennes desvallées, la contrée qui fait l'objet de cette notice,renferme d'assez vastes marais, dont les plus considérables sontceux du Breuil, de Percy et de Plainville, dans l'arrondissement deLisieux, et, dans celui de Pont-l'Evêque, ceux de Deauville, deTouques, à l'embouchure de la rivière de ce nom, et ceuxbeaucoup plus étendus qui bordent la rive droite de la Dives,depuis Corbon jusqu'à son embouchure, sur les communes deHottot, Le Ham, Brocottes, Puttot, Goustranville, Basseneville,Saint-Samson, Saint-Clair et Brucourt. Ces marais présentententre eux des différences notables, sous le rapport de lavaleur, comme sous celui des espèces végétales.Les meilleurs, comme revenus, sont ceux qui ont étélong-temps, ou qui sont encore maintenant, dépouillés pardes bestiaux. Tels sont les marais communaux de Bonneville et Touques,de (...) [11] (...) Hottot, de Saint-Clair, de Basseneville et Saint-Samson,oùcroissent abondamment le Trifoliumrepens, et quelques graminées robustes, telles que les Glyceriafluitans, ~airoides, Phalarisarundinacea, Festucapratensis, Agrostisstolonifera,etc.Là, les Joncs et les Cypéracées sont en petitequantité, et se trouvent, pour ainsi dire,reléguées dans les rigoles et les fossés pleind'eau qui divisent les propriétés. Il n'en est pas demême dans les parties en nature de près, celles surtoutdont le niveau est bas et le sol tourbeux. Les Prêles, les Joncs,les Cypéracées y dominent presque exclusivement. Entre ces diverses portions de marais, la vaste partie appeléeMarais-d'Auge (vulgairement le Domaine) est peut-être la pluspauvre en produits, mais elle n'est pas dénuéed'intérêt pour le botaniste, auquel elle offre plusieursespèces que l'on trouve assez rarement ailleurs, en Normandie,telles que Stellariaglauca,L., Lathyruspalustris,L., Potamogetonrufescens,Schrad., Carexfiliformis,L., Calamagrostislanceolata,D C., Polystichum Thelypteris,Roth., etc. Ce marais, de quatre à cinq kilomètres de longueur, surune largeur moyenne de deux kilomètres, est submergépendant quatre à cinq mois de l'année, et il est rareque, pendant les autres mois, il ne reste pas quelquescentimètres d'eau sur le sol. Les espèces dominantessont, dans les fossés et canaux : RanunculusLingua, ~ Flammula, Sparganiumnatans, ~ ramosum, ~ simplex, Butomus umbellatus, Phellandriumaquaticum, Sium latifolium, ~ nodiflorum, ~ angustifolium, AlismaPlantago, ~ ranunculoides, Hydrocharis Morsus-ranoe, Sagittariasagittaefolia, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton natans, ~lucens, ~ crispum, Hippuris vulgaris, Scirpus lacustris, ~ glaucus,Arundo Phragmites, etc., et, sur le sol des prés, Thalictrumflavum, Calthapalustris,Lathyrus palu- (...) [12] (...)-stris, PotentillaComarum, ~ Anserina, Lythrum Salicaria,OEnanthe fistulosa, Hydrocotyle vulgaris, Galium palustre, Senecioaquaticus, Cirsium anglicum, Scorzonera humilis, Mentha aquatica,Menianthes trifoliata, Scutellaria galericulata, Lysimachia vulgaris,Iris Pseudo-Acorus, Juncus acutiflorus, ~ obtusiflorus, ~ lampocarpus,~ uliginosus, Scirpus palustris, ~ sylvaticus, Carex riparia, ~paludosa, ~ vesicaria, ~ ampullacea, ~ acuta, ~ cespitosa, ~ stricta, ~vulpina, ~ intermedia, Arundo Phragmites, Gyceria fluitans, ~ aquatica,Agrostis stonolifera, Phalaris arundinacea, Equisetum palustre, ~limosum, etc. Ces plantes sonttrès-inégalement réparties sur lavaste surface du marais d'Auge.Ici les Laîches (Carex)formentlapresquetotalité de la récolte en foin ; là elle estmi-partie de Joncs ; ailleurs elle se compose exclusivement dePrêles. Dans certains quartiers, c'est le Glaïeul (IrisPseudo-Acorus)qui domine ;dans d'autres c'est le Cirsiumanglicum. Cette dernière plante, appeléeFeuillette par les cultivateurs du pays, donne un fourrage assezestimé. Après les herbes des lisières, parmilesquelles se trouvent une certaine proportion de graminéesd'assez bonne qualité, cette Feuillette et le Phalaris arundinacea,connu sous lenom de Petit-Roseau, sont les espèces que l'onpréfère. Les marais de Percy et de Plainville, qui, sous le rapport de laqualité des récoltes, sont encore inférieurs aumarais d'Auge, présentent, dans leur végétation,des différences qu'il faut peut-être attribuer àleur voisinage du calcaire oolithique, dont ils reçoivent lesalluvions. Ainsi, l'on y trouve abondamment les Schoenus Mariscuset nigricans,le Scirpus Boeothryon,l'Utricularia minor,les Pinguicula vulgariset Lusitanica,le Drosera anglica,plusieurs Charaet quelques Hypnumqui ne croissent pas dansles marais d'Auge, lequel produit en revanche le Stellaria glauca,le Lathyrus palustris,le Rumex palustris,le Potamogeton (...) [13] (...) rufescens, le Carexfiliformis, et le Calamagrostrislanceolata, qui ne serencontrent pas dans ceux de Percy et de Plainville. On trouve aussidans ces derniers le MalaxisLoeselii, en très petite quantité. 6. LITTORAL Tout le monde sait que l'arrondissement de Lisieux ne touche pointà la mer ; mais celui de Pont-l'Evêque a un littoral quis'étend depuis Honfleur jusqu'à Dives. Dans la plusgrande partie de ce littoral, les flots venant se briser contre desfalaises qui s'élèvent presque perpendiculairementà une grande hauteur au-dessus du rivage, ne permettent pas auxvégétaux de s'y établir. Ce n'est guère quevers l'embouchure de la Dives et de la Touques, et aux environs deCriquebeuf, que la mer peut exercer son influence sur lavégétation. Sur ces divers points se trouvent, plus oumoins abondantes, la plupart des plantes maritimes de la Normandie ; ilen est cependant plusieurs que l'on trouve sur d'autres points descôtes du Calvados, et particulièrement sur celles de laManche, et que j'ai vainement cherchées sur la partie du rivagequi limite notre contrée. Voici la liste des plantes maritimes de notre littoral, ainsi que dequelques espèces terrestres de la même localité,qui ne se trouvent guères que là dans les deuxarrondissemens.
[14]
Si, dans la revue rapide des diverses localités de lacontrée qui fait l'objet de ces observations, je n'ai presquerien dit des plantes Cryptogames, c'est que ces végétauxn'influent pas sensiblement sur l'aspect général du pays;qu'ils sont, pour les habitans, d'une importance trèssecondaire, et qu'ils n'intéressent guères que lenaturaliste, auquel il n'est pas nécessaire d'indiquer leurstation. L'habitude des herborisations en rend la recherche facile, etpeut tenir lieu des indications les plus minutieuses. N'étantpas d'ailleurs en mesure de dresser la liste des nombreusesespèces appartenant aux diverses familles qui composent cettegrande classe, dans notre contrée, je me bornerai à endonner ici, en peu de mots, une idée générale. CHARACÉES. Cette famille est représentée par une douzained'espèces ou variétés, dont la plupart ne setrouvent que dans les marais de Percy et de Plainville. EQUISÉTACÉES. Cinq ou six espèces, dont deux (Equisetumlimosum et E.fluviatile)sont extrêmement abondantes ; (...) [15] (...) la première dans les marais,la seconde au bord des ruisseaux et des nombreuses sources d'eau viveoù elle atteint des dimensions considérables. On latrouve même jusques dans les labours des côteaux argileux,et là, elle présente une particularité bienremarquable, c'est qu'un certain nombre de ses tiges portent enmême temps (en été) des verticilles de rameaux etdes chatons fructifères. FOUGÈRES. Seize à dix-huit espèces, dont les plus rares sont : Botrychium Lunaria,Sw., Ophioglossumvulgatum, L., Ceterachofficinarum, DC., PolystichumThelypteris, Roth., Aspidiumfragile, Sw. Nous n'avons ni le Marsilea,ni le Pilularia,et, de lafamille des Lycopodiacées, nous ne possédons que deuxespèces, le Lycopodiumclavatum et L.Selago,L. MOUSSES. A peine cent espèces, dont une trentaine du genre Hypnum.Plusieursespèces,telles que Trichostomumcanescens,Hedw., Dicranum varium,Hedw., Leucodonsciuroides,Schw., ne fructifient jamais. Leur reproduction, au moyen de rejets oustolons, se conçoit très-bien pour les deuxpremières espèces, qui rampent toujours à lasurface du sol ; il n'en est pas de même pour le Leucodon, quihabite surl'écorce des arbres. On en voit quelquefois de larges touffessur un arbre isolé, là où quelques annéesauparavant il n'en existait pas le moindre fragment. Comment cetteplante est-elle arrivée là? Il faut bien qu'il y ait,dans les Mousses, d'autres organes reproducteurs que les Sporulescontenuesdans les urnesque l'on est convenu d'appeler organes femelles. HÉPATIQUES. Cette petite famille n'a, chez nous, qu'une vingtaine d'espèces,dont trois Marchantiaetquinze Jungermannia. LICHÉNÉES. Notre pays n'ayant pas de roches nues, à l'exception de cellesde la craie, qui sont trop friables pour que des plantes s'y attachent,nous sommes privés (...) [16] (...) des Lichens croissant ordinairement sur lesrochers. Cette famille est donc peu nombreuse relativement à sonimportance ; je crois qu'elle compte à peine cent cinquanteespèces, dont la majeure partie, croissant sur l'écorcedes arbres, appartient aux genres Parmelia,Ramalina, Lecanora, Lecidea, Cenomyce, Collema, etc. CHAMPIGNONS. N'ayant pas fait une étude suffisante de cette importantefamille, je ne puis rien dire de positif sur le nombre desespèces qu'elle fournit, dans les deux arrondissemens dontj'essaie de faire connaître les productionsvégétales ; je crois cependant qu'il peut êtreporté à six cents, y compris les deux petites sectionsdes Mucédinées et des Urédinées, dont lesauteurs modernes ont fait de nouvelles familles. Encore bien que l'on en fasse, dans le pays, une assez grandeconsommation, il n'arrive jamais d'empoisonnement par les Champignons.A la vérité, ils ont quelquefois causé desindispositions assez graves ; mais la médecine a reconnu, dansla plupart des cas, de simples indigestions occasionnées par desChampignons mal cuits, et ingérés en trop grandequantité. L'absence d'accidens funestes est due à laprudente habitude qu'ont les habitans des campagnes, comme ceux desvilles, de ne faire usage que de deux espèces : la Morille(Morchella esculenta)et l'Agariccomestible (Agaricuscampestris),quoique notre pays produise abondamment plusieurs autres espècesdont on fait grand cas sur plusieurs points de la France, notamment le Boletus edulis, L.,et le Cantharelluscibarius, Fries. Lacrainte de funestes erreurs empêche les habitans des'écarter de la règle qu'ils se sont tracée, cedont il faut les féliciter. ALGUES. L'absence de rochers dans l'étendue des rivages quilimitent noscontrées, nous prive des belles espèces marines quitapissent ceux du littoral de la (...) [17] (...) Manche vers Granville et Cherbourg, etdu Calvados aux environs d'Arromanches et de Port-en-Bessin. C'està peine si l'on trouve quelques espèces communes,appartenant aux genres Fucuset Conferva,sur les blocs decraie mêlés de silex, appelés dans le pays Vaches noires, quel'action desvagues, en battant les falaises, a précipités dans la merau-dessous d'Auberville, d'Hennequeville et de Villerville. Quant auxalgues d'eau douce, nous en possédons un grand nombre : leslieuxhumides, les mares, les fossés aquatiques sont remplis deNostocs, de Conferves, de Rivulaires, etc., et l'on trouve dans lesmêmes lieux, ainsi que dans les rivières, les ruisseaux etles fontaines, les plus jolies espèces microscopiquesappartenant aux Desmidiées et aux Diatomées. [18] CHAPITREII. Influencedes Terrainssur la Végétation. Observationsdiverses. 1. INFLUENCE DES TERRAINS. M. de Candolle a dit (Fl. Franç., vol. 2) « On a encore,dans quelques écrits, attribué une grande importanceà la nature chimique des terrains dans lesquels les plantescroissent ; mais j'observerai que tous les faits de la botaniquegénérale tendent, ce me semble, à prouver le peud'influence de cette cause. Je ne nie point que la nature du terreau,et même quelquefois celle de la terre, n'influent sur la vigueurou les propriétés des plantes ; mais ce que je croispouvoir affirmer, c'est que cette influence est trop faible pourdéterminer l'habitation générale desvégétaux ; qu'ainsi telle plante qui prospèredavantage dans certains sols, ne laissera pas de se propager dans unsol différent, lorsque celui-ci se trouvera àproximité. » C'est avec une craintive réserve que je hasarde ici une opiniondifférente de celle du savant auteur du Prodromas ; mais,puisque telle estma conviction, je dois dire que M. de Candolle ne me paraît pasavoir fait une assez large part à l'influence des terrains surles végétaux. Si son opinion était vraie de touspoints, il n'y a pas de raison pour que nous ne vissions pas partoutles mêmes plantes, au moins sous un même climat. La nature,si prévoyante dans sa merveilleuse fécondité,dispose de tant de moyens divers pour opérer ladissémination des graines, qu'elle répandnécessairement partout des germes de toutes les espècesvégétales. S'il en est qui ne se développent pas(...) [19] (...) dans certaines contrées tandis qu'elles prospèrentet seperpétuent dans les contrées voisines, soumises auxmêmes influences atmosphériques, il faut bien quel'obstacle soit dans la nature du sol, lequel, comme on sait, participede celle du terrain sur lequel il repose. Citons, à ce sujet,quelques faits observés dans notre localité. Le Buplèvre à feuilles rondes (Buplevrumrotundifolium, L.) necroît pas, au moins que je sache, dans la partie crayeuse desdeux arrondissemens dont je m'occupe. En 1838, j'en recueillis de lagraine à Ecajeul, au-delà des limites de la craie, et lasemai près de Livarot, dans un champ argileux ayant lamême exposition, en prenant la précaution de mêlerà la terre où je déposai cette graine, de la marnedes couches inférieures prise dans une carrière voisine.Mes graines levèrent ; la plante se développa etmûrit ses fruits ; mais elle ne reparut pas l'annéed'après ni les suivantes. Un autre essai, tenté en 1841,ayant produit exactement les mêmes résultats, je conclusde ce fait que les graines, abandonnées àelles-mêmes, ne se sont plus trouvées dans les conditionsnécessaires à leur germination, conditions où jeles avais moi-même placées en mêlant du calcaireà la terre argileuse où je les avais semées. Le Jasione montana,L.croît abondamment dans l'enceinte d'une ancienne sablière,à Saint-Martin-de-la-Lieue, ainsi que dans les carrièresde Glos et de Beuvillers, qui contiennent une masse considérablede sable marin divisée par des couches de calcaire plus ou moinsdur. Je ne crois pas que cette plante se trouve ailleurs que dans lacontrée, excepté sur quelques monticules sablonneux desbruyères de Glos. Pourquoi, depuis dix ans que je l'observe,n'est-elle pas sortie de l'enceinte de ces carrières pour serépandre dans les champs voisins, où se trouventçà et là des parties incultes qui sembleraient luiconvenir? [20] Je ne connais, dans les deux arrondissemens, bien entendu dans lapartie marneuse, que deux localités qui produisent l'Iberisamara, L.,l'une àLisores, sur le penchant d'un côteau couronné de bois ;l'autre à la partie supérieure d'un champ trèsincliné, au-dessous de la forêt de Moutiers-Hubert, versCourson. Dans l'une comme dans l'autre, les couches inférieuresde la craie se trouvent à la surface du sol et ne peuventêtre recouvertes par l'argile de la partie supérieure descôteaux, retenue par les arbres des bois qui les dominent.Pourquoi, si comme le dit M. de Candole, « telle plante quiprospèredavantagedans certains sols, ne laisse pas pour cela de se propager dans un soldifférent, lorsque celui-ci se trouve à saproximité, » pourquoi dis-je, l'Iberis amarareste-t-ilconcentré dans une étroite lisière, et ne sepropage-t-il pas au moins jusque dans la partie inférieure deces mêmes champs, soumise aux mêmes conditions d'expositionet de culture? Evidemment, c'est que le sol de cette partieinférieure, composé d'argile et de silex, ne convient pasà cette plante ; car on ne peut raisonnablement supposer que sesgraines n'arrivent pas jusques-là. M. de Candolle dit encore ailleurs qu'aprèssept années d'herborisations en France, il a fini par trouverà peu près toutes les plantes naissantspontanément dans presque tous les terrainsminéralogiques. Je suis loin de douter de cetteassertion, mais je soupçonne que, pour beaucoupd'espèces, ce sont seulement des individus isolés que M.de Candolle aura trouvés dans les terrains où ces plantesne croissent pas habituellement ; et une combinaison chimique àlaquelle l'homme a pu prendre part sans le savoir, en transportantà la surface du sol des matières minérales desformations inférieures, a pu faire, par hasard, ce que j'avaisfait avec intention pour le Buplevrum,dont j'ai parlé plus haut. [21] L'influence des terrains est tellement puissante, qu'elle a vaincu lesefforts multipliés de plusieurs agronomes distingués, quiont été forcés d'abandonner la culture decertaines plantes fourragères ou économiques, qu'ilsvoyaient prospérer chez leurs voisins. Elle est reconnue par lesjardiniers et par les plus simples laboureurs, et si, tout enl'admettant, M. de Candolle, dans l'ouvrage que j'ai cité, nelui a pas accordé sur la végétationspontanée toute l'importance qu'elle mérite, je doisdire, pour la justification de cet auteur, qu'il y a près dequarante ans que cet ouvrage a été publié. Il estprobable que, depuis cette époque, M. de Candolle auramodifié son opinion à cet égard : lavérité, en pareille matière, ne pouvaitéchapper longtemps à cet esprit supérieur. On voit, il est vrai, dans notre contrée, qui reposeentièrement sur les terrains secondaires, bon nombre desespèces végétales propres aux terrainsprimordiaux, ce qui semble, au premier coup-d'oeil, justifier l'opinionde M. de Candolle citée plus haut. Ainsi, par exemple, on trouveabondamment, dans nos bois et nos bruyères, le Chêne, leHêtre, le Bouleau, les Genets, les Ajoncs, la Digitale pourpre,etc., qui semblent appartenir plus particulièrement aux terrainsprimordiaux ou de transition. Mais, si l'on veut bien remarquer que cesplantes croissent sur des points où le silex est en si grandequantité qu'il est impossible d'y mettre la charrue (bois etbruyères des environs de Lisieux et de Pont-l'Evêque), oudans le voisinage du grès supérieur à la craie(bois et bruyères des environs d'Orbec), on reconnaîtra,ainsi que l'a déjà fait observer M. de Brébisson,que, loin d'infirmer l'influence des terrains sur lavégétation, la présence de ces plantes dans notrepays, précisément sur des points analogues aux terrainsde première formation, sert au contraire à ladémontrer. [22] 2. Observationsdiverses. CHATAIGNIER. Dans la nomenclature des arbres de nos bois, je n'ai pas cité leChâtaignier (Castanea vulgaris, L.), bien qu'on y rencontreçà et là quelques individus dans un état devégétation qui semble indiquer que notre sol ne convientpas à cet arbre. Cependant la charpente de nos plus vieuxédifices, églises, châteaux, etc., et les plusanciennes maisons de Lisieux, construites en bois, sont, dit-on, dechâtaignier ; il aurait donc existé autrefois dans nosenvirons des forêts de châtaigniers, l'état danslequel devaient être les chemins, avant la création desgrandes routes, ne permettant pas de supposer que des bois deconstruction aient été importés dans le pays. A lavérité, des hommes instruits, des naturalistes (2)pensent que le prétendu bois de châtaignier qui composeces vieilles charpentes, n'est autre chose qu'une espèce dechêne encore assez commune aujourd'hui dans la contrée, etvulgairement appelée chêne blanc (Quercussessiliflora, Smith.) dontle bois plus léger, et par conséquent plus poreux quecelui du chêne rouvre (QuercusRobur, L.) s'altère plus facilement et résistemoins à l'action destructive du temps. D'un autrecôté, des ouvriers accoutumés à travaillerle bois et ayant à chaque instant sous les yeux des objets decomparaison, persistent à soutenir que les vieilles charpentesdont il s'agit, sont de bois de châtaignier. Il seraitintéressant de vider cette difficulté, dont l'objet estplus important qu'il ne le paraît au premier coup-d'oeil,puisqu'il se rattache à une question de physique du globe. Eneffet, si nos anciennes constructions, encore si considérablesaujourd'hui, sont en bois de châtaignier, il faut donc qu'il aitexisté dans la contrée des forêts, ou du moins desplantations importantes de cet arbre ; or, non-seulement il n'enexiste pas de traces main- (...) [23] (...) -tenant, mais encore les essais que l'on afaits en plantation de ce genre, depuis plus de soixante ans, n'ont pasréussi : témoin les arbres qui bordent la route de Parisau sortir de Lisieux ; il s'est donc opéré quelquechangement dans les conditions atmosphériques de notrerégion. Dans un rapport inséré audernier bulletin de laSociété d'Horticulture de Caen (juin 1845), M. duMéril, président de cette société, dit« Qu'ayant eu occasion de voir, dans le midi de la France, despoutres de bois de QuercusCerris, L., il y a acquis la conviction que la charpentede nosvieuxédifices, que les ouvriers disent être dechâtaignier, est de QuercusCerris ; que cette espèce de chêne croissait dansle pays même, et qu'on en retrouve encore des tronc àquelques mètres au-dessous du sol dans les tourbières dumarais de Carentan. » Si ce fait pouvait être constaté, lephénomène n'en serait que plus étonnant et plusdigne d'attention, puisque le QuercusCerris ne croît plus spontanément sur aucun pointde la Normandie. 3. IF, SAPIN. Dans nos haies et nos bois se rencontrent assez fréquemment deuxautres arbres, que M. de Brébisson, dans sa Flore de laNormandie, n'a mentionnés que pour mémoire, ne lesconsidérant pas comme indigènes au pays dont il adécrit les végétaux : c'est l'If et le Sapincommun, (Taxus baccata,L., Abies pectinata,Dc). Ces deuxarbres, en effet, paraissent appartenir plus particulièrementaux pays de montagnes, et le dernier surtout a pu êtreapporté et cultivé dans nos contrées àraison de son utilité. Aujourd'hui le Sapin se perpétuede lui-même dans les lieux où il se trouve, et je citerai,entre autres localités, les bois du Ménil-Germain et deBourgeauville, dans lesquels il existe de temps immémorial, etoù l'on en voit des individus de tous les âges, sans qu'ons'occupe en aucune façon de leur culture. [24] Quant à l'If, si l'on excepte l'arbre funéraire que l'onvoit encore dans plusieurs cimetières, et quelques individus quele caprice avait placés dans les jardins à la française, pourleur donnerdes formes bizarres, il n'est pas probable que cet arbre ait jamaisété cultivé dans nos campagnes, où ilexiste contre lui une prévention qui porte les habitans àle détruire (3). Cependant, il n'y a pas, dans les deuxarrondissemens, de bois de quelque étendue où l'on n' envoie plusieurs, de commune où il ne s'en trouve un nombre plusou moins considérable dans les haies et les ravins, dans unétat souvent peu prospère, il est vrai, mutilésqu'ils sont à chaque instant, par les habitans qui leur font laguerre. Le Sapin et surtout l'If, arbres des montagnes, peuvent aussi bien quel'Aconit, plante des montagnes, si abondante dans nos hautesvallées, être considérés commeindigènes ; en tous cas, leur long séjour dans noscontrées doit leur donner droitde cité, et je demande ici pour eux, à l'auteurde la Flore de Normandie, des lettres de naturalisation. 4. POMMIER. Il me reste, en terminant ces observations, à dire quelques motsdu Pommier, cet arbre essentiellement Normand, qui embellit nospaysages par l'éclat de ses fleurs et la beauté sivariée de ses fruits ; qui nous fournit une boisson abondante etsaine, et d'excellent bois de chauffage. La multitude de variétés des fruits du Pommier est dueà sa facile reproduction au moyen de semis, et à sonaptitude à produire dès sa jeunesse. Lorsque, dans sapépinière, l'agriculteur aperçoit quelque sujetportant des (...) [25] (...) fruits de belle apparence, il le transplante dans leverger, et, sans le greffer, le laisse se développer en pleineliberté ; si son bois est franc et sa tête d'une belleforme, si ses fruits sont abondans et de bonne qualité, il enpropage l'espèce en multipliant l'arbre au moyen de la greffe.C'est ainsi qu'on obtient chaque année de nouvellesvariétés de fruits qui viennent s'ajouter àcelles, déjà si nombreuses, que l'on cultive depuislong-temps. De même que le Poirier, le Pommier a son type, dans nos boisoù il affecte diverses formes qui peuvent, en définitive,être rapportées à deux espèces assezdistinctes. L'une a les tiges peu ou point épineuses ; lesfeuilles elliptiques terminées en pointe, velues-tomenteuses endessous ; les fleurs mêlées de rose et de blanc ; lesfruits ordinairement doux, quelquefois amers, rarement acides (Maluscommunis,Lam.). L'autre ales tiges et les rameaux épineux ; les feuilles ovalesarrondies, brusquement acuminées en pointe oblique,entièrement glabres sur les deux faces ; les fleurs blanches oupresque blanches, et les fruits très-acerbes (Malus acerba,Mérat). C'estcette dernière espèce que M. Mérat regarde commele type des nombreuses variétés de Pommiers àcidre, sans donner les motifs qui l'ont déterminé à accorder à cette espèce lapréférence sur sa congénère. La vie d'unhomme étant insuffisante pour vérifier ce fait, uneopinion, sur ce point difficile, ne pourrait avoir de poids qu'autantqu'une série d'individus, livrés à la culture decet arbre, se seraient successivement transmis leurs observations.Cependant, s'il était permis de se prononcer, en pareil cas,d'après l'analogie seulement, on serait, au moins, aussifondé à dire que c'est la première espècequi a produit les Pommiers à cidre, avec lesquels elle abeaucoup plus de rapports que l'autre, par la forme des feuilles, lacouleur des fleurs, le volume et la saveur des fruits. Si le Malusacerba, Mer.,doitêtre (...) [26] (...) un type, il serait assez naturel de penser qu'il est celuides nombreuses variétés de Pommiers à fruitsacerbes, ou plus ou moins acidulés. Une autre opinion, selon moi, plus raisonnable, pourrait êtreadmise : c'est que le Malusacerba,Mér. serait le type unique du genre, le père commun detous nos pommiers, et que l'autre espèce (Malus communis,Lam.) que l'ontrouve dans les bois, et surtout dans les haies et les ravinsboisés, serait l'espèce cultivée,échappée de nos vergers, et en voie de retour vers sonétat primitif, c'est-à-dire vers le Malus acerba. Ce ne sont là, il faut en convenir, que des hypothèsesplus ou moins vraisemblables ; mais, en histoire naturelle, lorsqu'ils'agit de remonter à l'origine des choses, force nous estsouvent denous contenter de probabilités. Notes : (1)Cetteespèce, préconisée parquelques agronomes comme une bonne plante fourragère, etregardée par noscultivateurs comme une mauvaise herbe, abonde dans les prés etles pâturages maigresde nos côteaux, surtout dans ceux que l’on fait dépouillerpar des chevaux. Unechose digne de remarque, c’est que cette plante, si abondante dans lesvalléesde la Touques et de ses affluens, et plus encore sur les côteauxqui lesbordent, c’est-à-dire là où le sol repose sur lacraie et l’argile d’Honfleur,s’y trouve seule de son genre et qu’on n’y voit nullement sacongénère (le Centaureanigrescens, Willd. ex Bréb.), tandis que cettedernière domine dansles vallées de la Dives et de ses affluens qui reposent surl’argile de Dives. (2)M. de Brébisson, Fl.Norm.,page 293.(3) Outre que les feuilles de l’Ifrendent malades les bestiaux qui les broutent, beaucoup de paysanscroientqu’il fait avorter les vaches qui se reposent sous son ombre. |
INDEX Retrouvez tous les textes disponibles dans la bibliothèque
Corps