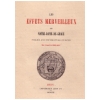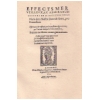INTRODUCTION
I
L’ANCIENNEFONDATION DE LA CHAPELLE
DE NOTRE-DAME-DE-GRACE
En notre pays normand, çà et là,dorment les ruines de nombreuses églises et de nombreuxmonastères. Cependant, ça et là, onvoit encore sur le sol de la vieille province, soit tout en haut descollines ou des promontoires, soit dans les vallées ou dansles plaines, s’élever en l’honneur de laMère de Dieu d’antiques chapelles qui continuentà être visitées par lesfidèles et qui portent au loin la renommée depèlerinages dont la mémoire a passé desiècle en siècle. Il serait hors de propos deconsigner dans ces pages tous les sanctuaires votifsdédiés à la Vierge etsitués en Normandie. Mais quel est le Normand, quel est letouriste qui ne connaisse la célèbre chapelle deNotre-Dame-de-Grâce, tout près de Honfleur,à l’angle occidental de la baie forméepar l’embouchure de la Seine, au sommet d’uncôteau où le modeste édifice resteinvisible, caché sous les arbres séculaires quil’entourent ? C’est un des lieux les pluspittoresques des côtes normandes, et ils sont sans nombre lesartistes qui, dans un sentiment tranquille, doux et rêveur,ont reproduit, par la peinture ou le dessin, ces arbres, ces bois, ceciel et cet oratoire. Encore plus nombreux sont lesétrangers qui viennent, chaque année, admirer lesite majestueux d’où l’on domine un paysde plus de dix lieues environnant. Mais combien peu connaissentl’histoire de la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce,au moins en ce qui touche les anciens temps. Aussi avons-nous saisiavec empressement l’occasion qui nous aété aimablement offerte de tirer del’ombre des documents peu connus, de présenterquelques notions nouvelles sur ce sanctuaire, d’en augmenterainsi les titres à l’intérêtdu public et des pèlerins.
Nos recherches pour retrouver, dans les ouvrages imprimés oumanuscrits relatifs aux pèlerinages anciens et aux lieux dedévotion, les traces de la chapelle deNotre-Dame-de-Grâce sont demeurées sansrésultat (
1).Tout ce qu’on possède dedétails historiques a étésoigneusement exposé par l’abbé PierreVastel dans la brochure qu’il a publiée en 1833 (
2);et ce tout est fort peu de chose (
3).Mais nous ne dirons pas quesa
Noticesoit sans valeur, même pour les premiers tempssur lesquels elle fournit presque rien ; elle est d’autantplus précieuse que nous n’avons pasd’autre guide. L’abbé Vastel avaitdesservi la chapelle de Grâce pendant dix-sept ans, de 1822à 1839 ; prêtre fort lettré etinstruit, il avait compulsé de vieux papiers et ils’était inspiré d’un ancienmanuscrit où les PP. Capucins, sesprédécesseurs avant la Révolution,avaient consigné ce qu’ils croyaient digned’être conservé à lamémoire de leur ordre. Le vénérablechapelain n’a donc pu donner que ce que les religieuxeux-mêmes avaient recueilli. Depuis un peu plus de soixanteans, nous ne possédons plus le manuscrit des Capucins ; onne sait ce qu’il est devenu. Cependant, il n’estpoint permis de douter que le manuscrit n’aitexisté (
4),que les renseignements qui en ontété tirés ne soient authentiques.N’ayant jamais pu trouver l’acte de fondation de lachapelle de Notre-Dame-de-Grâce, les Capucinsn’avaient pu dire quelle était l’originede cet oratoire que la piété du moyenâge s’était plu à honorer,quels en avaient été les possesseurs.
Pour ce qui se rapporte au premier état de la chapelle, lemanque d’informations, la distance considérable dutemps qui nous sépare de l’époqueoù elle a été établie, lamédiocrité de sa condition aux sièclespassés, sa ruine enfin au XVIe sièclen’ont jamais permis de fixer avec exactitudel’année de sa fondation. Rien d’ailleursn’a été plus propre àensevelir dans l’oubli l’origine de cette chapellevotive que les longs orages qui ont agité, diviséet bouleversé la Normandie. Aujourd’huimême que l’on possède des moyensd’investigation que les PP. Capucins ne pouvaient avoirautour d’eux, il est impossible d’indiquer une dateassurée et positive. A la vérité, onen approche beaucoup ; on ne la possède pas. Mais larécolte des documents est encore trèspénible, et il restera toujours des petitsproblèmes historiques à propos desquels on devrase résigner à ne pas obtenir de certitudeabsolue. Or, pour le sujet qui nous occupe, sur quoi est-il possibled’asseoir une certitude relative, en dehors dutémoignage des historiens normands qui faitdéfaut ? Sur d’anciens textes et sur la tradition.Nous nous efforcerons de nous en servir ; nous sommesassurés que, quel que soit le résultat de nosrecherches, on nous lira avec indulgence.
II
L’ANCIENNECHAPELLE DE NOTRE-DAME-DE-GRACE
A-T-ELLE ÉTÉ UN PRIEURÉBÉNÉDICTIN ?
Formulée ainsi, la proposition a dèsl’abord l’apparence d’une conjecture.Nous espérons démontrer qu’elle a desprobabilités en sa faveur et qu’elles’appuie même sur des preuves, ou, sil’on veut, des commencements de preuve. Quoi qu’ilen soit, il n’est pas sans intérêt,puisque nous cherchons à êtrerenseignés, de déterminer en premier lieul’état topographique, ecclésiastique etadministratif de la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce avant laRévolution.
1° Très anciennement, église ou chapelle,lieu de pèlerinage sur la paroisse deSaint-Pierre-d’Equemauville, archidiaconé dePont-Audemer, doyenné de Honfleur, diocèse deLisieux. Destruction au XVIe siècle, probablement dans lapremière moitié de ce siècle ;
2° En 1620, nouvelle chapelle sous la mêmeinvocation, bâtie sur autre emplacement, dotée denouveau, desservie par les Frères Mineurs Capucins, del’ordre de Saint-François. Ces religieux seretirent de la chapelle dans les premiers mois del’année 1790 (
5);
3° En 1791, chapelle privée et non plus conventuelleà la suite de son acquisition par la municipalitéde Honfleur (
6). Ace moment, il se produit une modificationterritoriale. La communauté ou paroissed’Equemauville estdépossédée de la chapelle et de sesdépendances. Chapelle, bâtiments, jardin, deuxacres de terre et plantations qui s’y rattachent sontannexés à la commune de Honfleur. Le tout avaitété vendu comme bien national.
De ces indications il n’y a rien à retenirqu’une seule chose, c’est que la nouvelle chapellen’a eu avec l’ancienne d’autre lien qued’avoir recueilli pour elle, au même lieu, desdévotions affermies et enracinées par un longusage. D’autres traits sont fournis par la tradition.
Un point est acquis. La tradition orale transmised’âge en âge attribuait à unduc de Normandie la fondation de la chapelle deNotre-Dame-de-Grâce (
7).Les Capucins avaient eu soin de laconsigner dans leurs annales (
8).Elle nous est parvenue, en effet,d’après eux seuls ; et comme il étaitdifficile de la renouveler, on s’est contenté del’exposer dans des résumés quin’ont qu’une valeur assez minime (
9).C’est donc par une tradition conservée sur placeque nous savons que le fondateur de la chapelle deNotre-Dame-de-Grâce a été un duc deNormandie. Or, de quel duc s’agit-il ? On ne trouve, ditl’abbé Vastel, que Robert surnommé leMagnifique (
10).D’après un autre auteur, ilparaît que cette désignation étaitportée aux premières pages du manuscrit des PP.Capucins (
11) ;mais c’était par une purehypothèse qui était alorsgénéralement acceptée.
Une tradition orale qui se conserve pendant plusieurssiècles s’altèrenécessairement. L’esprit populaire al’habitude de ramener toujours à certains nomsconnus tous les faits d’une mêmecatégorie : les fondations de villes, lescréations d’églises oud’abbayes. Jadis avait-il à désigner ungrand bâtisseur d’églises ? Il nommaitde préférence à tous Robert le Diablemalgré les aventures romanesques et infernales qui avaientinspiré les ménestrels et les jongleurs. Sonfils, le puissant duc Guillaume-le-Conquérant, ne venaitqu’en seconde ligne dans les souvenirs. Aussi, voit-on lavoix populaire attribuer non à lui mais à sonpère, Robert le Diable, la fondation d’unechapelle devenue un lieu de pèlerinage trèsfréquenté. Il étaitinévitable qu’on y songeât, mais on ades raisons de croire qu’on s’esttrompé. Nous en savons aujourd’hui un peu pluslong sur les origines de la chapelle, grâce aux tracesqu’elles ont laissées dans les archivesmonastiques. Ce sont des documents qu’il faut rechercher,examiner, admettre ou rejeter.
Nous ne reviendrons pas sur l’indicationdéjà donnée et qu’il ne fautpas perdre de vue, à savoir que cette chapelleétait située sur la paroissed’Equemauville, paroisse dont le patronage appartenait au roipar représentation des ducs de Normandie, et qui estconsacrée à saint Pierre.
Ce qui frappe tout d’abord, c’est de rencontrerdans les pouillés du diocèse de Lisieux,annotés et publiés par M. Aug. Le Prevost (
12),la mention suivante :
prior deEsquemeauvilla,le prieurd’Equemauville, taxé à 25 livres pourles décimes. Ce prieur est placé parmi lesdignitaires de l’archidiaconé de Pont Audemer, aucinquième rang, après l’abbéde Saint-Wandrille et avant l’abbesse de laTrinité de Caen. Rien ne fait connaître quelétait ce prieuré ni quel en était lepatron ou le collateur. Nous n’admettons pas, pour notrecompte, qu’il puisse être question, ici, de laparoisse rurale. En effet, dans les mêmes catalogues oupouillés du diocèse, ne lit-on pas àl’article du doyenné de Honfleur :
ecclesia deEsquemeauvilla,l’églised’Equemauville, taxée à 50 livres pourles décimes ? On est conduit de la sorte àconstater, au XIVe siècle, dans la mêmecirconscription ecclésiastique, l’existence dedeux établissements religieux qui ne peuvent pointêtre confondus : l’un prieuréprivé, l’autre église paroissiale etpublique sous l’invocation de saint Pierre. Lanécessité de les distinguer semble avoirsuggéré à M. Aug. Le Prevost la notedont il a fait suivre les termes : « le prieurd’Equemauville », en ajoutant « ceprieuré était peut-êtreNotre-Dame-de-Grâce (
13)». Cette annotation nous amis en éveil ; elle a été le point dedépart de recherches qui ont fourni les seuls textes dontnous puissions nous aider.
Voici donc ce que nous avons recueilli. Le
Chronicon centulense(
14)dans lequel Hariulf, moine de l’abbaye de Notre-Dame,à Saint-Riquier, au diocèse d’Amiens, aretracé l’histoire de ce monastèredepuis les origines jusqu’àl’année 1104, contient deux chartes qui offrent unintérêt incontestable. Enl’année 1023 (
15),d’aprèsles meilleurs chonologistes, le bienheureux Angelran, abbéde Saint-Riquier (1020-1045), remplit une mission auprès deRichard II, duc de Normandie (996-1027). Il vint à Rouen etprit la confiance de demander au duc quelque offrande pour son couvent.Richard, protecteur des clercs et des moines (
16),avaitcontinué l’édifice de Saint-Wandrille,distribué des sommes considérables, fait venirGuillaume, abbé de Saint-Bénigne, àDijon : il l’établit àFécamp et assigna à sa communauté lerevenu de plusieurs terres et seigneuries (
17).Ce princen’eut garde de rejeter la prièred’Angelran. Il lui fit don d’une églisequi est désignée ainsi : «
Consilio ergoet suggestu nostrorum fidelium, decrevimus tradere perpetuoprædicto sancto [Richario] et servis ejus,
ECCLESIAMQUÆ SITA EST IN SCABELLIVILLA ».Le duc Richard luidonnait en aumône, par don irrévocable, uneéglise qui était située sur leterritoire d’Equemauville, à la conditiond’entretenir à perpétuité unmoine qui s’engagerait à prier pour lepère du duc, pour sa mère, pour le duclui-même, pour son épouse et ses enfants ;qu’à partir de ce jour toute la famille de Richardserait agrégée à lacommunauté de Saint-Riquier et deviendrait participante detoutes ses bonnes oeuvres (
18):«
Præfatus veroabbas et fratres sub testificationepræsentis chirographi spoponderunt, quod, amore genitorisnostri, nostro, et matris, conjugis et prolis, persona unius monachiipsius congregationis augeretur numerus(
19)» .
Avant d’aller plus loin, nous ferons une remarque. Des titresanciens donnaient aux abbayes, aux prieurés, le nomd’
ecclesiapour les distinguer de l’
autelproprement dit. Ils désignaient par ce terme, non pas uneparoisse, mais quelque chose de plus éminent commeétaient les églises cathédrales,abbatiales, collégiales ou prieurales dont les paroissesn’étaient que les autels,
altaria.Uneexpression change de sens suivant le passage où elle setrouve.
Vingt-cinq années après la donation,l’église si généreusementoctroyée aux religieux de Saint-Riquier futconvoitée par l’abbesse de Montivilliers, tante duduc Guillaume-le-Bâtard. L’abbé Gervinvint réclamer de l’équité duduc la confirmation de ses droits (
20). Leduc Guillaume consentià renouveler la charte de son bisaïeul et il ajoutamême quelques domaines. Les prétentions del’abbesse de Montivilliers, fondées sans doute surune prétendue donation dont on trouve les traces (
21),cesprétentions, disons-nous, furent mises ànéant, et les droits imprescriptibles del’abbé de Saint-Riquier affirmésà perpétuité par un acte du 30 octobre1048 (
22).
On voit donc l’abbesse de Montivilliers se rendre partie dansla possession de «l’église»d’Equemauville aumônée quelquesannées auparavant aux moines de Saint-Riquier. Le fait està bien retenir. Il arriva, en effet,qu’à six cents ans d’intervalle,c’est-à-dire en 1630, une autre abbesse deMontivilliers intervint dans l’installation des Capucins surle plateau de Grâce et leur fit don d’arbres quifurent plantés autour de la nouvelle chapelle (
23). Ons’est montré surpris de cette action (
24). Ilfaudrait peut-être, pour l’expliquer, remontertrès haut vers la fondation del’«église»d’Equemauville pour laquelle Montivilliers et Saint-Riquierse querellaient au XIe siècle.
Mais quelle était cette église ? Lalocalité où elle étaitsituée est connue. Les mots
Scabellivilla,
Scamelivilla,de la
Chroniqued’Hariulf (
25)désignentEquemauville, commune et paroisse du canton de Honfleur. Aquel établissement religieux le terme
ecclesiaest-ilapplicable ? S’agit-il d’unbénéfice paroissial ou de tout autrebénéfice ? L’explication du texte de lacharte de Richard II repose donc sur une alternative. Dans le premiercas, cette « ecclesia » serait la cure ruraled’Equemauville qui ainsi aurait étépossédée par des moines avec tous les droits etles revenus qu’elle tenait des institutions canoniques. On yaurait alors rencontré non un curé proprementdit, mais un vicaire perpétuel ou un prieur-curé,car on sait que la règle de saint Benoît nepermettait pas aux religieux qui suivaient cette règled’aller résider dans une cure ; ils commettaientun prêtre séculier désignésous le nom de vicaire perpétuel et ils prenaient celui decurés-primitifs. Nous ne croyons pas que cette organisationait existé à Equemauville.
Dans le second cas, la même
ecclesiadésigneraitune église ou une chapelle comme celle desprieurés qui n’étaient pour la plupartque des fermes dépendant des abbayes et dans lesquelles onenvoyait, pour les faire valoir, des religieux, tousgouvernés par un prieur ou par unprévôt.
Nous inclinons vers la seconde solution pour diverses raisons. On doitd’abord être frappé del’expression employée :
ecclesiamquæsita est in Scabellivilla,une église qui estsituée sur le territoire d’Equemauville. Nousécartons l’idée que ces termesdésignent l’église paroissiale ;évidemment ce n’était pasl’église dominante de la paroisse, autrement onlui en aurait donné le nom. Ils sont applicablesà tel autre édifice consacré au culte(oratoire ou chapelle de prieuré), situé dans lamême circonscription ecclésiastique quel’église rurale et séparéd’elle. Les mots :
quæsita est inse rencontrentailleurs (
26).
Il importe de tenir compte d’un autre trait. La donationavait été faite à la conditiond’entretenir un religieux de l’ordre de saintBenoît qui prierait pour la famille ducale. Ne peut-on voirdans ces dispositions la création d’une chapelleou église privée à laquelle onattache, à titre de bénéfice, une partdes dîmes du district paroissial sur lequel elle estsituée, ce qui lui constitue un patrimoine distinct ?
Là encore il y a concordance entre notre exposéet la tradition. Que nous dit, en effet, l’abbéVastel : « L’ancienne chapelle reposait sur unterrain qui n’existe plus. Elle avait despropriétés et un trait de dîmes sur desfonds dont on ne voit pas la moindre trace. » Il ajoute :« Son emplacement contenait une masure de certaineétendue, puisqu’elle renfermait une maisond’habitation et quelques bâtimentsnécessaires à l’exploitation de sesbiens et revenus(
27). » Ces bâtimentsd’exploitation ne seraient-ils point ce que les receveurs dela vicomté d’Auge nommaient : « lagrandeaux moignes de Saint-Riquier-en-Ponthieu, assise àEsquemeauville (
28)»
Il est indéniable que l’abbayebénédictine de Notre-Dame, àSaint-Riquier, a possédé, sur la paroissed’Equemauville, un petit domaine dont la donation de RichardII, en 1023, avait été l’origine. On enretrouve les traces, au XIIe siècle, dans lesrôles de l’Echiquier. Voici les extraits quis’y rapportent sous l’année 1195.
PrepositusdeEscamelvilla reddit compotum de 20 solid. 10 den. deexitu terre Abbatis de Sancto Richero. In thesauro liberavit. Etquietus est.
Robertusde Ros redditcompotum de 4 lib. de decima ejusdem Abbatis. Inthesauro liberavit. Et quietus est (
29).
Il ressort de ce fragment de comptes que l’abbaye deSaint-Riquier versait à la recette fiscale des ducs deNormandie un impôt foncier, et qu’enl’année 1195 il s’y ajouta commesur-charge quatre livres de décimes. A nos yeux, ces biensont été l’ancien fonds de la chapellede Notre-Dame-de-Grâce composé de terres et dedîmages.
En 1239, une contestation s’éleva àpropos des dîmes d’Equemauville, dans laquellefigure un archidiacre de Caux nommé Jacques (magisterJacobus archidiaconus Caleto), Jean de Saint-Evroult, archidiacre deLisieux, Hugues de Chevincourt, abbé de Saint-Riquier. Cedernier spécifiait que les produits des dîmes enlitige appartenaient soit à son monastère, soitau curé bénéficier (
sive nobis quidicimus predictas ad nos pertinere, sive presbytero parochiali(
30).La possession de deux parts des grosses dîmes lui futmaintenue.
Si le domaine paroissial et l’églised’Equemauville avaient été en lapossession de l’abbaye de Saint-Riquier, en vertu de ladonation de Richard II, il semble qu’aucune discussionn’aurait pu s‘élever sur le partage desdîmes. Toutes les redevances paroissiales auraientété portées à la grange desmoines de Saint-Riquier, qui serait devenue la grangepresbytérale. Pour qu’il en aitété autrement, on est conduit à penserqu’au XIIIe siècle il existait sur la paroisse unautre établissement religieux auquel, sous lecontrôle de l’archidiacre, on attribuait deux partsdes dîmes.
L’ensemble du patrimoine de cette autre« église », de cebénéfice aumôné àSaint-Riquier, constitua un titre de dignité, un officeclaustral, une prévôté. On sait que leschapitres et les abbayes établissaient desprévôts dans certains domaineséloignés de leur siège et quidemandaient une administration spéciale. Au nombre desoffices capitulaires de l’abbaye de Saint-Riquier, oncomptait la
prévôtéd’Equemauville dontl’origine remontaità la donation de Richard II, duc de Normandie (
31).
Il nous est parvenu le nom d’un moinebénédictin qui, au XVe siècle,était titulaire de laprévôté d’Equemauville. Il senommait Guy Le Febvre, et le notaire apostolique qui en parle dans unacte du 20 mai 1491, lui attribue les qualités de :«
honestus vir Guido Fabri,presbyter, commonachus dicteecclesie [
Sancti Richarii]
, et prior seu prepositusprioratus seuprepositure de Scabellivilla, vulgante Descameauvilla, Lexoviensisdiocesis, in ducatu Normannie juxta Honnefluctum supra mare(
32).» N’aurait-on pas le droit de voir, dans cetoffice de prieur ou de prévôt, le
prior deEsquemeauvilla dont le nommentionné dans lespouillés du diocèse de Lisieux avait, il y alongtemps, attiré l’attention de M. Aug. LePrevost ?
La présence d’un prieur ouprévôt du prieuré ou de laprévôté d’Equemauville dansun document officiel de 1491 est d’autant plusintéressante qu’elle est postérieureaux Lettres de Louis XI, du mois de janvier 1479 (n. st.), portantdonation au chapitre de Notre-Dame de Cléry de droits depatronage sur un grand nombre d’églises et dechapelles de Normandie. La chapelle de Notre-Dame-de-Grâceeut comme patrons les chanoines de Cléry, àcompter de ce temps jusqu’à sa destruction (
33).Il ne peut pas y avoir confusion ; on remarquera une distinctiontrès nette, à cette époque, entre leprieur d’Equemauville et le prêtre rural quidesservait la paroisse. Cela ressort visiblement des documents que nousvenons de citer, et ceux-ci démontrent égalementque l’institution primitive qui avaitdéterminé les conditions depropriété du prieuré ouprévôté d’Equemauville restainvariable. Il ne pouvait être donné au changementde patronage d’en effacer les traces. Le patronageétait cessible séparément de la terrequand il était aliéné en faveur desecclésiastiques. Sa cession n’entraînaitque le droit de nomination et de provision à telbénéfice, mais les terres et revenusattachés au bénéfice restaient auxpropriétaires du sol (
34).
Voyons ce qui est arrivé par la suite. La chapelle estruinée ; tout ce qui l’entoure disparaîtdans un éboulement (
35).L’oratoire reste doncsans valeur propre, sans offrandes, sans oblations. Toutes chosesdemeurant en l’état, telles qu’ellespouvaient subsister, la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce nesuscita point de convoitise, personne n’en réclamala jouissance exclusive. Mais il n’en fut pas demême de ses revenus qui furentconsidérés comme vacants. Profitant de cetabandon, vers 1570, le curé-recteur d’Equemauvilles’imagina de les annexer aux autres dîmesparoissiales. Les vieux titres furent exhumés, les droits dechacun furent recherchés dans leur origine, et au bout ducompte pour mettre fin à un procès qui duratrente-cinq ans (1570-1605), les religieux de Saint-Riquierréunis en chapitre déclarèrentqu’ils ne sauraient plus reconnaître ni indiquerquelles terres étaient sujettes à laprévôté d’Equemauville (
36).En conséquence une amiable transaction termina ledifférend (
37).Tout était disparu : chapelle etdîmes.
En résumé, on se trouve en présenced’une preuve indirecte et provisoire. Ce quiprécède s’allie fort bien auxconclusions suivantes. Personne ne pourra révoquer en doutequ’il a existé sur le territoired’Equemauville une «église»fondée vers l’année 1023 etprobablement avant cette date ; que son existence estattestée par des titres de possession privée quin’ont jamais été démentis ;que l’église n’était pointparoissiale : ses biens propres ont formé unprieuré ou prévôté ; que ceprieuré ou prévôté aappartenu à l’abbaye Notre-Dame, àSaint-Riquier-en-Ponthieu, jusqu’enl’année 1605 (
38);qu’un religieux dece monastère a pris le titre de prévôtou prieur d’Equemauville, cela pendant plus de quatre centsans. Nous voyons, de plus, que le patronage dubénéfice a ététransféré à la collégialede Cléry (
39) ;qu’un extrait des registres de cechapitre fait mention du patronage, en 1519, dans les termes quisuivent :
Capellaseu heremitagium Beatæ Mariæ deGratia prope Honnefluctum(
40).Cette désignations’applique à l’ancienne chapelle deNotre-Dame-de-Grâce, et ceci nous montre qu’unechapelle de ce nom existait avant le règne de Louis XI (
41).
Retenons ces faits, sous toute réserve d’ailleurs,car nous n’espérons pas avoir obtenu unedémonstration complète. Il peut se trouverd’autres documents que ceux dont nous disposons. Mais lesdonnées recueillies constituent, selon nous, une raisonsuffisante de voir dans«l’église» donnéeà Saint-Riquier, au XIe siècle,l’origine de l’ancienne chapelle deNotre-Dame-de-Grâce, et de rendre à celle-ci sonantique caractère de prieurébénédictin.
III
LA NOUVELLE CHAPELLEDE NOTRE-DAME-DE-GRACE
Détruite à une époque dont on aapproximativement fixé la date àl’année 1538, la chapelle deNotre-Dame-de-Grâce ne s’est relevée deses ruines que vers l’année 1600 environ. Unpassage de l’opuscule qui est l’objet de notrepublication fait connaître qu’une messe futcélébrée dans la chapelle au moisd’août de cette année-là.Cela rectifie ce que l’on savait jusqu’ici.
La chapelle actuelle, a dit l’abbé Vastel, aété édifiée par les soinspieux et la générosité d’unM. de Fontenay, sur un terrain concédé par Mme deMontpensier, qui permit également de prendre dans laforêt de Touques huit chênes pour en faire lacharpente. Mais la première pensée de construireune nouvelle chapelle, - les derniers vestiges de l’ancienneayant été abattus en 1602, - aurait appartenuà un sieur Gonnier, employé au grenierà sel ; il en jeta les fondements. M. de Fontenay,« gentilhomme recommandable par sapiétéet le crédit que lui donnait sa naissance »,repritle projet et l’exécuta. Tel est, enabrégé, le récit duvénérable chapelain (
42).On ydécouvre matière à plusieurs remarquesintéressantes.
Nous trouvons tout d’abord très curieux que cetauteur, qui avait sous les yeux le vieux manuscrit et les papiers desPP. Capucins, n’ait pas désigné plusclairement les personnes dont il parle. Il est difficiled’admettre que, contemporaines des religieux deSaint-François, ces personnes leur aientété inconnues. C’estprécisément peut-être parcequ’elles leur étaient connues que les Capucins ontnégligé de nous en transmettre les noms plusnettement. Quoi qu’il en soit, nous devonssuppléer à l’insuffisanced’informations précises, en même tempsrectifier des inexactitudes et nous arrêter un instant auxnoms cités et particulièrement àl’un d’eux.
En ce qui concerne Mme de Montpensier, il n’y a aucunembarras. Il s’agit de Henriette-Catherine de Joyeuse,mariée à Henri de Bourbon, duc de Montpensier,qui est décédé en 1608.Après la mort de son mari, cette princesseposséda la vicomtéhéréditale d’Auge et de Roncheville.C’est donc aux officiers de la vicomté, aureceveur général domanial, par exemple, si cetoffice très lucratif existait au commencement du XVIIesiècle, ou au lieutenant particulier, qui étaitalors un Lambert d’Herbigny, c’est par les bureauxde ces officiers, disons-nous, que durent d’abord passer lesdeux fondateurs pour obtenir la cession d’un terrain. Ons’adressa ensuite à la duchesse de Montpensier :mieux vaut s’adresser au bon Dieu qu’àses saints, c’est le commun proverbe.
Nous connaissons les deux fondateurs. Le premier se nommait PierreGonnier. C’était un ancien tabellion royal ausiège de Honfleur, en exercice versl’année 1574 et postérieurement. En1596 et jusqu’en 1608, on le retrouve en possession del’office de grenetier au magasin à sel, et il seprésente ainsi avec une dignité qui commande lerespect. La même déférenceétait due à M. de Fontenay puisqu’ilremplit au magasin à sel les mêmes fonctions,comme on va le voir, fonctions qui coûtaient cher et dont lesgages étaient modestes. Nous ne disons point qu’iln’y avait pas d’accessoires.
Par pure imagination, un écrivain a cru voir dans le secondfondateur un « marquis » de Fontenay, intendant desbiens de la princesse de Montpensier (
43).Il ne lui en aurait pas pluscoûté de le rattacher aux lignées desFontenay de l’Ile-de-France, ou du Poitou ou de Bretagne. Sonorigine était tout autre.
M. de Fontenay s’appelait Jean le Bys. A ce nom patronymiqueétait venu s’ajouter un nom de terre, et cedernier, avec le temps, avait fait disparaître lapremière appellation. Jean le Bys, sieur de Fontenay (
44),figure en un grand nombre d’actes notariés. Dansles plus anciens, il s’y qualifie
noble homme; plus tard,vers l’année 1608, la qualitéd’
écuyerest ajoutée à sonnom (
45).En 1576, suivant contrat du 30 juin, Jean le Bys, sieur deFontenay, avait épousé Catherine de Poilvillain,fille de Robert de Poilvillain, écuyer, sieur deMont-à-Louveaux, domicilié en la paroisse deSaint-Gatien-des-Bois. En 1599, il demeurait à Rouen, tenantun emploi dans les fermes avec la qualité de :« commis à la recette des francs fiefs et nouveauxacquêts (
46).» On trouve, à lamême époque, son frère enrésidence dans la même ville : Robert le Bys,sieur de la Chapelle, contrôleurgénéral des gabelles en Normandie (1595),receveur général des amendes et confiscations(1598) ; puis, à Paris, conseiller du roi etcontrôleur de la marine de Ponant (1600), valet de chambreordinaire du roi, en 1608 (
47).
Vers l’année 1601 environ, Jean le Bys de Fontenayavait trouvé l’occasion de traiter d’unoffice de grenetier au magasin à sel de Honfleur ; il estinfiniment vraisemblable qu’il traita de l’officede Pierre Gonnier (
48).Venu se fixer à Honfleur,où résidait son beau-frère, Jean deValsemé, avocat, et à peu de distance despropriétés de sa femme, Jean le Bysapparaît comme un receveur des gabelles et de taxes locales(
49).De nos jours, ses fonctions seraient celles qu’exerceun receveur principal des douanes. En 1613, Jean le Bysétait remarié en secondes noces àLucrèce Grisel (
50).Les deux épouxfondèrent, en l’église deSaint-Catherine, une haute messe pour le jourSaint-François, avec un
Liberasur la tombe que lesfondateurs devaient faire mettre devant l’autel de lachapelle Saint-Jean (
51).Jean le Bys, sieur de Fontenay, vivait encoreà Honfleur en 1629 et 1630 (
52).Il estdécédé en 1641 (
53).A-t-illaissé une postérité ? Onn’en sait rien.
Ces menus détails dont nous n’avons pu adoucirl’ennui n’ont qu’un but, celui defaciliter la lecture du livret réimpriméci-après (
54).A le lire sans avertissement, onn’en aurait pas reconnu l’auteur.
IV
LES PÈLERINAGES
L’opuscule est très rare ; l’exemplairequi a servi à la réimpression estpeut-être unique, si bien que l’on nous sauragré de lui reconstituer une sorte d’histoire.Voici son titre : «
Effectsmer//veillevx,et admirables //secovrs de la glorievse vierge // Marie ditte Nostre Dame de Grace,pres // Honnefleur //. - Esprouuez et resentis par des personnes dignesde Foy, // qui l’auoient inuoquée en leursnecessitez. // - A Roven. // chez Nicolas Hamillon, demeurant deuant //le grand Portail Saint Iean. // 1615. // Auec approbation(
55).»C’est, on le voit, un livretd’édification qui a eu sa saisonéphémère et qui ne porte point de nomd’auteur. Le titre est orné d’uneépigraphe latine empruntée au
Magnificat,d’un quatrain et d’une vignette. Mais quel estl’auteur ou tout au moins l’éditeur dulivret ? Des initiales placées au bas de ladédicace :
A la Royne desCieuxsuffisent pour nouséclairer. On y lit : I. LE B. Un simple rapprochementpermettra de découvrir sous ce voile la personne que lesinitiales désignent. C’est un faitd’évidence et qui ne demande pas bien desrecherches si l’on veut bien tenir compte des remarquesprésentées ci-dessus. Reconnaissons donc Jean leBys, grenetier puis receveur au magasin à sel de Honfleur,le M. de Fontenay que l’on nous a montré comme lepremier des bienfaiteurs de la nouvelle chapelle deNotre-Dame-de-Grâce, et qui pourrait, à justetitre, passer pour en être le fondateur (
56).
Maintenant, il faudrait savoir s’il convient deconsidérer Jean le Bys comme l’auteur du livret,comme l’ayant rédigé. C’esttrès incertain. Quant à nous, nous inclinonsà voir la main d’un prêtre ou celled’un religieux dans le ton dogmatique et pompeux du
Discours,l’étalaged’érudition, l’abus des citationstirées de l’Ecriture et jusque dans les sonnetsmystiques dont chaque division est accompagnée. Notons, deplus, ces mots écrits à la page 17 :« et depuys fit composer ce sonnet ». Jean le Bys adû faire composer autre chose que le sonnet. Sans avoirété tout à fait étrangercomme auteur à la rédaction des
Effectsmerveilleuxpuisqu’il en a signé ladédicace, nous pensons que Jean le Bys en a surtoutété l’inspirateur etl’éditeur.
Ce livret lui était utile. Depuis plusieursannées, il avait réalisé le projet dereconstruire la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce.L’oeuvre était terminée tantbien que mal en 1615. Alors Jean le Bys devint impatient d’yattirer les âmes pieuses et de stimuler le zèledes pèlerins. Il s’agissait aussi d’yattacher des desservants. S’étantchargé de ce double fardeau, et persuadé qued’autres seraient excités par son exemple, Jean leBys voulut raviver les souvenir de faits miraculeux, lesrépandre, les mettre en valeur. Il le fit par le moyend‘un opuscule auquel peut-êtrecollaborèrent les PP. Capucins qui venaient justementd’arriver à Honfleur.
« Les Capucins, dit l’historien Masseville, furentappelez à Honfleur, au diocèse de Lisieux,l’an 1614, par les habitans. Et leurs premiers bienfaiteursfurent le sieur de la Roque, gouverneur de la ville, le marquis deVillars de Brancas, et le sieur de Fontenay. Six ans après,Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, leur donna la chapelle deNotre-Dame-de-Grâce, située sur une montagneauprès de la même ville de Honfleur, dont ilsfirent un Hospice ou deux de leurs religieux résident sousl’obéissance du gardien du couvent de la ville(
57).»
A partir de ce moment, on recueillit quelques offrandes. Les noms desbienfaiteurs de marque nous sont parvenus (
58).En voici deux que nousjoignons à celui de Jean le Bys de Fontenay. L’und’eux nommé M. de Villars est Georges de Brancas,marquis puis duc de Villars, baron d’Oise, lieutenantgénéral au gouvernement de Normandie, gouverneurdu Havre, puis de Honfleur de 1626 à 1632. Tallemant desRéaux a rapporté beaucoup de propos peucharitables sur M. et Mme de Villars qu’il atraités sans ménagement. A l’en croire,ils auraient eu toutes sortes de raisons pour fonder des oeuvrespieuses.
Le donateur de la cloche que notre annaliste nomme M. de Cerillac,était le comte de Cerillac, propriétaire del’île de la Grenade, une des petites Antilles. En1656-1657, s’embarquant au Havre pour aller prendrepossession de cette île, il s’arrêtaà Honfleur « avec les principaux de sa suite etquelques familles de ces quartiers qui s’alloients’establir à la Grenade ; ils ymangèrent jusqu’au dernier sol, etn’ayant plus de quoi subsister ils vendirent leurs hardes, ets’embarquèrent si gueux et si dépourvusde provisions que la moitié fussent morts demisère en chemin auparavant que de regagner les Isles sinous eussions continué le voyage (
59).»C’est dans ces circonstances qu’une cloche aété donnée à la chapelle deNotre-Dame-de-Grâce et nommée par M. de Cerillacet Mlle de Saint-Julien, de la famille des Saint-Pierre, seigneurs deSaint-Julien-sur-Calonne.
D’autres bienfaiteurs sont plus connus, tels que les Bautot,sieurs de la Rivière et de Meautrix ; les Nollent, sieurs deFatouville et Hébertot ; les Naguet, sieurs de Hellins et deSaint-Georges de Pennedepie ; les Lambert, sieurs d’Herbignyet du Mont-Saint-Jean ; enfin Olivier le Chevallier, avocat auparlement de Rouen, fils d’Hélle le Chevallier,capitaine de navire, lequel légua aux Capucins deGrâce la somme de six cents livres, par testament du 17 avril1664, et exprima le désir d’êtreinhumé dans la chapelle de Grâce.
Notre dessein n’est pas de nous étendre ici surles dons et les offrandes ; nous nous bornerons donc aux indicationsqui précèdent. Mais nous ne pouvons nousdispenser d’entrer dans une autre particularité,celle des pèlerinages. La tradition nous dit que depuis untemps très reculé la renommée de lachapelle de Notre-Dame-de-Grâce n’acessé d’y attirer une affluence depèlerins ;c’est un fait passé dont onn’a qu’une connaissance indirecte par les souvenirsqui en ont été conservés. On observedirectement le même fait de nos jours ; la tradition secontinue dans la simplicité primitive, notamment le premierlundi de la Pentecôte. On se représente ainsitoute une chaîne d’actes effectués, sansinterruption, depuis neuf cents ans environ.
L’abbé Vastel, dans son ouvrage, cite des exemplesmultiples de pèlerinages (
60).« Je les prends,a-t-il dit, dans mon manuscrit comme au hasard. » Lesrenseignements épars qui nous sont restéspermettent de reconnaître la plupart des noms quel’ancien chapelain a relevés ; il est naturel quenous ayons cherché à nous en informer :l’occasion d’ailleurs est opportune.
Voici, par exemple, Mme de Blary, veuve de Benoist de Blary,domiciliée à Touques. Le mousquetaire Thirel estJean Thirel, fils de Charles Thirel, sieur de Siglas, terresituée à peu de distance de Pont-Audemer ; ilpartait pour Candie en 1669 avec une compagnie des mousquetairesà cheval détachée de la maison du roiet embarquée sur la flotte destinée àporter secours aux Vénitiens (
61).
D’autres voeux ou pèlerinages serapportent à des marins «qui ontété préservés du naufragepar le secours de Notre-Dame-de-Grâce (
62)».Onretrouve également leurs noms avec toutes les preuves del’identité (
63).
Ce sont : Jean Liébard maître du navire la
Marguerite-Françoise,en1668 ; - Guillaume Morin,maître du
Saint-Antoineen 1665, du
Saint-Nicolas,en1669. - M. de Turelle, capitaine des vaisseaux le
Fleuron,en 1669,le
Mercoeur,en 1673 ; - JeanCrestey, maître dunavire l’
Hirondelle,en1675, le
Saint-Joseph,en1676 ;- Charles Postel, commandant la
Royale,en 1679, et la
Notre-Dame-de-Grâce,en 1681.
On voyait, en effet, des matelots revenir del’Amérique ou de Terre-Neuve, chanter dans lesrues de Honfleur le récit de leurs voyages et des cantiquesspirituels, gravir pieds nus la collinevénérée pour aller recueillir leurpart des grâces attachées àquelques-unes des anciennes fondations. Nous en citerons un exemple.
En 1646, un religieux carme de la province de Touraine prenait passageà Saint-Nazaire pour les Antilles françaises. Ildébarquait à l’île deSaint-Christophe vers le 15 septembre ; il y trouvait comme major unsieur Auger, originaire de Normandie, comme gouverneur M. de Poincy,général des îlesd’Amérique. Le P. Maurille de Saint-Michelséjourna six mois à Saint-Christophe et revint enFrance au printemps de l’année 1647 sur un vieuxnavire que commandait le capitaine Bourgneu, de la ville de Honfleur,en Normandie. A la hauteur des Açores, « nousfusmes découvert, dit-il, par un navire turc qui nous donnal’allarme chaude. Il nous chassa six heures durant avant quede gaigner le vent sur nous ; pendant lesquelles chacun se mist endevoir de défendre sa vie et sa liberté. Les unss’attachoient aux mousquets ; les autres aux canons etmortiers ; d’autres aux piques qu’ilsétaloient sur le tillac, les graissans de sain vers lapointe, afin qu’elles coulassent dans la main del’ennemy, s’il les vouloit empoigner àl’assaut. Les uns attiroient les poudres à canonet les boulets ; d’autres les haches,épées, crampons de fer, et d’autresessayoient leurs fusils et pistolets, chacun ayant interest dansl’affaire….. Nos officiers jugèrent quec’estoit un pirate de Salé en Barbarie. Il avoitquinze pièces de canon, et nous eust pris sans faillir, sinostre navire eust esté seul, car il n’avoit quesix ou sept pièces de batterie, gens recreuz etfatigués, vieil vaisseau et chargé. Mais iln’oza nous aborder et s’enfuit. »
Quelques semaines après s’êtretrouvé à vingt lieues de l’Irlande etavoir côtoyé « la mer de laGrande-Bretagne », le navire mouilla dans le port du Havrequ’il salua de trois coups de canon. Les passagers mirentpied à terre et prirent le chemin del’église principale pour rendre grâcesà la Vierge avant toute autre chose. « Quant aucapitaine et officiers, ils réservèrent leuraction de grâce à une chapelle dedévotion, près Honfleur, où nousavions faict voeu pendant nos dangers d’aller aveceux….. Nous nous rembarquasmes aussi-tost pour passerà Honfleur, et y rendre nos voeux. Làvous eussiez veu nos passagers aller deux à deux, piedsnuds, mains jointes, chantans l’
AveMaria stella (de lamesme façon que nous chantions dans le navire matin et soir)et attirans des spectateurs de Honfleur des larmes de joye. Nousarrivasmes en cet estat à cette chapelle, bastie sur uneéminence, servie par les RR. PP. Capucins, quin’en sont pas fort éloignez : où lecapitaine m’ayant convié de faire une exhortationà nos passagers et matelots….. J’en fisune que j’ay mis à la fin de ce discours pour yservir de couronnement (
64).»
Nous ne l’en exhumerons point ; elle y tient seize pages detexte. Il nous suffit d’avoir montré quelle partrevient aux marins dans les pèlerinages.L’opuscule qui nous occupe et auquel nous revenons en fournitplusieurs autres exemples. Le plus intéressant est celui dusieur « Tortuict Chauvin », d’abordà cause de ce nom de Chauvin, ensuite parce que celui qui leportait appartenait à la religionréformée. Sous une orthographedéfectueuse, on reconnaît François deChauvin, sieur de Tonnetuit, né vers 1588, fils de Pierre deChauvin qui précéda Champlain au Canada, et commelui capitaine pour le roi en la marine. En 1614, François deChauvin commandait le navire la
BonneAdventure, armépourles Antilles. Divers actes (
65)font mention de cet armement et duvoyage qu’une tempête interrompit.L’exactitude du récit des
Effects merveilleuxsetrouve ainsi prouvée.
Ajoutons, en terminant, que ce rarissime livret, après avoirfait partie de la bibliothèque d’un amateurhavrais, appartient à la riche collection de M. Pelay, deRouen.
APPENDICES I
EXTRACTUM FUIT AB UNOEX REGISTRIS COLLATIONUM SEU PROVI-
VISIONUM BENEFICIORUM ECCLESIASTICORUM EPISCOPATUS LEXO-
VIENSIS ID QUOD SEQUITUR (66°. Anno Domini (
67)…..die secunda mensis Maii…..vacans per obitum domini Anthonii Pothier, presbyteri, dum viveret,etc….. Collata fuit per dominum Vicarium, domino Claudio LeGrand, presbytero, absenti, in persona Petri Le Cornu, clerici,procuratoris sui, ad præsentationem dominorum Decani etCapituli capellæ regalis Ecclesiæ BeatæMariæ de Cleriaco, ad Romanam Ecclesiam nullo mediopertinentis, etc.
Anno Domini millesimo quingentesimo octavo, die secundamensis Januarii, capella seu heremitagium BeatæMariæ de Gratia prope Honnefluctum, Lexoviensis diocesis,vacans per obitum defuncti domini Claudii Le Grand, dum viveretpresbyteri ultimi, etc…… Collata fuit per dominumVicarium, Francisco Le Lazare, presbytero, absenti, in persona dominiJohannis Desquetot, presbyteri, sui procuratoris, adpræsentationem dominorum Decani et Capituli capellæregalis Ecclesiæ Beatæ Mariæ de Cleriaco,ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis. Presentibus PetroBaudin , diacono, et Jacobo Carpentier, testibus.
Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo quinto, die secunda mensisnovembris, capella seu capellania Beatæ Mariæ deGratia prope Honnefluctum, Lexoviensis dioecesis, vacans perobitum ultimi illius possessoris pacifici, collata fuit per dominumVicarium, magistro Jacobo Desmares, clerico, absenti, in persona dominiJohannis Beaufils, presbyteri, sui procuratoris, adpræsentationem dominorum Decani et CapituliEcclesiæ collegiatæ et capellæ regalisBeatæ Mariæ de Cleriaco, ad Ecclesiam Romanam nullomedio pertinentis, ad causam Indulti regii per provisionem sibiconcessi.
(Arch. gén. des FF. Mineurs Capucins, à Rome. -Province de Normandie. - Couvent de Honfleur.) II
TRANSACTION ENTRE L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER
ET LE CURÉ D’ÉQUEMAUVILLE
(1605, 8 juillet).
Comme procès fut pendant et indécis en la cour duParlement à Rouen entre me Léger Housset,prêtre, curé de la paroissed’Escameauville, diocèse de Lisieux, demandeur enajournement, en vertu du mandement de la cour du 30e jour de septembremil cinq cent quatre vingt seize, afin d’êtremaintenu en la pleine possession et jouissance de toutes et chacunesles dixmes de laditte paroisse d’Escameauville commeà lui appartenantes à droitgénéral et commun primitivement à tousautres non ayant droit spécial d’une part ; et lesreligieux, prieur et couvent de Saint-Riquier en Picardie, audiocèse d’Amiens, ayant pris faict et cause deMichel Helliot, leur fermier, au droit par eux prétendus deprendre et recueillir les deux tiers des dixmes et des grainsexcroissants sur certains héritages par euxappellés la
prévôté,assise en laditte paroisse d’Escameauville, deffendeurs duditajournement d’autre part ; en la suitte duquelprocès les parties auroient jà fait de grandsfrais de part et d’autre tant en la jurisdiction duPontlevesque, où ledit procès auroitété premièrement introduit etcommencé dès et enprécédant l’année 1570, quedepuis en laditte cour de Parlement et seroient obligésd’en faire encore de plus grands ci-après pourauxquels fuir et éviter et terminer lesd. discords etacquérir repos entr’eux ledit Housset afin den’être diverti de la charge de pasteur en laquelleil est obligé vacquer sans intermission, même pouraucunement récompenser lesdits prieur, religieux et couventdes frais et dépens par eux faits à la suitedudit procès et pour en tout et partout faire leur conditionmeilleure, fût entré en quelques offres quiaurions été rapportées auxditsreligieux par vénérable et discrètepersonne Dom Jean Martin, prieur, et Adrien Levasseur, religieuxprofès de laditte abbaye, qui auroientété cidevant commis etdéputés pour aller faire la suitte duditprocès en laditte ville de Rouen par lacommunauté de laditte abbaye, sur lesquelles iceux religieuxet prieur capitulairement assemblés à son detimbre en la manière accoutumée pourdélibérer des affaires de laditte abbaye,auroient mûrement délibéré :de sorte qu’après avoirconsidéré et reconnu combienl’événement dudit procèsétoit douteux et incertain et que difficillement ilspouroient fournir titres valables et suffisans pour justifierqu’ils eussent aucun droit spécial aux dixmes deladitte paroisse d’Escameauville, moins encore enseigner dela possession paisible et jouissance d’icelle par tems dedroit, considérant aussi le peu de prouffit qui leurpourroit revenir desdites dixmes quand avec grands frais et coutagesils auroient obtenu effet en cause qui ne se peut monter queà quarante livres de ferme ou environ, chacun an, et queladitte paroisse est distante de quarante-cinq ou cinquante lieues deladitte abbaye, tellement que le droit par eux prétendu leurseroit à présent et auroitété longtems du tout inutile et plus àcharge qu’à prouffit ; ainsi que quand ilsauroient obtenus effet en cause ils ne pourroient reconnoistre niindiquer quels héritages sont sujets à laditteprétendue prévôté jointqu’ils n’ont aucun bien en la province de Normandieque lesd. prétendues dixmes ; toutes lesquelles choses pareux mûrement considéré et en sur cel’advis de conseil auxquels ils auroientreprésenté tout ce que dessus même lesoffres certaines à eux faites par ledit Housset onttrouvé pour le prouffit et utilité de laditeabbaye qu’ils doivent accepter lesdites offres faites parledit Housset, consentir et accorder qu’il fûtmaintenu en la peine possession et jouissance de la totalitédes dixmes de laditte paroisse à leur préjudicetant pour le passé que pour l’avenir, suivantlaquelle délibération, persistant ledit Houssetà ses offres, savoir faisons que cejourd’hui dattedes présentes se sont comparus en leurs personnesvénérables et discrètes personnesledit Dom Jean Martin, prieur, Dom Jean Destaminil, sous-prieur etaumônier, Samson de Bernay, Nicolas Bellenger, chantre, leditAdrien Levasseur, Pierre Lefebvre, Nicolas Vasseur, Adrien Le Prevost,trésorier, Quentin de Cayeu, Antoine Bellenger, Jean Gand,Philippes Waignart, Nicolas Perache, tous prêtres faisant lenombre intégral de laditte abbaye de Saint-Riquier enPonthieu, diocèse d’Amiens, congregés,assemblés de rechef à son de timbre en lamanière accoutumée, lesquels aprèsavoir de rechef longuement délibérédudit procès et offres faites par ledit Housset, de leurbonne et franche volonté ont dit,déclaré, disent et déclarent tant poureux que pour leurs successeurs, promettant faire ratifier et avoir toutle contenu en ce présent contrat et transaction au sieurabbé de laditte abbaye dans trois mois aprèsqu’il aura pris possession d’icelle,qu’ils acquiescent audit procès, consentent etaccordent les fins et conclusions dudit Housset, renonchent ores etpour l’avenir à jamais rien prétendre,cueillir, ne demander aux dixmes de laditte paroisse de quelque naturequ’elles soient, et du droit, si aucuns en avoient enicelles, ils se sont dévestus et dessaisis, demettent etdessaisissent par ces présentes au profit duditcuré et de ses successeurs curés, veuillent etentendent que lui et lesdits successeurs curésd’icelle paroisse jouissent pleinement et paisiblementdesdites dixmes, ses circonstances et dépendances sans enrien réserver ni retenir par lesdits religieux, prieur etcouvent, lesquels à cette fin ont subrogé etsubrogent ledit Housset ou ses successeurs auditbénéfice à tous leurs droits, noms,raisons, actions et sy lui accordent et consentent la pleinemainlevée et délivrance des deniers provenans desequestre qui a été par arrêt deladitte cour desdittes dixmes, même des fermages qui leurpourroient être dus précédent leditsequestre, pour le payement desquels icelui Housset demeurerasubrogé en tous leurs droits, noms, raisons et actions pourpoursuivre et contraindre par toutes voyes dues et raisonnables lespersonnes qui y sont obligeez tout ainsi qu’eussent fait oupu faire lesdits religieux, prieur et couvent au cas qu’ilseussent obtenu effet en cause, en ce faisant déclarentqu’ils ne veullent plus tenir audit procès et ontpour agréable tout acquiescement qui pourroit avoirété ci-devant fait par ledit Dom Jean Martin,prieur, par eux de rechef pour ce expressémentenvoyé en laditte cour de parlement de Rouen pour eux et enleurs noms, même par tous autres leurs procureurs, avocat enladitte cour de Parlement ou qui pourra ci-aprèsêtre fait ; le tout au moyen et parce que en faveur duprésent acquiescement et pour les causes etconsidérations ci-devant déclaréesicelui Housset stipulant et ce acceptant par Jacques Boistard,écuier, présent à tout ce que dessuset pour cet effet par lui expressément envoyé,à payer auxdits religieux, prieur et couvent la somme de sixcent livres pour être employé en achat de rentesou héritages qui seront et demeureront propres àladitte abbaye et de telle nature que le droit par euxprétendu sur les dixmes d’icelle paroisse, par lecontrat de laquelle acquisition sera fait mention comme elle auraété faite des deniers provenans de laprésente transaction, de laquelle acquisition lesditsreligieux seront tenus faire délivrer extrait en bonne formeaudit Housset dans trois mois de ce jour au plustard, et au cas queledit remploi fut fait en acquisition de rente sujette àrachat ils n’en pourront recevoir le raquit sinon en faisantle remploi en autre rente ou héritage de pareille nature ;et d’autant que ledit remploi ne peut êtreprésentement fait, ledit Boistard du consentement desditsreligieux, prieur et couvent, présent comme dessus, a garniet déposé laditte somme de six cents livresès mains de Michel de Bernay, bourgeois de la villed’Abbeville, pour être par luidélivrée toutesfois et quant besoin sera pourêtre employée à l’effet quedessus et non autrement pour la confirmation et autorisation, delaquelle présente transaction ledit Housset pourra obteniren cour de Rouen et partout ailleurs telles lettres etexpéditions qu’il verra bon estre, lesquelles ilpourra faire enregistrer, homologuer et approuver pardevant tels jugeslaïques ou ecclésiastiques que bon lui semblera, letout à ses dépens, sans que lesdits religieux,prieur et couvent puissent être contraints ni sujetd’y contrevenir en aucune chose ; seront aussi tenus lesditsreligieux et couvent faire mettre en la marge du cartulaire de laditteabbaye en l’article faisant mention desdites dixmes commeà la présente transaction et remploy ci-dessusauront été faits pour éviterqu’il n’en puisse être mûprocès à l’avenir, par ce moyenlesdittes parties s’en sont allé hors de cours etde procès sans dépens, dommages etintérêts de part et d’autre ; pourl’assurance duquel contrat ils ont obligé tous etchacun les biens de laditte abbaye en tant que faire le peuvent etspécialement ce qui sera acquis de la ditte somme de sixcents livres promettant tant pour eux que pour leurs successeursà l’avenir tenir, entretenir et avoiragréable même par le sieur abbéqu’ils ont promis faire ratiffier et à tous autresqu’il appartiendra tout le contenu en la présentetransaction et acquiescement, renonchant jamais aller ne venir aucontraire. Ce fut fait et passé audit Saint-Riquier, aucouvent de laditte abbaie, en la présence et pardevantNicolas le Prevost et Antoine de Thigny, notaires royaux en laprévôté dudit Saint-Riquier, esquellestous lesdicts religieux ci-dessus nomméscongrégez et assemblés pour cet effet au chapitrede laditte abbaye, même ledit Boistard audit nom, ontsigné ces présentes, le vendredy huitiesme jourde juillet, mil six cent cinq, devant midy.
(Arch. dép. de la Somme. Cartulaire de l’abbaye deSaint-Riquier, fol. 191 verso.) III
DÉLIBÉRATIONCAPITULAIRE DES RELIGIEUX DEL’ABBAYE
DE SAINT-RIQUIER CONCERNANT LA PRÉVOTÉD’EQUEMAUVILLE.
(1606, 26 avril).
Nous prieur et religieux de l’abbaie de St-Riquierconventuellement congregiez et assemblez en la manièreaccoutumée, se seroit présenté domAdrien Levasseur, prévôt d’Escameauvillepour être maintenu en la possession et jouissance de laditteprévôté qui est l’une desdignités dépendans de cette communautéen vertu et suivant la démission qu’en auroitfaite ci-devant dom Jean Destaminil, sous prieur et aumônierde cette abbaye dernier et immédiat possesseurd’icelle dignité en datte du…… (
68)au profit dudit Levasseur, suivantlaquelle démission ledit Levasseur auroit obtenu provisionsde laditte prevôté en datte du 22 avril 1604 pouren jouir avec tous les honneurs, profits, revenus etémolumens y afférans, et d’autant quetout le revenu d’icelleprévôté consiste totalement en unepetite portion de dixme sur le village dudit Escameauville,diocèse de Lisieux, qui a esté fort longtempslitigieux et en dispute entre me Léger Housset,curé dudit lieu d’Escameauville, et nous, lequellitige auroit cessé par le moyen du contrat de transactionque nous aurions fait et passé pardevant les notaires royauxrésidens audit St-Riquier le 8e juillet 1605, en faveurdudit Housset et ses successeurs curés audit lieud’Escamauville moyennant la somme de six cents livres quenous avons reçue dudit Housset, pour icelle sommeêtre employée en d’autres immeubles quidoivent tenir pareille nature que soulloit faire ladite portion dedixme dudit lieu d’Escameauville, et laquelle somme de sixcents livres nous aurions acquis des héritiers de feu meNicolas Doresmieulx, vivant procureur et notaire en lasénéchaussée de Ponthieu, la somme dequarante-cinq livres de rente, icelle rente à prendre sur meNicolas le Prevost et Jacques Carpentier, procureur résidensaudit St-Riquier, moyennant la somme de 540 livres dont ledit Levasseurnous a requis qu’en conséquence de laditteprovision il puisse entrer en pleine et entière jouissancede laditte rente acquise, ensemble de ce qui pourra êtreacquis ci-après des soixante livres qu’il rested’icelle somme de six cents livres. Et àl’instant est intervenu dom Adrien le Prevost,trésorier et procureur sindic d’icelle abbaye,lequel en laditte qualité de sindic nous a requisqu’au cas que ledit rembours se fasse du sort principal deladitte rente que ledit Le Vasseur ni ses successeurs pourvus enladitte dignité de prevost d’Escameauville nepuissent recevoir ledit sort principal ains soit reçuconventuellement et mis en mains bourgeoises pour être auplutôt remployé en achat d’autre renteou immeubles qui seront et demeureront toujours de pareille nature,nous ayant sur ce pris avis et délibération avonsconsenti et accordé que ledit Le Vasseur,prévôt d’Escameauville, et sessuccesseurs pourvus avec office jouissent du courant et revenu deladitte rente comme par ci-devant ont joui ses successeurs de laditteportion de dixme d’Escameauville,délaissée audit Housset et ses successeurscurés dudit lieu que tant le contrat de transaction faitavec ledit Housset que celui d’acquisition de laditte renteavec cette présente délibérationseront enregistrés par le greffier d’icelle abbayeau cartulaire des titres de cette maison et paraphés dessignatures de nos bailly et procureur d’office pour y avoirrecours toutes fois et quantes, et qu’advenant ledit remboursle remploi en sera faite le plus diligemment que faire se pourra dontles contrats qui seront faits seront pareillementinsérés audit cartulaire, desquelsdélibération et consentement ledit procureursindic et ledit Levasseur ont requis acte, ce qu’avonsaccordé pour servir et valloir selon la raison. Et afin quele tout soit chose ferme et stable àperpétuité nous avons signé cesprésentes de nos seings et à icelles fait apposerle sceau de notre couvent. Fait en la présence de Nicolas lePrevost et Jacques Carpentier, notaires royaux en laprévôté dudit Saint-Riquier,à ce par nous appelés, le vingt-sixiesme jourd’avril mil six cent six.
(Arch.dép. de la Somme, cartul. de Saint-Ruquier,fol. 193). IV
ANCIENS EX-VOTOSUSPENDUS DANS LA CHAPELLE
DE NOTRE-DAME-DE-GRACE
Voeu fait : à Notre : Dame : de : Grâce :par : Capne : Bin : Harang : d’Honfleur : Et : sont :équipage : étant : encliné : dans : le: N : l’
Oliver: le : 17: Janvier : 1724.
Voeu. fait . à . Ntre . Dame . De . Grace . Par . le . Capne. Jean . le . Grix . De . Honfleur . et . son . équipages .le . 21 . mars . 1754.
Voeu fait à Ntre Dame de Grâce Par LeCapne Bellet Et son Equipage Sur le Navire le
Saint-André,le 11 avril 1754.
Voeux faits à Ntre Dame de Grâce ParRobert Bunel et son équipage sur le Nre la
Marie-Françoise,le 22 et 30novembre 1768.
Voeu fait à Notre Dame de Grace par le CapitaineLoisel et son Equipage // Commandant le navire l’
Union,d’Honfleur, en péril borné par la //Terre, les Roches Dans une grande tempête. Le 30 septembre1768. Sous les Isles Lucayes ou de Bahama. // Latitude nord, 27degrés : Longitude, 81 degrés.méridien de Paris. Partant de Port au Prince.
Plusagité que cevaisseau Quiconque veut braver la mort, Donttu vois le périlextrême; Sevaincre et régner sur soi-même ; Mondain,reconnais ce tableau: Quiconqueveut surgir au port Detes passions c’estl’emblème. Doitinvoquer l’Etre suprême. Voeu fait à Ntre Dame de Grâce ParAlexandre Gilles et son Equipage sur le
Maréchal deBrancas. Le 7février 1770.
Voeu fait à Ntre Dame de Grace Par Joseph BernardGuillet sur le Navire la
Dauphineayant Fait Naufrage sur la bancd’Anfard. Le 23 mars 1778.
Voeu fait par le Capne Liard sur le bateaul’
EstoilleAllantà la Guadeloupe. Le 24 avril1782.
Sur le brick
Messager*d’Honfleur. Voeu faità Notre Dame de Grâce par le CapneTréguilly et son équipage le 3 octobre 1784. -Restauré en 1838 par les soins de M. Tréguilly.
Voeu fait à Ntre Dame de Grâce Par EtneJulien-Amand Liard et son Equipage sur le Nre la
Gentille.Le 24septembre 1792.
Voeu fait à Ntre Dame de Grâce par leCapne François Fortin d’Honfleur et son Equipage,le 27° septembre 1795.
V
FAC-SIMILE. -FRAGMENT DE LETTRE ET SIGNATURE
DE JEAN LE BYS, SIEUR DE FONTENAY
Notes:
(
1)Dans la
Neustriasancta(ms. latin 10,051, fol. 221 V°),A. Du Moustier a consacré un article à uneéglise nommée Notre-Dame-de-Grâce, maisil s’agit du prieuré situé sur laparoisse de Saint Pierre-de-Bailleul (Eure).
(
2)
Noticehistorique surl’ancienne et la nouvelle chapellede Notre-Dame-de-Grâce,etc., par L. V. C. D. G. (Havre,imp. Cercelet, 1833, in 8°).
(
3)Le
Dictionnairegéogr.,hist., descriptif,archéologique des pèlerinages,etc.(édit. Migne, 1851, 2 vol. gr. in-8°), ne donne pasplus de renseignements détaillés.
(
4)M. Thomas, ancien commissaire de la Marine, avait vu et lu cemanuscrit en 1833 (
Histoire deHonfleur, p. 334).
(
5)Le P. Firmin, gardien des Capucins de Honfleur, donna ladéclaration des biens de la chapelle deN.-D.-de-Grâce, le 18 janvier 1790. - Délib.munic., reg. 110, fol. 59.
(
6)Acte de vente du 19 février 1791.
(
7)Vastel,
Noticehist.,p.15. - Claudius Lavergne.
Notice hist.sur la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce de Honfleur,p.22(Honfleur, 1865, br. in-8°).
(
8)Thomas,
hist.de Honfleur,p. 332. - A. Pannier,
Notre-Dame-de-Grâcedans
Journalde Honfleur(juin 1868).
(
9)
Notre-Dame-de-Grâce,histoire de la chapelle, parC. deB. (Honfleur, 1851). -
Hist. de lachapelle deNotre-Dame-de-Grâce(Honfleur, 1881).
(
10)Vastel,
Noticehist.,p. 17.
(
11)Thomas,
Hist.de Honfleur,p. 334.
(
12)
Mém.Soc. ant. deNormandie. t. XIII, p. 1. -DeFormeville,
Hist. del’ancienévêché-comté de Lisieux,t.Ier, p. xlij et xliij.
(
13)De Formeville,
Hist. del’ancienévêché- comté de Lisieux,t. Ier, p. xlij, note 4.
(
14)Hariulf,
Chroniquedel’abbaye de Saint-Riquier,publiée par F. Lot. (Paris, 1894, in-8°). - Cf.Bibl. nat, ms. latin 11733.
(
15)Le 2 des ides de mars au plus tard de l’année1023.
(
16)Benoist,
Chron.des ducs deNormandie, t.II, p. 387. -Wace,
Romande Rou, t. Ier, p. 301.
(
17)
Neustriapia, p. 210,215, 218. -
GalliaChrist., t.XI, col.202, 203.
(
18)Hénocque,
Hist. de laville et de l’abbayede Saint-Riquier, t. Ier, p.320.
(
19)
Chron.d’Hariulf,p. 185 (éd. Lot).
(
20)D’Achery,
Spicilegium,t. IV, p. 574. - Histor. deFr., t. XI, p. 132. - Mabillon,
Annalesord. S. Ben., t. IV, p. 496.-
Galliachrist., t. X, col.1,249, 1,250 et t. XI, col. 282. -Hénocque,
Hist. del’abbaye de Saint-Riquier,t.Ier, p. 351.
(
21)
Galliachrist., t. XI,app., col. 326.
(
22)
Chron.d’Hariulf,p. 224 (éd. Lot). - Le 3des calendes de novembre 1048.
(
23)Vastel,
Noticehist.,p. 13.
(
24)Thomas,
Hist.de Honfleur,p. 339, à la note.
(
25)
Chron.d’Hariulf(éd. Lot), p. 177, 184,185, 223, 224, 315, 316.
(
26)On lit dans une charte de 1143 relative àl’église de Saint-Lô, àBourg-Achard :
ecclesia S. Laudiquæ sita est inBurgo-Achardi.C’est le prieuré deSaint-Lô. - D. Pommeraye,
Hist.de l’abbaye royalede Saint-Ouen (Rouen, 1662,in-fol.), p. 146.
(
27)Vastel,
Noticehist.,p. 15 et 16. - Thomas,
Hist. deHonfleur, p. 335.
(
28)Comptes de Ch. Castellain, receveur de la duchessed’Orléans en la vicomtéd’Auge (‘1472-1481). - Bibl. nat., mss. nouv. acq.fr. 5275 et 5276.
(
29)
Mém.Soc. ant. Normandie,t. XV, p. 44 (
Magni Rot.scac. Norm.)
(
30)Pièce orig. en parchemin que nous avons acquiseà la librairie normande d’Ernest Dumont.C’est un vidimus du 20 mai 1491 donné par Jean dela Chapelle, prêtre, maire ès arts et notaireapostolique qui a laissé une
Cronicaabbreviata dominorumabbatum Sancti Richarii,publiée en 1856 etréimprimée en 1893 par E. Prarond.
Le vidimus, probablement un autographe, est revêtu de lasignature de Jean de la Chapelle. Il contient le texte de cinqdocuments : 1° les deux actes que l’on trouve dans la
Chron.d’Hariulf, (p.185 et 224, éd. Lot)2° une lettre de Hugues, abbé de Saint-Riquier, du20 décembre 1239 ; 3° une lettre de Guillaume dePont-de-l’Arche, évêque de Lisieux, du24 déc. 1239 ; 4° un acte de reconnaissancepassé par Jacques, archidiacre de Caux, devant le chapitrede Saint-Riquier en février 1240.
(
31)Arch. dép. de la Somme ; Inventaire des titres etpapiers de l’abbaye royale de Saint-Riquier, t. IV,années 1781 et 1782. - Cf. Darsy,
Bénéficesdel’églised’Amiens, etc., t.II, p. 250.
(
32)Vidimus du 20 mai 1491, cité plus haut.
(
33)Pouillé du diocèse de Lisieux. - Vastel,
Noticehist., p. 16. - Voy.à l’Appendice lapièce n° Ier.
(
34)
Traitédes droitshonorifiques, t. Ier, p.144-147(Paris, 1772, 2 vol. in-8°).
(
35)Vastel,
Noticehist.,p. 15, 19.
(
36)Hénocque,
Hist. del’abbaye deSaint-Riquier, t. II, p.224-226.
(
37)Appendice nos II et III.
(
38)Hénocque,
Hist. del’abbaye deSaint-Riquier, t. II, p.224-226.
(
39)Le chapitre de Cléry eut la collationd’autres chapelles de valeur aussi médiocre, telleque la chapelle de Saint-Philbert, à Saint-Gatien (arr. dePont-l’Evêque, cant. Honfleur).
(
40)Voy. à l’Appendice, n° Ier.
(
41)Louis XI donna au chapitre de Cléry 4,000 l. de rentesur certains fiefs, terres et héritages assis en Normandie.Ce Chapitre eut la justice, la garde-noble, les amendes ; il eut aussile patronage des églises. -
Ord.des Rois de Fr., t.XVIII, p. 357.
(
42)Vastel,
Noticehist.,p. 19.
(
43)Claudius Lavergne,
Noticehist. sur la chapelle deN.-D.-de-Grâce, p . 24.
(
44)Nous ne savons où cette terre est située. Le
Dict.hist. de l’Eure (t.II,p. 355) fait mentiond’une famille Le Bys, à La Haye-Saint-Sylvestre,canton de Rugles.
(
45)Min. du tabellionage d’Auge, 4 mai 1608, 15 mai 1608.
(
46)Min. du tabell. d’Auge, 18 juillet 1599 ; - 5 novembre1606.
(
47)Arch. dép. de la Seine-Inf. Mémoriaux de laChambre des comptes. reg. 12, fol. 96 ; Bureau des finances, reg. C1279 ; - Min. du tabell. d’Auge, 7 septembre 1600 et 6septembre 1608.
(
48)Mémoriaux de la Chambre des comptes de Normandie, reg.18, fol. 76.
(
49)Min. du tabell. d’Auge, 5 nov. 1606 ; 12 mai 1607.
(
50)Min. du tabell. d’Auge, 22 octobre 1613.
(
51)Min. du tabell. d’Auge, 25 mars 1614.
(
52)Min. du tabell. d’Auge, 23 mai 1629.
(
53)Vastel,
Noticehist.,p.144.
(
54)Il a été mentionné par Ed.Frère,
Manuel du Bibliographenormand, t. Ier, p. 425.
(
55)Nous avons ajouté au bas des pages, entre [ ], lapagination absente.
(
56)Vastel,
Noticehist.,p. 144.
(
57)De Masseville,
Hist. sommairede Normandie,(éd.1714), t. VI, p. 346.
(
58)Vastel,
Noticehist.,p. 20, 21, 24, 28, 145.
(
59)Du Tertre,
Hist.gén.des Antilles, t. Ier, p. 517.
(
60)Vastel,
Noticehist.,p. 86-96. - Nous donnons dansl’Appendice, n° IV, une liste des anciens
ex-votoqui subsistent encore.
(
61)Eug. Sue.
Hist.de la marine,t. II, p. 81. - Jal,
AbrahamDuquesne et la marine de son temps,t. Ier, p. 574-580.
(
62)Vastel,
Noticehist.,p. 127-132.
(
63)Arch. mun. de Honfleur ; reg. de l’amirauté :rapports de mer et congés des années 1636à 1719.
(
64)Maurille de S. Michel.
Voyagedes isles Camercanes enl’Amérique qui font partie des Indesoccidentales, etc. p.231-244, (Paris, Jean de la Caille, 1653).
(
65)Min. du tabell. d’Auge, juillet, septembre et octobre1614. - Cf.
Documents relatifsà la marine normande,p.72, 210, 211 (Soc. Hist. de Normandie).
(
66)Nous devons cet extrait à l’obligeance du P.Edouard d’Alençon, archiviste des FF. Min.Capucins, à Rome.
(
67)Date en blanc.
(
68)En blanc.